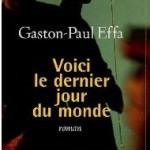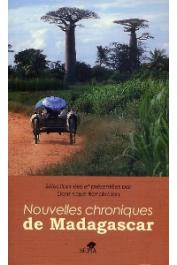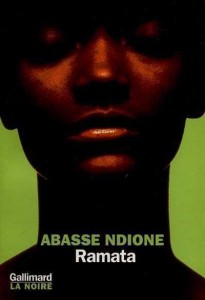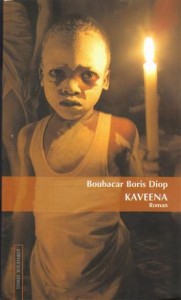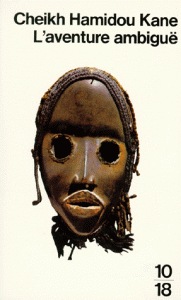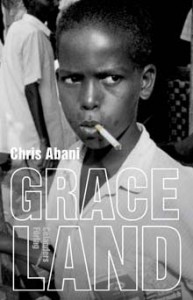 Voici un roman d’une grande intensité qu’est celui que nous propose Chris Abani avec Graceland. Décidément la littérature nigériane est d’une incroyable richesse ; pensons au merveilleux roman de Sefi Atta, Le meilleur reste à venir. La plume de Chris Abani immerge le lecteur dans un Lagos des bidonvilles où les violences esthétique, architecturale, hygiénique et sans escamoter bien sûr celle de ses locataires d’infortune, cèdent parfois son monopole scénique à quelques oasis de chaleur humaine. Moi qui désire tant goûter une escale dans cette mégalopole, j’ai bien peur que toutes mes velléités de ballades joyeuses sifflotées ne soient vaines.
Voici un roman d’une grande intensité qu’est celui que nous propose Chris Abani avec Graceland. Décidément la littérature nigériane est d’une incroyable richesse ; pensons au merveilleux roman de Sefi Atta, Le meilleur reste à venir. La plume de Chris Abani immerge le lecteur dans un Lagos des bidonvilles où les violences esthétique, architecturale, hygiénique et sans escamoter bien sûr celle de ses locataires d’infortune, cèdent parfois son monopole scénique à quelques oasis de chaleur humaine. Moi qui désire tant goûter une escale dans cette mégalopole, j’ai bien peur que toutes mes velléités de ballades joyeuses sifflotées ne soient vaines.
Chris Abani a ce talent rare d’un peintre des mots qui vous saisissent à la gorge ; page après page le lecteur oublie son quotidien et s’en va fouiller dans ce Lagos où foisonne une vie interlope des plus tenaces. Quelques mots sur ce grand écrivain. Né en 1966 au Nigeria, Chris Abani a écrit son premier roman à l’âge de 16 ans. En 1985, il est jeté en prison au motif que ce livre aurait inspiré un coup d’Etat (finalement manqué) contre la dictature en place. En 1987 et 1990, il est à nouveau emprisonné pour « activités subversives » contre ladite dictature. Il a publié trois romans : Masters of the Board (1985), Graceland (2004), The Virgin of Flames (2007), et deux nouvelles : Becoming Abigail (2006) et Song for Night (2007), mais également quatre recueils de poésie. Son œuvre lui a déjà valu plusieurs prix littéraires. Malheureusement seuls Graceland et Le corps rebelle d’Abigail Tansi ont été traduits en français. Espérons que son éditeur en France, Albin Michel, ait l’initiative heureuse de traduire l’ensemble de ses écrits. Actuellement, Chris Abani est professeur associé à l’Université de Californie.
Graceland relate la vie d’un gamin de seize ans, Elvis, qui dans les années quatre-vingt vivote à Maroko, ghetto de Lagos peuplé de marabouts, de  prédicateurs et de voyous. Héros infortuné, il gagne quelques piécettes auprès des touristes en imitant son idole, Elvis Presley. Un jour viendra son tour : posséder son Graceland comme Presley détenait le sien dans le Tennessee. Cela grâce à ses talents de danseur bien sûr. Parole d’Elvis ! Mais dans l’immédiat il faut survivre au jour le jour. Que le temps était bon il n’y a pas si longtemps dans cette petite ville de province quand il était auprès de sa mère bien aimée, Béatrice, et de son aïeule, Oye, la « sorcière » protectrice. Certes il y avait son père, Sunday, qui ne cessait de le brutaliser, mais la vie y était tout de même douce. Deux malheurs ont mis un terme à cette existence paisible : la mort de sa mère et la ruine de son père après sa défaite aux élections législatives. Ce père alcoolique dont la décadence le dégoûte. Maintenant, il lui faut se battre au jour le jour, devenir un homme. A son grand désespoir, il doit mettre entre parenthèse sa « carrière » de danseur pour aider sa détestable marâtre à l’entretien du foyer. Décrocher des jobs plus sérieux et surtout plus lucratifs devient urgent. Faut-il qu’il accepte les boulots que lui propose son ami Redemption ? Il est certain que le trafic de drogue et autres commerces inavouables peuvent lui offrir un trajet direct dans une cellule des terribles geôles du pays. Mais ces petits extra sont généreux en nairas. Qui plus est, Redemption est protégé par le colonel, symbole d’un Nigeria militaire corrompu jusqu’à la racine et d’une violence assassine aveugle. Peut-être vaudrait-il mieux écouter le King roi des mendiants : ses conseils de ne pas s’écarter de la légalité ont du bon et ses discours sur la place publique à l’encontre de la dictature sont séduisants. Pendant ce temps son père n’a de cesse de lui rappeler entre deux pichets de vin de palme l’importance du clan, de la lignée propre aux Ibos auxquels le gamin appartient et doit faire honneur. Mais que reste-t-il de cette soi-disant solidarité clanique dans ces taudis où la règle serait plutôt « chacun pour soi » ? En plus, les atrocités de la guerre du Biafra ont mis à mal ce code d’honneur séculaire.
prédicateurs et de voyous. Héros infortuné, il gagne quelques piécettes auprès des touristes en imitant son idole, Elvis Presley. Un jour viendra son tour : posséder son Graceland comme Presley détenait le sien dans le Tennessee. Cela grâce à ses talents de danseur bien sûr. Parole d’Elvis ! Mais dans l’immédiat il faut survivre au jour le jour. Que le temps était bon il n’y a pas si longtemps dans cette petite ville de province quand il était auprès de sa mère bien aimée, Béatrice, et de son aïeule, Oye, la « sorcière » protectrice. Certes il y avait son père, Sunday, qui ne cessait de le brutaliser, mais la vie y était tout de même douce. Deux malheurs ont mis un terme à cette existence paisible : la mort de sa mère et la ruine de son père après sa défaite aux élections législatives. Ce père alcoolique dont la décadence le dégoûte. Maintenant, il lui faut se battre au jour le jour, devenir un homme. A son grand désespoir, il doit mettre entre parenthèse sa « carrière » de danseur pour aider sa détestable marâtre à l’entretien du foyer. Décrocher des jobs plus sérieux et surtout plus lucratifs devient urgent. Faut-il qu’il accepte les boulots que lui propose son ami Redemption ? Il est certain que le trafic de drogue et autres commerces inavouables peuvent lui offrir un trajet direct dans une cellule des terribles geôles du pays. Mais ces petits extra sont généreux en nairas. Qui plus est, Redemption est protégé par le colonel, symbole d’un Nigeria militaire corrompu jusqu’à la racine et d’une violence assassine aveugle. Peut-être vaudrait-il mieux écouter le King roi des mendiants : ses conseils de ne pas s’écarter de la légalité ont du bon et ses discours sur la place publique à l’encontre de la dictature sont séduisants. Pendant ce temps son père n’a de cesse de lui rappeler entre deux pichets de vin de palme l’importance du clan, de la lignée propre aux Ibos auxquels le gamin appartient et doit faire honneur. Mais que reste-t-il de cette soi-disant solidarité clanique dans ces taudis où la règle serait plutôt « chacun pour soi » ? En plus, les atrocités de la guerre du Biafra ont mis à mal ce code d’honneur séculaire.
Chris Abani a écrit un formidable roman avec des thématiques multiples : nation en décadence ; citoyens meurtris à l’avenir mutilé ; jeunesse en déshérence, survivance des plaies purulentes de la guerre ; temps anciens aux traditions foulées aux pieds. L’auteur alterne dans des chapitres courts, temps heureux _ l’enfance d’Elvis _ et temps présents _ sa vie dans les taudis. Chacun d’entre eux est précédé d’une recette de cuisine ou pharmaceutique des Ibos et d’un court exposé sur les significations culturelles notamment ésotériques de la noix de cola, élément essentiel à ce peuple auquel l’écrivain appartient. Chris Abani a la générosité de celui qui invite le voyageur à connaître les coutumes de son foyer auprès de sa famille native. Lire Graceland est une aventure qui serait regrettable de bouder. C’est une œuvre qui ne peut que difficilement être oubliée. En outre, la qualité du style est récompensée par une traduction heureuse du Pidgin au français. Chapeau l’écrivain !
Abani Chris, Graceland, (2004), Albin Michel, 2008, 420 p.
Hervé Ferrand
L'Afrique des idées est partenaire du Festival Nollywood Weeks qui aura lieu à Paris du 4 au 7 juin 2015


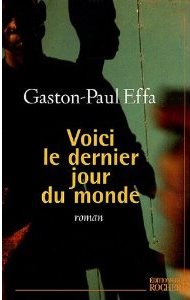 Gaston-Paul Effa est né en 1965 à Yaoundé. Donné à des religieuses alsaciennes par son père, il étudie auprès d’elles pendant ses premières années au Cameroun. Après son secondaire fait en France, il poursuit des études de théologie et de philosophie en Lorraine, matière qu’il enseigne aujourd’hui dans un Lycée de Sarrebourg. Auteur de plusieurs romans, il reçoit en 1998 le Grand Prix Littéraire de l’Afrique Noire pour son oeuvre romanesque, Mà.
Gaston-Paul Effa est né en 1965 à Yaoundé. Donné à des religieuses alsaciennes par son père, il étudie auprès d’elles pendant ses premières années au Cameroun. Après son secondaire fait en France, il poursuit des études de théologie et de philosophie en Lorraine, matière qu’il enseigne aujourd’hui dans un Lycée de Sarrebourg. Auteur de plusieurs romans, il reçoit en 1998 le Grand Prix Littéraire de l’Afrique Noire pour son oeuvre romanesque, Mà.