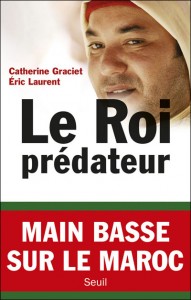Pendant plus de deux siècles, la sexualité dans le monde arabe a combinée deux états : une incapacité à résister au flux économique, politique et culturel occidental, combiné à une incroyable résilience : elle n’a pas disparue, comme d’autres civilisations confrontées à l’impérialisme occidental. Mais elle n’a pas (encore ?) intégrée cette intrusion. Elle est aujourd’hui le fruit de cette mutation produite dans des conditions extrêmes d’agression et de permanence. Et c’est dans ses soubassements les plus secrets, les plus fondamentaux aussi, que cette hétérogénéité dominée se révèle.
Pendant plus de deux siècles, la sexualité dans le monde arabe a combinée deux états : une incapacité à résister au flux économique, politique et culturel occidental, combiné à une incroyable résilience : elle n’a pas disparue, comme d’autres civilisations confrontées à l’impérialisme occidental. Mais elle n’a pas (encore ?) intégrée cette intrusion. Elle est aujourd’hui le fruit de cette mutation produite dans des conditions extrêmes d’agression et de permanence. Et c’est dans ses soubassements les plus secrets, les plus fondamentaux aussi, que cette hétérogénéité dominée se révèle.
Voilà une première raison pour étudier la sexualité, ou plutôt les sexualités arabes contemporaines, telles qu’elles se déploient dans l’imaginaire, le droit, le discours public ou encore les pratiques sociologiques. Ces sexualités disent plus que la dimension biologique, elles disent même le tout des sociétés concernées : leurs blocages, leurs hantises et leurs sublimations régressives. Ces sexualités sont striées de lignes de démarcations, zébrées de fractures visibles ou masquées. Et ironiquement, ce n’est pas en Occident, où la sexualité publique semble, au reste du monde, débridée, travaillée par des débats fondamentaux, sans cesse remise en cause dans ses formes et ses repères, que la scène sexuelle est la plus problématique, la plus déchirée, la moins unifiée, mais bien dans le monde arabe – et ailleurs, sous bénéfice d’inventaire.
Ruptures générationnelles
La première faille est générationnelle. Depuis trois ou quatre générations pour les pays et les zones les plus tôt exposés à l’occidentalisation, depuis une seule pour les pays les plus isolées, pour les zones rurales, pour les classes moyennes des petites villes, des ruptures brusque et totale se produisent à chaque relais générationnel.Qu’on s’accorde sur les termes et leur portée : il ne s’agit pas d’évolution, de transformation, ni même de révolution, qui suppose un débat ou une confrontation. Il s’agit d’une recréation du monde à chaque adolescence. Romanciers et cinéastes arabes, encore plus que les essayistes ou les militants, ont bien observés ce phénomène étrange. Une femme grandie dans un harem protégé. Ses rares connaissances sexuelles, peut-être mêmes ses premières expériences, elle les tient de femmes plus âgées de son entourage. A peine nubile, elle se marie à un promis qu’elle n’a jamais vu. A la génération suivante, sa fille grandit parmi ses pairs dans des milieux mixtes, écoles et lieux de vacances, exposée à la radio et à la télévision. Au milieu de la vingtaine, elle épouse un camarade d’université. A la troisième génération, sa petite-fille, adolescente, fait le mur et connait sa première expérience sexuelle lors d’une « boom » organisée par une copine, à seize ans. Cette séquence fictive de trois générations et de presque un siècle est sans doute exagérée, mais chaque profil, bien que outré, n’en reste pas moins vrai en substance. Le même récit peut être reproduit, avec quelques variantes de circonstance, pour les hommes : la maison close et les cheikhats, l’homosexualité diffuse et l’éphébie qui disparaissent, l’institution de la copine, les conjointes étrangères rencontrées lors des études en Occident…
Il s’agit certes d’une histoire fictive qui touche une famille embourgeoisée, supposant l’éducation universitaire pour la seconde génération, et un milieu occidentalisée pour les adolescents de la troisième. Mais la leçon à en tirer reste valable, bien que ne touchant qu’une partie, de plus en plus importante néanmoins, de la population : plusieurs révolutions de grande ampleur, concernant la place de la sexualité dans la famille, les rapports entre les générations, la manière dont la sphère symbolique gère le passage entre les étapes de la vie, affectent les sociétés arabes en continu.
Ces ruptures, si elles s’intégraient dans un plan d’ensemble, si elles formaient une totalité dialectique, se dépassant graduellement, entreraient dans une histoire significative aux yeux des principaux concernés. Mais en réalité, il n’y a aucune intégration de ces ruptures. Hormis quelques rares points qui ont fait consensus, sur le thème du progrès : la famille ne choisit plus le conjoint, les filles vont à l’école… la majorité de ces grandes transformations s’accomplissent dans un silence assourdissant, encore couvertes d’un discours qui n’a plus cours. Ce que Pierre Bourdieu appelle l’hystérésis, cette permanence d’un discours et d’une rationalisation accolés à une pratique qui a changé, la sexualité arabe en offre d’excellentes illustrations. Et au lieu d’une confrontation saine de générations, la culture arabe connait depuis longtemps une juxtaposition de civilisations à l’intérieure d’un même groupe, d’une même famille.
Rupture entre espaces public et privé
La distinction entre l’espace public et l’espace privé est fondamentale dans le monde arabo-islamique. Comme l’Antiquité avant elle, la civilisation islamique développa une société qui organisait, à l’intérieure de l’intimité domestique, de véritables autonomismes juridiques et politiques. Passé le seuil de la maison, la loi du prince s’abolissait au profit de celle du chef de famille.Cette distinction entre une loi publique et une autre privée, il n’est pas étonnant que ce soit dans le domaine familial et sexuel qu’elle se soit le mieux déployée. La sexualité publique est toute de masculinité, de retenue, de normes. Elle tolère la gaudriole si celle-ci est soumise au contrôle d’une caste, professionnalisée : almées et cheikhats, éphèbes et courtisanes, incarnaient la part congrue que l’espace public, dans les hautes sphères sociales, ou dans quelques recoins populaires, laissait au sexe extra-domestique. Cette sexualité publique, par ailleurs, est iconoclaste : elle répugne à sa propre figuration. Pas d’images bien sûr, la norme religieuse l’empêche en général, mais en la matière sexuelle, toute représentation publique à caractère sexuel est prohibée : ni baiser, ni caresse, ni contact tactile qui puisse avoir un soupçon de sens érotique.
L’espace privé est, sans surprise, l’exact opposé. Il rééquilibre l’interdit de figuration public par l’excès intime. Maître en son domaine, le chef de famille peut rêver sa maison en harem, en lieu de nudité permanente et de jouissance continue. Que la réalité soit différente importe peu : il s’agit ici surtout de souligner la manière dont, dans l’économie symbolique de l’érotisme arabe classique, l’austérité publique était rachetée par un opulent imaginaire privé. Qu’il suffise de se pencher sur les contes des Mille et une Nuits par exemple : le seuil qui sépare la maison de la rue est une frontière érotique pure, elle est la ligne de démarcation, grillagée et cadenassée, entre le voile et la nudité, la retenue et l’exacerbation des sens, le puritanisme et le pansexualisme, la pauvreté du visible et la débauche de voyeurisme. Pour résumer cette séparation classique, quoi de plus significatif que cette expérience, encore possible il y a quelques décennies, pour tout petit garçon de cette région : il y avait la rue, où il ne voyait que peu de femmes, et peu du corps de ce peu de femmes, et il y avait le hammâm, ce privé par excellence, où il voyait le tout de la femme, dans la profusion.
 Cette séparation entre le public et le privé, qui faisait sens et équilibre comme on le voit, a été traversée. D’abord fragilisée, ensuite perforée de mille trous, elle est aujourd’hui un vestige, impuissant et angoissant. La loi civile d’abord est passée par là. Les enfants à l’école ont été une première brèche dans les républiques domestiques, et la loi du père a été concurrencée par celle du maître. Ensuite, les transformations urbaines ont fait des maisonnées patriarcales où plusieurs ménages et plusieurs générations coexistaient des appartements pour familles nucléaires. Cette balkanisation des empires patriarcaux a rendu plus problématique l’autarcie qui préexistait. Les médias enfin poursuivent aujourd’hui cette entreprise : la radio puis la télévision ont depuis longtemps bousculées les codes du visuel sexuel permis ou prohibé selon les lieux et l’entourage.
Cette séparation entre le public et le privé, qui faisait sens et équilibre comme on le voit, a été traversée. D’abord fragilisée, ensuite perforée de mille trous, elle est aujourd’hui un vestige, impuissant et angoissant. La loi civile d’abord est passée par là. Les enfants à l’école ont été une première brèche dans les républiques domestiques, et la loi du père a été concurrencée par celle du maître. Ensuite, les transformations urbaines ont fait des maisonnées patriarcales où plusieurs ménages et plusieurs générations coexistaient des appartements pour familles nucléaires. Cette balkanisation des empires patriarcaux a rendu plus problématique l’autarcie qui préexistait. Les médias enfin poursuivent aujourd’hui cette entreprise : la radio puis la télévision ont depuis longtemps bousculées les codes du visuel sexuel permis ou prohibé selon les lieux et l’entourage.
Sans doute, l’horizon de ce processus est d’aboutir à une situation similaire à celle qui a cours en Occident où la délimitation quasi-ontologique qui existait dans les cultures orientales et gréco-romaines entre le privé et le public ne s’est jamais acclimatée. Mais en attendant, l’individu arabe fait face à une autre rupture problématique : des morceaux de sexualités privées envahissent l’espace public, des morceaux de sexualités publiques envahissent l’espace privé. Dit sous d’autres formes, et en exemples : on se scandalise d’un jeans trop serré, mais on met allégrement les mains aux fesses ; on s’alarme d’un baiser à l’écran mais on consomme massivement du porno ; on fronce des yeux devant une jupe mais les petits garçons batifolent encore jusqu’à sept ou huit ans dans les effluves des chairs dénudées des tantes et des cousines.
Rupture entre masses et élite
C’est sans doute la rupture sociale et politique qui est aujourd’hui le signe le plus tangible de cette sexualité dominée. La sexualité des élites, comme celle des marges et des parias d’ailleurs, a toujours été plus libre, plus aventureuse, que celle des classes populaires et moyennes, celles qui forment le gros de la démographie d’une culture donnée. Dans le monde arabo-islamique, les choses ne se passaient pas autrement. Telle que nous la rendent poèmes, contes et épitres, la sexualité arabe classique était débridée aux deux bouts de l’éventail social, dans les palais et les taudis. Mais quelque chose de nouveau s’est rajouté à ces extrêmes habituels.Avec l’impérialisme occidental, dès avant la colonisation proprement dite, un fort mimétisme culturel a affecté les élites bourgeoises orientales. On en connaît ses traits vestimentaires, culinaires, langagiers : la veste et la fourchette, le français et le piano ont tôt fait partie de l’attirail des compradors levantins, intermédiaires de la colonisation économique, puis politique. Mais cette imitation ne s’est pas bornée à ces domaines. Elle a touché, et dès l’origine, d’une manière obscure, implicite, et qui gagne à être mieux étudiée, jusqu’aux comportements sexuels.
A quel moment, par imitation, les élites se sont-elles approprié les tabous et les libertés occidentaux ? A quel moment ont-elles changé de regards sur leurs propres interdits, devenus des archaïsmes, et leurs propres libertés, devenues des licences permissives ? Dans la Trilogie, Naguib Mahfouz signale les différences de comportement entre garçons et filles selon les classes sociales, et la difficulté du jeune Kamal à naviguer entre ces normes qui sont autant sociales que sexuelles. Sur la même période, Alexandre Durrel l’auteur du Quatuor d’Alexandrie, a des notations subtiles sur les morales sexuelles selon les classes sociales dans le grand port colonial. Mais on est là déjà dans l’entre-deux-guerres, à un moment où le processus mimétique est déjà puissamment engagé.
Cette imitation, qui est en réalité un démarquage problématique, une espèce de parodie possible seulement par une mauvaise foi permanente, la décolonisation ne l’a pas arrêtée. Elle s’est poursuivie, relayée par la mondialisation culturelle et le libéralisme économique des années 1970. La liberté sexuelle, ou sa forme parodique et superficielle, est devenue pour les élites orientales le signe distinctif qui les désignait et les séparait des masses. Ces dernières, par contrecoup, se sont majoritairement engouffrées dans l’appel d’air créé par l’islamisme qui joua sur cette ambiguïté social de la liberté des mœurs.
Quoi de plus excitant, de plus tendancieux pour la bourgeoisie dépendante que d’organiser des parties telles qu’on imagine qu’elles se font là-bas, en Occident, dans des villas entourées de bidonvilles puritains ? Quoi de plus socialement vindicatif pour le sous-prolétariat urbain que de vociférer des prêches religieuses par radiocassettes près des villas où on imagine qu’il se déroule de ces fêtes immorales et jouissives ?
 Aussi, la question sexuelle, au sens le plus large, rassemblant la cause des femmes, le droit matrimonial, la liberté de mœurs, a fini par être embrigadée au service d’une autre question, sociopolitique. Ainsi va le syllogisme de la question féminine et sexuelle arabe : si l’Occident a des femmes libres, la bourgeoisie arabe, jouant de concurrence, sera évaporée, blonde et refaite de partout ; si cette bourgeoisie sans capital ni industrie est « libre », alors son peuple sans travail ni plus-value sera voilé ; et plus la bourgeoisie se dévoile, plus le peuple s’emmaillote de tissus. Cette rupture entre élite et masses arabes, on en connaît le résultat : c’est les clips musicaux de Rotana associés au paysage urbain du Caire, c’est Rania de Jordanie dans les défilés de mode et le niqab dans les rues d’Amman… On peut poursuivre cette suite binaire, elle court du Golfe à l’Atlantique, pour une fois unis.
Aussi, la question sexuelle, au sens le plus large, rassemblant la cause des femmes, le droit matrimonial, la liberté de mœurs, a fini par être embrigadée au service d’une autre question, sociopolitique. Ainsi va le syllogisme de la question féminine et sexuelle arabe : si l’Occident a des femmes libres, la bourgeoisie arabe, jouant de concurrence, sera évaporée, blonde et refaite de partout ; si cette bourgeoisie sans capital ni industrie est « libre », alors son peuple sans travail ni plus-value sera voilé ; et plus la bourgeoisie se dévoile, plus le peuple s’emmaillote de tissus. Cette rupture entre élite et masses arabes, on en connaît le résultat : c’est les clips musicaux de Rotana associés au paysage urbain du Caire, c’est Rania de Jordanie dans les défilés de mode et le niqab dans les rues d’Amman… On peut poursuivre cette suite binaire, elle court du Golfe à l’Atlantique, pour une fois unis.
Comme une larve qui mute mais en gardant son ancienne peau, la personnalité arabe a subi plusieurs métamorphoses sexuelles sans jamais renoncer décidément aux anciens discours ou aux anciennes pratiques. Des séquences temporelles hétéroclites se sont donc déposées, sédimentées, les unes sur ou contre les autres. Un habit bariolé, fait des chutes de vieux tissus et d’échantillons de tissus étrangers, recouvre cette sexualité malheureuse, qui parle plusieurs langues mais ne sait toujours pas dire l’essentiel, accoutrée d’une multitude d’habits mais ayant toujours froid, et qui, sans cesse et encore, attend que d’ailleurs viennent les derniers patrons sur lesquels tailler une robe pour un corps dont elle ne sait que faire. Hétérogénéité de la domination.
Article d'Omar Saghi, initialement paru sur son blog