 Dans un précédent article, nous avons dressé l’état des lieux et analysé la situation de l’éducation au Bénin. Si des améliorations ont été constatées, notamment au niveau de l’accès – en termes quantitatifs – à l’éducation, de nombreux problèmes ont également été identifiés, notamment au niveau qualitatif. Ils nous indiquent les priorités d’action qui nous paraissent cruciales pour que l’éducation béninoise remplisse pleinement son rôle.
Dans un précédent article, nous avons dressé l’état des lieux et analysé la situation de l’éducation au Bénin. Si des améliorations ont été constatées, notamment au niveau de l’accès – en termes quantitatifs – à l’éducation, de nombreux problèmes ont également été identifiés, notamment au niveau qualitatif. Ils nous indiquent les priorités d’action qui nous paraissent cruciales pour que l’éducation béninoise remplisse pleinement son rôle.
Rapprocher l'éducation des réalités et des besoins du pays
Pour que l’éducation réponde aux défis qui lui sont posés, l’accent doit être mis sur une formation qui conduise les jeunes à l’emploi ou à la création d’emplois et qui leur permette de s’épanouir et d’être de plein acteurs du développement de leur pays. C’est pourquoi il est important que l’organisation et les contenus de l’éducation se rapprochent des besoins et des réalités économiques du marché du travail. Pour ce faire, il est crucial de mieux orienter les étudiants vers les filières adaptées au marché du travail. C’est primordial si l’on veut lutter contre le chômage des jeunes et de multiples problèmes connexes comme l’insécurité. En effet, au Bénin comme dans plusieurs pays d’Afrique, l’enseignement général est plus valorisé dans les mentalités ; un trop grand nombre d’élèves et d’étudiants s’y accrochent et cela pose des problèmes. D’abord la rétention des élèves lors de leur cursus, en particulier dans l’enseignement secondaire général, est faible, allant jusqu’à un élève sur 6 par endroits, parfois pire. Ces jeunes qui sortent du système en 4ème, 3ème, 1ère se retrouvent en général sans aucune formation professionnalisante et sont désœuvrés. Ils ne veulent pas non plus retourner aux activités champêtres ou artisanales de leurs parents car cela serait perçu comme un échec. Leurs parents, pour beaucoup illettrés ou peu instruits, ont formé en les inscrivant à l’école de grands espoirs de réussite, des espoirs qui se résument souvent d’ailleurs à ce que leur enfant devienne un grand cadre dans l’administration publique.
La réussite par la voix de l’enseignement général et par l’embauche subséquente par l’Etat sont donc hautement présentes dans les esprits et tiennent non seulement à l’histoire récente du pays mais aussi à ses réalités palpables. Outre la période marxiste des années 70 et 80 où l’Etat avait essayé tant bien que mal d’embaucher systématiquement les jeunes étudiants fraîchement diplômés, le Bénin est également le théâtre d’une corruption généralisée qui se manifeste par un niveau de vie très élevé de nombreux agents de l’Etat. Ces facteurs ont entraîné une forte hausse du nombre d’étudiants dans l’enseignement général et par voie de conséquence, une hausse du chômage.
Il est important aujourd’hui de redonner toutes ses lettres de noblesse à l’enseignement technique, un enseignement qui doit être adapté à l’offre de travail du pays. Une meilleure orientation devrait être mise en place dès la fin de la 3ème pour orienter les élèves vers un enseignement de qualité agricole ou technique. Le Bénin a fortement besoin de talents dans l’agriculture pour la moderniser, la rendre plus efficace et plus productive. Les compétences techniques nécessaires à l’émergence d’une vraie industrie manquent cruellement. Au-delà des ingénieurs formés et qui ont des compétences pour dessiner les contours de cette industrie, il faut une main d’œuvre abondante et qualifiée pour faire tourner des usines, monter, assembler des composants et fabriquer des produits finis au lieu de les importer. En lieu et place, nous avons deux grandes universités publiques et plusieurs universités privées surpeuplées de jeunes qui vont en majorité étudier la géographie, la philosophie et les sciences économiques avec à la clé peu ou pas de débouchés.
Cette meilleure orientation des étudiants doit s’accompagner d’une adaptation des contenus des enseignements aux réalités du pays. C’est le plus grand intérêt de la nation que ces contenus ne soient pas dictés par des partenaires aux développements qui apporteraient des fonds. Les fameux « nouveaux programmes » développés avec le soutien de l’USAID ont été une pâle copie de programmes qui existent dans des pays aux réalités différentes et qui font l’éloge d’une certaine interactivité avec un mépris avéré pour des compétences de base pourtant essentielles. Il est important que le gouvernement béninois reprenne la main sur ces contenus et qu’il l’adapte au contexte historique, sociopolitique et économique du pays. Les jeunes étudiants devraient avoir en perspective l’histoire de leur pays, sa place dans le monde, ses succès et ses échecs, ses besoins réels et ses défis.
Améliorer la qualité des enseignements et des équipements éducatifs
Si la mise en application des priorités évoquées ci-dessus nécessite beaucoup plus de volonté politique que de moyens financiers, des efforts financiers sont également nécessaires notamment pour améliorer la qualité des enseignants et de tous les équipements éducatifs : salles de classe, matériel pédagogique, manuels scolaires. Les enseignants sont la pierre angulaire de la transmission du savoir. Il n’est pas possible de réformer les contenus et leur transmission à la génération montante sans mieux former et outiller les enseignants.
Réduire les inégalités d'accès à l'éducation
Il incombe également aux autorités en charge de l’éducation de réduire les disparités géographiques et d’assurer une meilleure parité filles/garçons. Il faut pour cela concentrer les efforts sur les zones défavorisées, inciter les professeurs de qualité à y enseigner et améliorer les conditions dans lesquelles les jeunes des localités concernées sont amenés à s’instruire.
Améliorer l'organisation de l'administration du secteur
Les institutions en charge de l’éducation doivent avoir une organisation et un leadership clairs qui facilitent la prise de décisions et leur mise en œuvre. Actuellement, le dispositif de pilotage du Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education du Bénin (PDDSE) comprend un comité de supervision (CSPD), un comité de pilotage (CPPD) et un comité de coordination (CCPD), dont les attributions sont opérationnalisées par un Secrétariat technique permanent (STP) avec des prérogatives mal définies, on comprend aisément que la mise en oeuvre du plan accuse des retards et un ralentissement conséquents. Un dernier défi réside dans la réduction des lourdeurs et l’amélioration de l’efficacité du financement du secteur. Le fait que pour tous les ordres d’enseignement sauf l’enseignement supérieur, le taux moyen d’exécution du budget atteigne rarement 80% montre bien que le problème se trouve moins dans l’allocation des ressources au budget de l’éducation que dans l’exécution de celui-ci.
Tite Yokossi




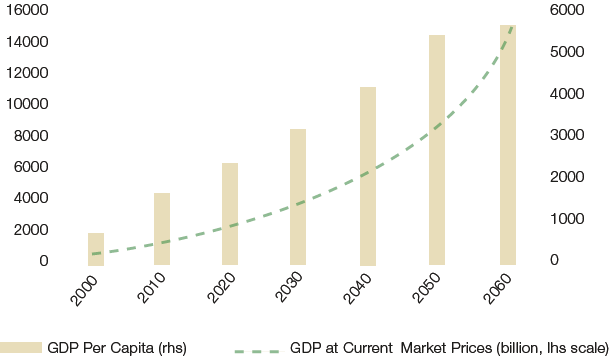







 Terangaweb : Comment vous est venue l’idée de la création d’une fondation dédiée à l’art africain ?
Terangaweb : Comment vous est venue l’idée de la création d’une fondation dédiée à l’art africain ?
 Marie-Cécile Zinsou : Ah oui, 3 millions de personnes en 6 ans (ndlr : sur un pays de 9 millions d’habitants), je pense qu’on peut appeler cela un vrai engouement du public. Soit dit en passant, notre public est essentiellement composé d’enfants de moins de 18 ans et défavorisés. On pense que les enfants les plus modestes sont ceux qui ont le plus de mal à avoir accès à leur culture puisque ne leur sont offerts que très peu de moyens à cet effet. Il est donc important de les former très tôt et de leur donner l’envie de découvrir davantage leur culture.
Marie-Cécile Zinsou : Ah oui, 3 millions de personnes en 6 ans (ndlr : sur un pays de 9 millions d’habitants), je pense qu’on peut appeler cela un vrai engouement du public. Soit dit en passant, notre public est essentiellement composé d’enfants de moins de 18 ans et défavorisés. On pense que les enfants les plus modestes sont ceux qui ont le plus de mal à avoir accès à leur culture puisque ne leur sont offerts que très peu de moyens à cet effet. Il est donc important de les former très tôt et de leur donner l’envie de découvrir davantage leur culture.








