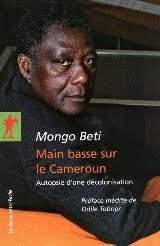 Le terme « indépendance » vis-à-vis de la France m’a toujours laissé songeur, même si Grand Kallé a réussi à faire danser tout un continent sur une utopie. La lecture du fameux essai de Mongo Béti, Main basse sur le Cameroun : Autopsie d’une décolonisation, publié chez François Maspero et immédiatement censuré en 1972 par le ministre de l’Intérieur français de l’époque, Raymond Marcellin, me conforte quarante ans après sur le fait que tout cela n’est que mascarade.
Le terme « indépendance » vis-à-vis de la France m’a toujours laissé songeur, même si Grand Kallé a réussi à faire danser tout un continent sur une utopie. La lecture du fameux essai de Mongo Béti, Main basse sur le Cameroun : Autopsie d’une décolonisation, publié chez François Maspero et immédiatement censuré en 1972 par le ministre de l’Intérieur français de l’époque, Raymond Marcellin, me conforte quarante ans après sur le fait que tout cela n’est que mascarade.
Notons d’abord, concernant cette censure, qu’elle fait suite à la demande du gouvernement d’Amadou Ahidjo par l’entremise d'un autre écrivain, Ferdinand Oyono, ambassadeur du Cameroun en France au moment de la parution de l’essai de Mongo Béti. Un paradoxe. Notons ensuite que l’interdiction de circuler en France de cet ouvrage n’a été levée qu’en 1976. Naturellement, on se demande le pourquoi d’une telle censure en France de l’auteur camerounais et surtout quelles sont les raisons obscures qui ont conduit les autorités françaises à se prêter à cet exercice si peu conforme aux valeurs de la République. Mongo Beti fournit de nombreux éléments de réponse sur ces points.
La curiosité donc m’a conduit à me plonger dans ce texte d’un auteur dont, depuis longtemps, j’avais perçu l’engagement sans avoir parcouru ses écrits. Mongo Béti est un insoumis qui, à l’aide des mots, tente de donner aux lecteurs les clés du fameux procès du dernier leader historique de l’U.P.C, Ernest Ouandié et de l’évêque de Kongsamba, Monseigneur Albert Ndongmo. Mascarade de procès au Cameroun. Mongo Beti s’efforce dans un premier temps, dans un style maîtrisé et direct, de brosser le contexte de ce procès dans l’histoire récente du Cameroun. 10 ans d’indépendance au moment des faits. Plus de 15 ans de guerre d’indépendance menée par les révolutionnaires de l’Union des populations camerounais. Décrivant d’abord la genèse de ce mouvement créé par des syndicalistes français, puis la figure historique de Ruben Um Nyobè qui dès 1954 prend les armes pour poursuivre son combat contre l’administration coloniale. Cette première phase de l’essai permet au lecteur de cerner la violence d’un conflit longtemps passé sous silence à l'extérieur du Cameroun. Elle permet de voir l’ascension d’Ahmadou Ahidjo, modeste instituteur peulh qui deviendra le champion de l’administration coloniale.
Si Mongo Béti se montre particulièrement irrévérencieux à l’égard de ce dernier qu’il désigne par le qualificatif de petit peulh, c’est principalement par le fait qu’il constitue l’élément central de sa démonstration : les indépendances en Afrique francophone sont un leurre, fruit de la vision éclairée du Général de Gaulle pour garder la main mise de la France sur son pré-carré en Afrique. Si on peut regretter les attaques sur la personne du président camerounais par Mongo Beti, qui pourrait réduire son propos, la densité de son discours atténue ce méfait en soulignant la violence du régime d’Ahidjo sur la persécution dont Mongo Béti a été l’objet, sur les éliminations physiques des leaders de l’opposition camerounaise, sur la désinformation orchestrée par une certaine presse française de gauche.
Sur ce point, Mongo Béti recueille de nombreux articles couvrant les événements entourant l’indépendance camerounaise de 1958 à 1962, mais surtout le procès de 1970 et l’exécution d’Ernest Ouandié pour développer la thèse d’une presse à géométrie variable quand il s’agit de traiter les scandales des pays du Tiers-Monde. Observateur de cette presse, habitué à la voir ruer dans les brancards lorsqu’un régime fasciste abat des cartes violentes sur son opposition ou sur des minorités, comme en Espagne lors du procès franquiste de Burgos, ou en République dominicaine, où la dictature est soutenue par les Etats-Unis, le Guatemala… Observateur de cette presse, disais-je, Mongo Béti n’en est que plus désabusé quand il constate l’omerta puis la désinformation qu’elle impose autour des événements au Cameroun et surtout le procès de Ouandié et Ndongmo. Le journal de centre gauche « Le Monde » est particulièrement dans le collimateur de l’essayiste camerounais.
Il ne pouvait donc être question d'une analyse exhaustive des publications françaises et de distribuer équitablement l'éloge et le blâme. Je me proposais d'illustrer cette vérité formulée ici et là, dans mon livre, que, quand il s'agit de l'Afrique noire, les clivages gauche/droite, libéraux/conservateurs deviennent brusquement caducs en France pour faire place à un complexe obscur, mélange inquiétant de paternalisme paranoïaque et de sadomasochisme, qui doit servir de fond à tous les crimes passionnels. Pour cela, je n'avais besoin que de clouer au pilori quelques publications réputées dont la trahison à l'égard d'idéaux affichés de gauche était la plus flagrante ou, inversement, d'en mentionner d'autres où les qualités de cœur du rédacteur en chef avaient eu raison, en cette occasion, d'options notoirement droitières, sinon racistes.
40 ans après ce procès malheureux, 39 ans après la publication de cet essai, bienheureux celui qui pense que ce texte n’est plus d’actualité.
Edition François Maspero, petite collection maspero, 1ère parution en 1972, 269 pages
Laisser uncommentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *




L'article donne envie de lire l'essai de Mongo Béti, la censure dont il a fait l'objet en 1972 stimule encore plus cette envie. L'Afrique est-elle véritablement indépendante aujourd'hui ? Cela fait effectivement problème.
"Les indépendances en Afrique francophone sont un leurre, fruit de la vision éclairée du Général de Gaulle pour garder la main mise de la France sur son pré-carré en Afrique"
Cette thèse me parait être un peu excessive, ou alors il faudrait voir son développement plus détaillé. Je pense, pour ma part, que l'autonomie –plutôt que l’indépendance qui n’existe nulle part- est encore imparfaitement acquise par les Africains. Mais un peu à la manière d’un Théophile Obenga, je pense que cela résulte de chaînes psychologiques que portent Africaines et Africains. Les legs persistants de la période coloniale n’en sont que des épiphénomènes.
En commençant cette réponse, cher Tidiane Ly, j'entends à la radio que Christine Lagarde a reçu le soutien d'une trentaine de pays d'Afrique subsaharéenne. C'est une intro.
"Les indépendances en Afrique francophone sont un leurre, fruit de la vision éclairée du Général de Gaulle pour garder la main mise de la France sur son pré-carré en Afrique"
Cette thèse vous parait excessive. Il faudrait vous la démontrer? L'épisode récent de Côte d'Ivoire ne l'illustre pas suffisamment? Quelle différence y-a-t-il aujourd'hui entre Ahidjo, Sassou-Nguesso ou Ali Bongo? Que désignez vous sous le terme de legs persistants de la période coloniale? On pourra ensuite analyser s'il ne s'agit que d'épiphénomènes.
Je vous encourage à lire ce livre, et ensuite on pourra en discuter sereinement, discourir sur l'indépendance effective de ces états subsaharéens.