 A l’occasion de la journée mondiale de la femme, l’association progressiste Autre Maroc a organisé un sit-in sur la place des droits de l’Homme à Paris afin d’appeler à une réforme du code successoral. Au Maroc, cette revendication est portée par de nombreux intellectuel-le-s, associations féministes et juristes. La position officielle de l’Etat marocain, représentée par le conseil des oulémas, décrète le code de l’héritage -adopté en 1958- irréformable en raison de son caractère «sacré». C’est dans ce contexte que l’association Autre Maroc lance ce débat afin de contribuer à l’émergence d’une lutte pour une réforme juste et consciente des discriminations à l’égard des démunis, des exclus et des femmes stigmatisées et conditionnées par la domination patriarcale.
A l’occasion de la journée mondiale de la femme, l’association progressiste Autre Maroc a organisé un sit-in sur la place des droits de l’Homme à Paris afin d’appeler à une réforme du code successoral. Au Maroc, cette revendication est portée par de nombreux intellectuel-le-s, associations féministes et juristes. La position officielle de l’Etat marocain, représentée par le conseil des oulémas, décrète le code de l’héritage -adopté en 1958- irréformable en raison de son caractère «sacré». C’est dans ce contexte que l’association Autre Maroc lance ce débat afin de contribuer à l’émergence d’une lutte pour une réforme juste et consciente des discriminations à l’égard des démunis, des exclus et des femmes stigmatisées et conditionnées par la domination patriarcale.
A première vue cette revendication peut sembler culturaliste et en contradiction avec l’esprit religieux et communautaire dominant. En effet, les détracteurs de la réforme du code successoral insistent sur le fait que les lois sont aujourd’hui le reflet des rapports de forces et de la structure socio-économique de la société marocaine et par conséquent, il serait légitime que les hommes soient favorisés par le mode successoral. En d’autres termes, le rôle des hommes dans la création de richesses justifierait leur part plus importante de l’héritage. De même, ils invoquent le fait que les femmes seraient prises en charge matériellement par les hommes. Ces arguments se calquent sur une conception de la famille fortement influencée par une interprétation anhistorique de la religion musulmane. Ce modèle familial correspond en effet à la société guerrière, tribale et patriarcale dans laquelle les textes fondateurs de l’islam ont vu le jour.
Dans la pratique, les marocains recourent de plus en plus aux tribunaux pour le partage de leur succession alors que celui-ci est censé se régler à l’amiable. Les litiges successoraux se placent au second rang parmi les affaires civiles, après les questions de divorce. Outre les questions de titrisation et de mariage coutumier, les dispositions du code de la famille restent à l’origine des nombreux contentieux. Ce mode successoral peut paraître compliqué mais il repose pourtant sur des règles de base assez simples et qui le rendent intelligible et permettent de déceler l’esprit de la loi.
La première règle est celle du tafāḍul qui consiste à accorder aux héritiers mâles le double de la part que reçoivent les héritières de même degré. Les juristes musulmans se sont basés sur le verset suivant : « Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles». Cette règle ne s’applique pas dans le cas où la mère reçoit une part égale à celle du père en application du verset suivant «Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers».
La seconde règle est celle de la distinction entre les héritiers «réservataires» et «agnats». Les réservataires (al-waraṯa bi al-farḍ) sont ceux qui reçoivent des quotes-parts fixes, généralement mentionnées dans les textes religieux. En vertu de l’article 337 du code de la famille, les héritiers réservataires sont la mère, les descendants et ascendants féminins, le conjoint-e, le frère utérin et la sœur utérine. La seconde catégorie d’héritiers comprend les agnats (al-waraṯa bi at-taʿṣīb), c’est-à-dire les ascendants et descendants masculins dont la lignée n’est pas séparée par une femme. L’article 338 du code de la famille précise que l’ordre des agnats est le suivant : le fils, le père, le grand père, le frère utérin, le cousin germain etc. En pratique, les héritiers réservataires prennent les parts légales selon leurs quotes-parts respectives et lorsque la succession n’est pas entièrement absorbée par ces derniers, le reste est accordé aux agnats en vie au moment du décès et qui se trouvent en tête du classement.
Une vision partielle tend à réduire le problème du mode successoral marocain à la seule question du tafāḍul tandis que le problème réside principalement dans la définition de la quote-part de chaque héritier et dans l’étalement de la succession à un très grand nombre d’héritiers. Le code de la famille érige les grands parents en héritiers réservataires et ils obtiennent un tiers de la succession. En cas de présence d’enfants dans le couple, la conjointe obtient 12,5% seulement de la succession. Lorsqu’une famille n’est constituée que de femmes, celles-ci n’héritent pas de l’ensemble de la succession car elles sont réservataires, elles n’obtiennent que des quotes-parts fixes et ne peuvent être agnates par elles-mêmes. Dans ce cas, le premier de la liste des héritiers agnats reçoit la part restante. Il peut s’agir du frère du défunt, de son cousin ou d’un agnat lointain.
Force est de constater que ce mode de succession ne privilégie pas forcément les descendants par rapport aux ascendants. D’autant plus qu’il favorise les héritiers de sang de manière à ce que la conjointe ou le conjoint ne jouissent d’aucune protection. Des héritiers lointains peuvent hériter alors qu’ils n’ont de commun avec le défunt que le lien agnatique. Il va sans dire que les principes fondateurs de ce mode successoral rappellent les sociétés tribales cimentées par les liens agnatiques. Quant à la cellule familiale, elle était élargie dans le sens horizontal (frères, cousins germains etc.) et vertical (ascendants et descendants). On peut considérer que la présence de telles structures familiales rendait légitime un tel étalement de la succession.
Toutefois, le Maroc postcolonial a connu un changement radical en termes de structures familiales en raison de l’urbanisation de la société et de la modernisation de l’économie. La famille élargie a laissé progressivement place à ce que les sociologues de la famille appellent la famille nucléaire. Il s’agit de la famille conjugale qui constitue de nos jours une entité économique autonome. Selon les statistiques du Haut-Commissariat au Plan, la taille moyenne des familles au Maroc est de 5,58. Par ailleurs, la différence entre le milieu urbain et le milieu rural n’est que d’un point seulement. Même s’il existe toujours des familles de type élargi, la famille nucléaire est incontestablement devenue le modèle majoritaire et dominant.
Les nombreux dysfonctionnements de l’application du code de l’héritage témoignent de l’obsolescence de ses fondements théoriques. Il existe en effet des familles de femmes qui, en plus d’être appauvries par le décès du père de famille, se trouvent obligées de racheter la part des héritiers agnats sous peine de devoir vendre leur logement principal. Une telle situation peut également se produire en présence d’un ascendant de sexe masculin dans le cas où les parents du défunt sont encore vivants au moment du décès. Il peut ainsi en résulter un tort vis-à-vis des enfants qui ont davantage besoin de la succession que leurs grands-parents.
Malgré les nombreux drames familiaux, on relève l’absence quasi-totale de débat autour de cette question. Ce silence témoigne d’un double problème. Premièrement, le système économique actuel semble consacrer une forme de domination masculine qui tend à appauvrir les femmes et à concentrer les capitaux et les richesses entre les mains des hommes. Le second problème est d’ordre culturel. L’islam officiel incarné en partie par le conseil des oulémas tend à s’attacher aux lectures littéralistes lorsqu’il s’agit de jurisprudence relative au code de la famille. D’autant plus que la culture dominante semble faire du statut de la femme un marqueur majeur de l’islamité de l’ensemble de la société.
Pourtant, il existe dans le “monde musulman” des spécialistes du droit musulman qui se fondent sur les textes sacrés de l’islam afin d’appeler à une refonte du code de la succession. Partant du constat général de l’obsolescence du code successoral classique, ils ont recours à une lecture rationnelle du Coran fondée sur l’historicité des textes coraniques et des hadiths et mettent ainsi en avant les visées du droit (maqāṣiḍ aš-šarʿ). Plusieurs pays ont introduit des réformes du code de l’héritage dans le but d’éviter les situations les plus critiques. En Tunisie et dans plusieurs pays de tradition shiite, les héritiers agnats sont évincés en cas de présence d’héritières réservataires. Introduire des situations exceptionnelles au nom de l’intérêt général (maṣlaḥa) semblerait plus réaliste, même si cette proposition a déjà été rejetée par le conseil des oulémas en 2008. Il est également possible d’introduire un droit d’usufruit au conjoint en cas de décès comme dans la majorité des codes de succession à travers le monde. Cela permettrait dès lors de protéger la famille nucléaire sans pour autant toucher aux fondements de l’interprétation dominante des textes religieux.
Dans ce contexte, la prise en charge de la réforme du code de succession demande du courage politique et l’instauration d’un mouvement solide qui ne considère pas l’égalité des sexes comme unique priorité. Il s’agit bien au contraire d’un travail horizontal plus large qui vise à garantir la justice sociale, la démocratie, les libertés et l’égalité entre les sexes.

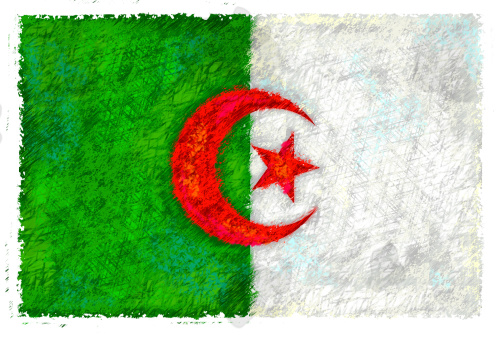 Occuper l’espace public en Algérie ? Cette idée demeure inconcevable pour le régime algérien. Depuis la signature par l’ex-chef du gouvernement, Ali Benflis, le 18 juin 2001, d’un arrêté interdisant les marches à Alger, l’appareil répressif est déployé en vue de mater toute activité organisée dans la rue. Les organisations qui tentent de manifester ou qui essayent d’observer des rassemblements dans la capitale, voient leurs militants arrêtés, embarqués à bord de fourgons de police et incarcérés dans les cellules de commissariats. Le scénario se perpétue depuis une décennie avec son lot multiforme de violations des libertés.
Occuper l’espace public en Algérie ? Cette idée demeure inconcevable pour le régime algérien. Depuis la signature par l’ex-chef du gouvernement, Ali Benflis, le 18 juin 2001, d’un arrêté interdisant les marches à Alger, l’appareil répressif est déployé en vue de mater toute activité organisée dans la rue. Les organisations qui tentent de manifester ou qui essayent d’observer des rassemblements dans la capitale, voient leurs militants arrêtés, embarqués à bord de fourgons de police et incarcérés dans les cellules de commissariats. Le scénario se perpétue depuis une décennie avec son lot multiforme de violations des libertés.



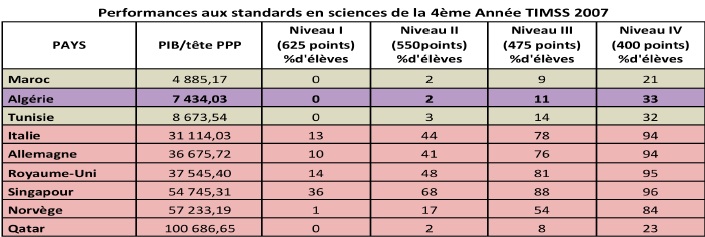
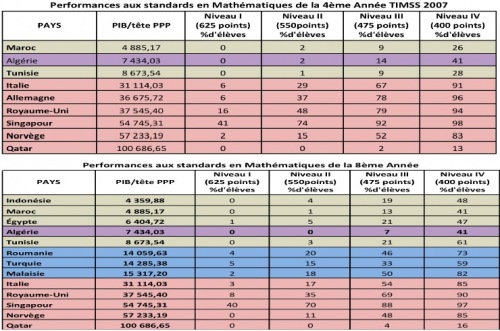
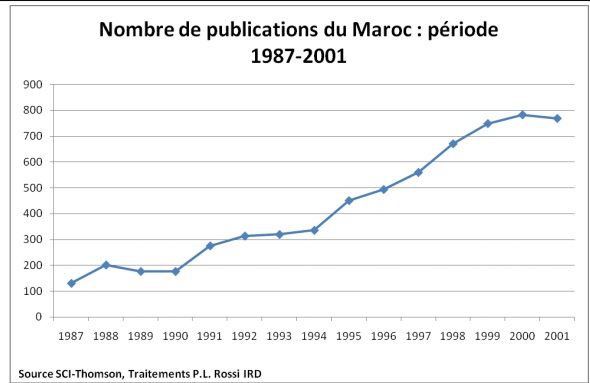
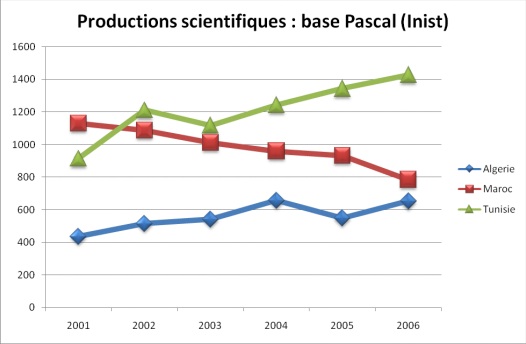





 Au lendemain des élections de l’Assemblée Constituante tunisienne, l’omniprésence médiatique du parti islamiste Ennahda – certes justifiée par sa victoire incontestable, avec 91 sièges sur les 217 que comptera la future assemblée
Au lendemain des élections de l’Assemblée Constituante tunisienne, l’omniprésence médiatique du parti islamiste Ennahda – certes justifiée par sa victoire incontestable, avec 91 sièges sur les 217 que comptera la future assemblée
