 Zurich : le 15 mai 2004. Les délégations marocaine et sud africaine retiennent leur souffle. Dans quelques secondes, Joseph Blatter, président de la Federation International of Football Association (FIFA), ouvrira l’enveloppe dans laquelle se cache le nom du pays organisateur de la XIXe Coupe du Monde de l’histoire, en 2010. Quatre petites années plus tôt, l’Afrique du Sud avait échoué à ce même niveau de la sélection pour la Coupe du Monde 2006, mais n’avait pas fait pâle figure, face à la grande Allemagne, ne s’inclinant que d’une seule voix. Suite à cet échec, les différentes confédérations footballistiques et la FIFA, avaient unanimement décidé que l’appel d’offre, pour l’édition suivante (2010), ne serait ouvert qu’aux seuls pays africains. Cinq pays c’étaient alors lancés dans la course : la Libye, La Tunisie, Le Maroc, L’Egypte et l’Afrique du Sud. Très vite, la Libye et la Tunisie jetèrent l’éponge, effrayés qu’elles étaient par la masse des éventuels investissements à prévoir. Sur les trois pays restant, l’Egypte semblait la moins bien lotie, ayant récemment obtenu l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2006). Elle n’obtiendra aucun vote le jour J. Le Maroc et l’Afrique du Sud, les deux dossiers les plus solides, allaient donc se disputer le Graal.
Zurich : le 15 mai 2004. Les délégations marocaine et sud africaine retiennent leur souffle. Dans quelques secondes, Joseph Blatter, président de la Federation International of Football Association (FIFA), ouvrira l’enveloppe dans laquelle se cache le nom du pays organisateur de la XIXe Coupe du Monde de l’histoire, en 2010. Quatre petites années plus tôt, l’Afrique du Sud avait échoué à ce même niveau de la sélection pour la Coupe du Monde 2006, mais n’avait pas fait pâle figure, face à la grande Allemagne, ne s’inclinant que d’une seule voix. Suite à cet échec, les différentes confédérations footballistiques et la FIFA, avaient unanimement décidé que l’appel d’offre, pour l’édition suivante (2010), ne serait ouvert qu’aux seuls pays africains. Cinq pays c’étaient alors lancés dans la course : la Libye, La Tunisie, Le Maroc, L’Egypte et l’Afrique du Sud. Très vite, la Libye et la Tunisie jetèrent l’éponge, effrayés qu’elles étaient par la masse des éventuels investissements à prévoir. Sur les trois pays restant, l’Egypte semblait la moins bien lotie, ayant récemment obtenu l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2006). Elle n’obtiendra aucun vote le jour J. Le Maroc et l’Afrique du Sud, les deux dossiers les plus solides, allaient donc se disputer le Graal.L’enveloppe est ouverte. Le résultat est présenté à l’assemblée. Le clan marocain est abattu, des années de travail qui s’envolent. Côté sud africain, on exulte. Ils ont pris leur revanche. 14 voix favorables contre 10 pour le Maroc. Le pays le plus riche du continent aura l’honneur et l’immense responsabilité d’organiser la Coupe du Monde 2010. Six ans de préparation pour quatre semaines de spectacle.
Aujourd’hui, en 2011, nous pouvons affirmer que cette compétition fut un franc succès sportif –exception faite peut-être de la délégation française- couronnant certainement l’un des plus beaux champions de l’histoire des Coupe du Monde : l’Espagne. Qu’en est-il du succès financier ? Quel bénéfice l’Afrique du Sud retire-t-elle réellement de cet événement ?
Nous tâcherons de voir ensemble le bilan que l’on peut tirer du succès économique, financier et social généré par la manifestation sportive la plus populaire au monde, loin devant le Super Bowl.
Lorsqu’au début de la décennie 2000, la FIFA a décidé que la Coupe du Monde 2010 s’organiserait sur le continent africain, l’idée centrale était de faire bénéficier un pays d’Afrique du succès économique de ce genre d’événement, créant par la suite un éventuel emballement positif, une sorte de cercle vertueux, comme ce fut le cas de la Catalogne et de toute l’Espagne après les J.O. 1992 à Barcelone.
Seulement, pour que la fête soit belle et attire du monde, il faut investir. Beaucoup. Le football nécessite des infrastructures de grandes envergures et très coûteuses. En 2005, l’Afrique du Sud détient 4 stades de football dignes de ce nom –nécessitant quelques rénovations néanmoins-. Dans sont dossier initial, rendu à la FIFA en 2004, l’Afrique du Sud prévoyait 13 stades pour la compétition : les 4 rénovés plus 9 nouveaux stades. Le budget prévu était de 550 millions d’euros. Une utopie lorsque l’on connaît le coût des stades modernes. En lieu et place des 550 millions d’euros c’est près d’un milliard € investi ; non pas pour 13 mais 10 stades, au final.
Bien entendu, construire des stades ne suffit pas. Il faut aménager le territoire. Etendre les réseaux ferroviaire et routier, moderniser les aéroports, créer des parkings aux abords des stades et des nouveaux hôtels. En juin 2008, Danny Jordan, directeur exécutif du Comité d’Organisation de la coupe, estime que le budget est d’ors et déjà dépassé du fait de « l’escalade des coûts ». Dans ses prévisions initiales, hors constructions et rénovations des stades, le gouvernement sud africain avait estimé à 400 M€ les coûts nécessaires aux infrastructures. En 2011, l’agence OSEO, dans son étude intitulée “ A Preliminary Evaluation of the Impact of the 2010 FIFA World Cup: South Africa”, estime que ces coûts auraient finalement avoisinés les 3,5 milliards de dollars! Soit près de 10 fois la somme prévue.
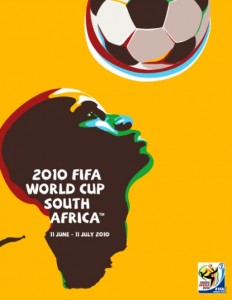 Les avantages immédiats de ces investissements sont clairement identifiables. Aujourd’hui, le pays, grâce à la Coupe du Monde, possède des aéroports flambant neufs, de belles routes. On observe aussi un désenclavement de certaines régions du pays grâce au développement du réseau ferré. Grâce aux stades, l’Afrique du Sud s’inscrit désormais comme l’un des leaders de l’industrie du « Sportainment » –avec l’Allemagne-. Industrie où les stades ne sont plus de simples lieux de rencontres sportives mais de véritables lieux de vie, intégrant des hôtels, des restaurants, des galeries marchandes, des salles de conférence. Sur ce point précis, l’Afrique du Sud est nettement en avance sur un pays comme la France par exemple.
Les avantages immédiats de ces investissements sont clairement identifiables. Aujourd’hui, le pays, grâce à la Coupe du Monde, possède des aéroports flambant neufs, de belles routes. On observe aussi un désenclavement de certaines régions du pays grâce au développement du réseau ferré. Grâce aux stades, l’Afrique du Sud s’inscrit désormais comme l’un des leaders de l’industrie du « Sportainment » –avec l’Allemagne-. Industrie où les stades ne sont plus de simples lieux de rencontres sportives mais de véritables lieux de vie, intégrant des hôtels, des restaurants, des galeries marchandes, des salles de conférence. Sur ce point précis, l’Afrique du Sud est nettement en avance sur un pays comme la France par exemple.De telles infrastructures ont également attiré touristes et supportaires. Pour 64 matches au total, il a été recensé 3,2 millions de spectateurs soit une moyenne de 49 700 spectateurs par parties.
Cela étant dit, cette réussite est à relativiser car, en termes de retour sur investissement comme en termes de progrès social, la Coupe du Monde 2010 n’a pas joué le rôle que l’on attendait.
En ce qui concerne les finances publiques, cet événement a été un échec. Le gouvernement attendait des recettes fiscales à hauteur de 1,5 milliard d’euros, elles ne seront que de 500 millions d’euros.
Sur le plan économique, le bilan est plus mitigé. Tout d’abord, les nombreux travaux effectués entre 2004 et 2009, ont permis aux cinq grandes entreprises de construction du pays d’accroître considérablement leurs bénéfices (+1300% entre 2004 et 2009-sources OSEO). Les salaires des directeurs de ces entreprises ont, en moyenne, progressés de 200% (sources OSEO) dans la même période. L’engouement généré par la compétition a permis de créer près de 200 000 emplois, mais la plupart étant saisonniers, bon nombre d’entre eux ont été détruits après le 11 juillet.
Les magnifiques stades représentent à eux seuls le non moins magnifique gaspillage financier dont a fait preuve le gouvernement sud africain. Ces dix stades à un milliard sont, sans aucun doute possible, des bijoux de modernité, enviés par bien des pays de football. Mais c’est précisément là que le bas blesse : l’Afrique du Sud n’est pas un pays de football. La contenance moyenne des stades de la coupe est de 56 711 places –contre 30 914 pour la France-. Ces mastodontes, symbolisés par le gigantesque Soccer City Stadium de Johannesburg, théâtre de la finale, avec ses 94 700 places (contre 80 000 pour le Stade de France), ont été rebaptisés « White Elephants » après la compétition. En effet, aujourd’hui, ces stades sonnent désespérément creux et ce pour plusieurs raisons : les équipes de Rugby (sport roi) ont, pour la plupart conservé leurs anciens stades, tandis que les clubs de football n’ont pas les moyens de devenir locataires de ces enceintes neuves et coûteuses. Ainsi, ces stades, initialement prévus pour générer des revenus dans le futur, sont en réalité des boulets attachés aux pieds du gouvernement sud africain qui déboursera, en moyenne, chaque année, 2 millions d’euros pour les entretenir.
D’un point de vue social, la déception est également au rendez-vous. Cette manifestation sportive était présentée comme organisée par les Africains pour les Africains et le reste du monde. Résultats, sur les 3,2 millions de places vendues pour l’ensemble de la compétition, moins de 5% l’ont été à destination des Sud africains. La raison majeure étant que les prix des billets étaient bien trop élevés pour l’autochtone moyen.
L’exemple symbolisant le mieux l’échec social lié à l’été 2010 est sans aucun doute, la grève des ouvriers. Si la Coupe du Monde devait apporter de nouvelles infrastructures et une plus grande affluence touristique, elle avait surtout pour objectif d’améliorer le niveau de vie de la population, ceci de manière durable. La réalité était toute autre. Le 8 juillet 2009, le National Union of Mineworker lance le mouvement de grève : « No work, no pay » et menace de ne pas livrer les stades en temps et en heure. Cette grève massive de plus de 70 000 ouvriers porte deux revendications majeures : une amélioration des salaires de 13% pour faire face à la fois aux petits salaires accordés (245€/mois en moyenne), et à l’inflation croissante. La deuxième revendication porte, elle, sur le nombre de congés payés. Les ouvriers réclament une extension de 4 petits jours. Le personnel en grève travaille sur les chantiers clés du projet : aéroport central de Johannesburg, chantiers ferroviaires du Green Point au Cap. Face à cette menace qui risquerait de ternir l’image de l’Afrique du Sud aux yeux du monde, la Fédération des employeurs du bâtiment, la SAFCEC, cède, partiellement, accordant une augmentation de 10% des salaires, mais sans jours de congé supplémentaires.
Alors, où sont passés les lingots du Mondial ? Cette épreuve dont les plus grands pays s’arrachent l’organisation ; cette épreuve que le Qatar et ses futurs stades climatisés accueilleront en 2022.
 Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers l’institution reine du football, la FIFA, et son président depuis 13 ans : Joseph (Sepp) Blatter. Ce dernier déclarait dans Le Monde datant du 3 mars 2011: « la Coupe du Monde est un immense succès financier ». Pour sûr. La FIFA a, sur la période 2007-2010, un chiffre d’affaire de 4,2 milliards de dollars soit environ 2,9 milliards d’euros. Sur cette même période, les bénéfices réalisés par l’organisation sont de 631 millions $ (444 millions €). Selon Markus Kattner, directeur financier de la FIFA, 87% de ce chiffre d’affaire, soit 3,7 milliards $ (2,6 milliards€) ont été réalisé pendant le seul mois de compétition (11 juin-11 juillet 2010). On comprend alors mieux l’importance de la Coupe du Monde pour les finances de la FIFA.
Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers l’institution reine du football, la FIFA, et son président depuis 13 ans : Joseph (Sepp) Blatter. Ce dernier déclarait dans Le Monde datant du 3 mars 2011: « la Coupe du Monde est un immense succès financier ». Pour sûr. La FIFA a, sur la période 2007-2010, un chiffre d’affaire de 4,2 milliards de dollars soit environ 2,9 milliards d’euros. Sur cette même période, les bénéfices réalisés par l’organisation sont de 631 millions $ (444 millions €). Selon Markus Kattner, directeur financier de la FIFA, 87% de ce chiffre d’affaire, soit 3,7 milliards $ (2,6 milliards€) ont été réalisé pendant le seul mois de compétition (11 juin-11 juillet 2010). On comprend alors mieux l’importance de la Coupe du Monde pour les finances de la FIFA.Malheureusement, cette recherche constante du gain –pour ce qui ne reste finalement qu’une association- peut aller en contradiction totale avec les buts qu’elle c’était fixée au départ. En 2007 l’association avait lancé le projet « Fair Game- Fair Play » qui consistait à faire en sorte qu’un minimum de Sud africains aux faibles revenus soit laissé aux portes des stades. On sait aujourd’hui ce qu’il en a été. En mars 2008, une cérémonie, en présence de Sepp Blatter, avait été organisée par les différentes délégations syndicales afin d’ouvrir les yeux de la FIFA sur les conditions de travail des ouvriers. Un mémorandum pour « des conditions de travail descentes » avait été remis au dirigeant qui avait alors assuré que la FIFA veillerait à ce que les travaux soient effectués dans de bonnes conditions et que les ouvriers aient des places gratuites pour voir des matches dans les stades qu’ils auront eux-mêmes construit. Là encore, nous savons désormais que ces promesses n’ont pas abouti.
Pis. Si les gains de la FIFA se font avant tout sur les droits télévisuels et les droits marketing, il faut également noter que ses gains, ainsi que ceux de ses partenaires, ont été exonérés d’impôts. Selon OSEO, cet élément fut une condition sine qua non de l’attribution de l’épreuve à l’Afrique du Sud. Pour Adrian Lackay, porte-paroles du South Africa Revenue Service (autorités fiscales sud africaines) : «Les privilèges que nous avons dû octroyer à la FIFA étaient tout simplement excessifs. Ils ont rendu impossible le moindre gain financier pour l’Afrique du Sud ». Pour couronner le tout, on peut ajouter que la FIFA a fait pression sur la collectivité de Durban afin de faire raser des marchés entiers, expulsant de fait –selon l’ONU-, près de 20 000 personnes de leurs logements pour les parquer dans des installations précaires ; à l’image des Hutongs en 2008 –quartiers chinois historiques raser pour le bien des J.O-.
Des dépenses sous-estimées, des recettes surestimées, une FIFA qui s’accapare la majeure partie des recettes. Aux vues de tout cela, la Coupe du Monde 2010 ne pouvait être autre chose qu’un échec économique pour l’Afrique du Sud. Et si Michael Goldman, du Gordon Institute of Business Sciences, à l’université de Pretoria, estime qu’il est trop tôt pour tirer un bilan économique et qu’ «un retour sur investissement à court-terme est très peu probable », on peut s’imaginer, à la connaissance de tous ces éléments, que cet événement n’engendrera pas la croissance escomptée.
Cela étant dit, on est en droit de penser que tous ces investissements n’ont pas été vains et qu’ils pourront s’avérer utiles sur le long terme. On parle, de manière récurrente, des villes de Durban et Johannesburg comme probables candidates à l’organisation des J.O. de 2020 (attribués en 2013). Dans les villes concurrentes se trouveraient, parmi les plus sérieuses candidatures, Rabat et Casablanca au Maroc…
Giovanni Djossou
