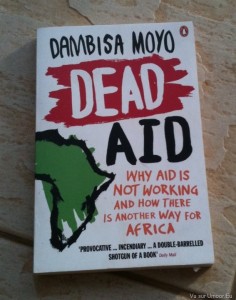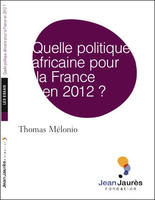 Dans un récent essai, Quelle politique africaine pour la France en 2012 ?, Thomas Mélonio, responsable de l’Afrique au sein du Parti Socialiste français, tente de définir les contours d’une politique de rupture vis-à-vis de la « françafrique ». Ce terme décrié aussi bien en Afrique qu’en France désigne des liens néocolonialistes d’un autre âge, un copinage politico-affairiste entre les élites responsables de la coopération entre la France et l’Afrique. Comme l’explique T. Mélonio, la françafrique « s’appuyait sur la défense d’une certaine idée de la France, volonté de puissance très spécifique à notre pays qui suppose de pouvoir mobiliser des pays amis en grand nombre, à l’ONU ou ailleurs, pour faire entendre puissamment la voix nationale ». Sytématisée par Jacques Foccart, elle est la continuation du lien privilégié entretenu avec les élites d’Afrique francophone insérées dans les réseaux d’influence métropolitains. Renforcée par la logique des deux camps propre à la guerre froide, la françafrique perdure de nos jours alors même que le contexte international et les réalités du continent africain ont énormément évolué. L’Afrique a diversifié ses partenariats économiques et politiques internationaux, elle connait des enjeux de développement différents des décennies précédentes, sa sociologie a profondément changé ainsi que ses revendications politiques. Fort de ce constat, et dans la perspective d’une potentielle alternance qui verrait le Parti socialiste au pouvoir à partir de 2012, Thomas Mélonio définit des axes de réforme à l’actuelle politique de la France envers l’Afrique.
Dans un récent essai, Quelle politique africaine pour la France en 2012 ?, Thomas Mélonio, responsable de l’Afrique au sein du Parti Socialiste français, tente de définir les contours d’une politique de rupture vis-à-vis de la « françafrique ». Ce terme décrié aussi bien en Afrique qu’en France désigne des liens néocolonialistes d’un autre âge, un copinage politico-affairiste entre les élites responsables de la coopération entre la France et l’Afrique. Comme l’explique T. Mélonio, la françafrique « s’appuyait sur la défense d’une certaine idée de la France, volonté de puissance très spécifique à notre pays qui suppose de pouvoir mobiliser des pays amis en grand nombre, à l’ONU ou ailleurs, pour faire entendre puissamment la voix nationale ». Sytématisée par Jacques Foccart, elle est la continuation du lien privilégié entretenu avec les élites d’Afrique francophone insérées dans les réseaux d’influence métropolitains. Renforcée par la logique des deux camps propre à la guerre froide, la françafrique perdure de nos jours alors même que le contexte international et les réalités du continent africain ont énormément évolué. L’Afrique a diversifié ses partenariats économiques et politiques internationaux, elle connait des enjeux de développement différents des décennies précédentes, sa sociologie a profondément changé ainsi que ses revendications politiques. Fort de ce constat, et dans la perspective d’une potentielle alternance qui verrait le Parti socialiste au pouvoir à partir de 2012, Thomas Mélonio définit des axes de réforme à l’actuelle politique de la France envers l’Afrique.
Tout d’abord, il propose un changement de discours par rapport à celui que Nicolas Sarkozy a donné à Dakar en 2007. Il s’agirait de mettre en exergue la diversité des réalités africaines, de sortir d’une vision en bloc des problèmes et des solutions à apporter à l’Afrique. Et de reconnaître le dynamisme actuel du continent africain. Thomas Mélonio propose également un changement de discours et un important travail de mémoire sur la colonisation, sur le traitement non républicain d’Africains ayant participé à l’histoire de France notamment lors des guerres mondiales, et également sur le génocide rwandais et le rôle que y aurait joué la France.
Le second axe de proposition, qui concerne le soutien à la démocratie et à la défense des droits de l’homme, est plus convenu. L’auteur propose de nouer des liens privilégiés avec les dirigeants vertueux au regard de la démocratie et de l’Etat de droit, sans toutefois priver les populations mal dirigées de l’aide internationale. Il s’agirait alors de faire transiter le soutien par des ONG et des acteurs dignes de confiance. T. Mélonio propose d’augmenter la part de l’aide française transitant par les ONG d’1% actuellement à 5%, ainsi que celle allant aux fondations politiques, toutes sensibilités confondues.
Au-delà du soutien logistique en période électorale qu’il souhaite renforcer, le « monsieur Afrique » du PS interroge la nature de l’interventionnisme voire de l’ingérence française dans les processus démocratiques en Afrique. C’est en effet l’un des aspects les plus décriés et polémiques de la françafrique aujourd’hui, notamment après ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire. Pour éviter les images aux relents néocolonialistes, il propose de « mettre fin aux accords de défense dans les anciennes colonies et n’y conserver que les troupes et sites logistiques strictement nécessaires à la protection et à l’évacuation éventuelle des ressortissants français ». Cette protection des ressortissants pourrait d’ailleurs être mutualisée au niveau européen. Cela reviendrait à transformer les cinq bases françaises stratégiques en Afrique en bases militaires européennes. Selon l’auteur, cela ne serait pas une perte d’influence pour la France mais au contraire un marge de manœuvre supplémentaire pour ses militaires et son gouvernement.
 La question du franc CFA est un autre symbole de la françafrique écorné. Si le choix de l’émancipation du CFA de l’euro incombe selon l’auteur avant tout aux dirigeants africains concernés, il reconnait cependant que la justification économique de l’arrimage de l’euro au CFA ne tient plus vraiment et qu’elle pénalise au contraire la zone CFA.
La question du franc CFA est un autre symbole de la françafrique écorné. Si le choix de l’émancipation du CFA de l’euro incombe selon l’auteur avant tout aux dirigeants africains concernés, il reconnait cependant que la justification économique de l’arrimage de l’euro au CFA ne tient plus vraiment et qu’elle pénalise au contraire la zone CFA.
La dernière partie de l’essai critique la politique d’aide au développement de la France vis-à-vis de l’Afrique. Une critique sur le manque de lisibilité de cette aide, plus proche de 0,3% du PIB que du 0,5% affiché par le gouvernement (qui y rajoute les garanties sur les prêts ainsi que certains financements sur le contrôle migratoire), sur son manque d’efficacité et sur les trop nombreux objectifs qu’on lui assigne injustement, notamment sur le contrôle migratoire. Thomas Mélonio appelle à augmenter réellement l’aide au développement au niveau de 0,7% du PIB auquel la France s’est engagée, de renforcer l’aide bilatérale de la France, d’améliorer la transparence des accords de partenariat et de mieux s’appuyer sur les acteurs du changement en Afrique, et non plus sur les forces conservatrices.
Ces différentes propositions, et notamment celles sur la fin des accords de défense secrets, l’européranisation des bases militaires françaises, l’accord de principe sur le désalignement du Franc CFA sur l’euro et la fin de la gestion de ses réserves de change par le Trésor français, constituent des amendements importants à la politique traditionnelle de la France en Afrique francophone. Toutefois, on pourrait regretter que l’auteur ne pose pas les bases de ce qui pourrait constituer une nouvelle politique d’aide au développement de l’Afrique. L’auteur se contente d’appeler à une augmentation de l’aide française au développement sans s’aventurer sur la question de sa réorientation. Au-delà du discours droitdelhommiste sur l’implication plus grande des ONG dans la politique d’aide au développement, d’autres pistes gagneraient à être développées. Les mutations en cours sur le continent africain créent des conditions sans précédents d’un développement endogène, comme l’ont souligné Jean-Michel Severino et Olivier Ray dans Le temps de l’Afrique. Le défi principal de développement est d’accueillir sur les différents marchés de l’emploi africains les cohortes de jeunes à venir. Comme le soulignait de manière radicale et polémique Dambisa Moyo dans Dead Aid, les formes traditionnelles d’aide au développement tendent à créer un « syndrome hollandais » proche de celui d’une rente en matières premières, avec à la clé une faible compétitivité des facteurs de production internes.
Dans ce contexte, la France gagnerait à capitaliser sur la qualité du réseau entrepreneurial et sur la connaissance du tissu économique africain développé par l’Agence française de Développement (AFD, où travaille d’ailleurs M. Mélonio) pour fonder un nouveau type de coopération entre d’une part les PME et entreprises françaises ayant un fort capital technologique, des facilitées de financement, et d’autre part les jeunes entreprises africaines qui animent un marché en forte croissance de plus 100 millions de personnes solvables. Ces entreprises africaines à fort potentiel de croissance sont encore à la recherche de partenariats stratégiques pour des transferts de technologies et une plus grande facilité d’accès aux capitaux. Contrairement à la coopération chine-afrique, ce nouveau partenariat entre les entreprises françaises et africaines privilégierait l’emploi de la main d’œuvre locale et l’amélioration de sa productivité. Il s’agirait alors d’un vrai partenariat gagnant-gagnant, les entreprises françaises développant leur participation financière et stratégique dans des entreprises en forte croissance, au moment même où la croissance européenne est atone. Cette nouvelle politique de partenariat répondrait à une forte demande de realpolitik des pays africains vis-à-vis de leurs partenaires.
Emmanuel Leroueil