Suite à la recension de son roman "Esclaves", l'écrivain togolais Kangni Alem a accepté de répondre aux questions de Lareus Gangoueus.
 Kangni Alem, on ne vous présente plus. Enseignant de littérature et de théâtre à l’université, romancier, nouvelliste, dramaturge, vous avez obtenu le Grand Prix de la littérature d’Afrique noire en 2001 pour Cola cola jazz. "Esclaves" est votre dernier roman paru en mai 2009. Quel ressenti, quel retour avez-vous eu suite à cette parution?
Kangni Alem, on ne vous présente plus. Enseignant de littérature et de théâtre à l’université, romancier, nouvelliste, dramaturge, vous avez obtenu le Grand Prix de la littérature d’Afrique noire en 2001 pour Cola cola jazz. "Esclaves" est votre dernier roman paru en mai 2009. Quel ressenti, quel retour avez-vous eu suite à cette parution?
K A : Si je m’en tiens à l’enthousiasme de mon éditrice chez Lattès, il n’y a pas à craindre pour la carrière de ce livre. Il vivra sa vie. Les ventes sont régulières, vu que beaucoup de librairies, dont la Fnac, l’ont présenté en coup de cœur. Mais fondamentalement, le lectorat africain a été présent au rendez-vous, car le sujet du livre, l’esclavage, pouvait difficilement le laisser insensible. Paraît-il que j’ai ouvert une brèche dans un mur de silence, défloré un tabou de la littérature africaine. Rien que pour cela, je suis en paix avec moi-même et satisfait, puisque je savais dès le départ à quoi je m’exposais.
La sortie de ce roman s’est faite avec un buzz autour la thématique du roman, fait suffisamment rare dans la blogosphère africaine pour être relevé. Comment l’expliquez-vous ? A-t-il suscité le débat que, je suppose, vous espériez ?
K A : Tout est parti d’une recension par le romancier béninois Florent Couao-Zotti sur son blog. L’article, repris dans la presse béninoise, a attiré plusieurs lecteurs vers le blog de l’écrivain, puisque c’était le seul endroit où le dialogue était facile. L’échange autour du sujet du roman, l’esclavage dans le Danhomé du 19e siècle, a vite tourné au vinaigre. Il faut savoir que l’actuel Bénin, ex Danhomé, est réputé avoir été un des plus grands profiteurs de la traite négrière ; et beaucoup de zones d’ombres persistent sur le rôle que ses monarques auraient eu dans l’expansion de ce commerce entre le Golfe de Guinée et le Brésil, vu que le Portugal possédait un fort à Ouidah, la ville portuaire du royaume. Etant donné que le roman mettait en scène les rivalités entre le directeur du fort portugais, l’aventurier Francisco Chacha de Souza et deux des souverains les plus connus du royaume, Adandozan et Guézo, le public béninois s’est le premier senti interpellé. Après, le débat s’est étendu aux panafricanistes de tout poil qui ont cru déceler dans mon récit une tentative de révisionnisme, vu qu’il serait indécent de raconter les complicités africaines dans un commerce qui a éparpillé les fils d’Afrique dans les Amériques. Dans l’ensemble, je trouve riche le débat suscité sur la blogosphère autour d’Esclaves. J’y ai d’ailleurs participé un peu, pour répondre à quelques attaques sur le Net, mais dans l’ensemble il s’agit plus d’établir le dialogue avec les internautes que de tenter de me défendre.
Ce roman historique a, selon les différentes sources, été écrit en sept ans. Pouvez-vous nous décrire votre travail de recherche sur les données historiques et dans quelle condition vous avez pu produire ce roman ?
K A : Dans le détail, j’ai mis 4 ans à me documenter et 3 ans à écrire le roman. Les années de documentation furent riches. Deux ans à voyager sur la côte atlantique, du Nigeria au Ghana et à tenter de comprendre pourquoi cette chape de silence sur un passé qui fut pourtant nôtre, et qui nous a constitué qu’on le veuille ou non. J’avais aussi remarqué que le plus gros des stocks d’esclaves prélevés sur notre côte finissaient au Brésil, ou à Cuba. J’ai alors cherché à comprendre comment les esclaves dans le Nouveau Monde ont vécu le servage sur place. Le Brésil s’est imposé par le nombre important de tentatives de révoltes d’esclaves, j’ai alors décidé d’y aller. Quelques cours rapides de Portugais plus tard, je me suis retrouvé à fouiner dans les archives à Recife, Rio de janeiro et Salvador de Bahia. Les rapports de police m’ont surtout comblé. On y trouve des détails qui font les délices d’un romancier. Mais il a fallu trier dans la masse d’informations et construire la fiction patiemment. J’avoue avoir pris du plaisir à créer cette alchimie entre le fait vrai et les personnages fictifs, tout en restant attentif au sens final des actes des esclaves. La fiction historique n’a de sens que si elle s’en tient aux conclusions des archives, et non à la logique des personnages inventés.
N’avez-vous pas eu le sentiment de stigmatiser une certaine couche des populations béninoises et togolaises désignés sous le terme d’Afro-brésiliens, et en particulier les descendants de Chacha Da Souza ?
K A : Stigmatiser ? Non. Vous savez, les faits sont têtus. Beaucoup de Togolais par exemple s’étonnent que je puisse raconter qu’une famille aussi illustre que la famille Olympio du Togo ait eu pour ancêtre un esclavagiste, lui-même né en servage à Rio de Janeiro et revenu pratiquer la vente d’esclaves sur la côte ! Sauf que, cette vérité qui existe dans les articles des historiens togolais, personne n’a jamais osé la dire ouvertement sous peine de se voir taxé de vendu au pouvoir en place, qui entretient une rivalité avec ladite famille depuis 1963, date de l’assassinat de Sylvanus Olympio, père de l’Indépendance togolaise. On oublie que les gestes de l’époque n’avaient de sens que dans un contexte, et que la honte des pères n’est pas celle des fils. Quant aux descendants de Chacha de Souza, disons que je refuse d’entrer dans leur argumentaire qui tend à faire de leur ancêtre un « esclavagiste positif » ! D’ailleurs le débat continue, je présenterai le roman au Bénin le 16 Octobre et le 26 Octobre à Lomé (en compagnie de mes amis Sami Tchak, Couao-Zotti et Philippe Dalembert, je m’attends à des passes d’armes mémorables avec les descendants des familles « incriminées ». Je suis décidé à répondre aux simplifications par une approche plus complexe des mentalités d’époque qui ne justifient pas qu’on relativise les actes posés par les uns et les autres. Il est temps d’accepter aussi ce que nous avons été !
Votre personnage principal tente un baroud d’honneur lors d’une mutinerie sur le navire qui le conduit aux Amériques. Par une invocation de ses croyances magico-religieuses, il tente de faire dévier la trajectoire du bateau. Une scène difficile à interpréter où le lecteur que je suis a eu l’impression que vous n’y croyez pas vous-même. Cette scène n’est-elle pas une sorte de remake d’un monde de croyances qui s’effondre, faisant penser ainsi à celui du célèbre roman de Chinua Achebe? Avez-vous eu du mal dans l’écriture de cette rupture, de cet épisode ?
K. A : J’avais en tête le scepticisme d’Achebe, en effet, décrivant l’effondrement des valeurs traditionnelles dans Things Fall Apart. Je ne sais pas si c’est nécessaire de croire ou de ne pas croire à la puissance des divinités invoquées par l’esclave Miguel, je voulais décrire le doute du détenteur de pouvoir quand soudain il perd ses repères. D’ailleurs, techniquement, la route du bateau a bel et bien été déviée, ce qui était l’objectif recherché. Le résultat n’est ni immédiat ni conforme au souhait de Miguel, mais il s’est passé quelque chose. Les dieux avaient-il la carte géographique du Nouveau Monde ? Remarquez, le Vodou est devenu le Candomblé au Brésil, en s’adaptant aux rituels de la religion catholique. Il y a une blague au Togo qui dit que les fétiches ne traversent pas l’océan. A méditer.
Vous décrivez dans la seconde partie de votre roman, le parcours du Prêtre vaudou devenu Miguel au Brésil et surtout la préparation d’une des plus grandes révoltes d’esclaves d’Amérique du sud. On a le sentiment que malgré l’esclavage qu’il subit, votre personnage semble avoir beaucoup plus de marge de manœuvre au Brésil qu’en Afrique. Est-ce votre propos ?
K A : Oui. Acculé, il n’avait d’autre choix que la révolte. Mieux, converti à l’islam, il a intégré un nouvel imaginaire où le sacrifice de soi prend une dimension révolutionnaire. Son ancienne religion ne lui aurait jamais permis cela, qui relativise l’affrontement physique et donne trop la prééminence aux pouvoirs des esprits. Ce sont deux visions du monde qui s’affrontent à l’intérieur du même homme. Ce n’est pas minimiser le rôle du Vodou dans le Nouveau Monde, il a permis spirituellement aux esclaves de tenir debout et de ruser ; mais l’islam a fourni aux esclaves, en sus d’une idéologie, un moyen puissant de roublardise, l’écriture. Dans les archives de la police de Bahia, j’ai ri quand j’ai lu que les maîtres croyaient tous leurs esclaves illettrés, jusqu’au jour où ils ont découvert que les talismans qui circulaient parmi eux étaient des messages qu’ils se passaient en arabe. Belle leçon, n’est ce pas ? Le naïf n’est pas toujours celui qu’on croit, et il a fallu du culot aux esclaves musulmans de Bahia pour élaborer leur stratégie de révolte qui a failli réussir.
La suite de l'interview est disponible sur le blog de Lareus Gangoueus: http://gangoueus.blogspot.com/2009/09/interview-de-kangni-alem-sur-esclaves.html
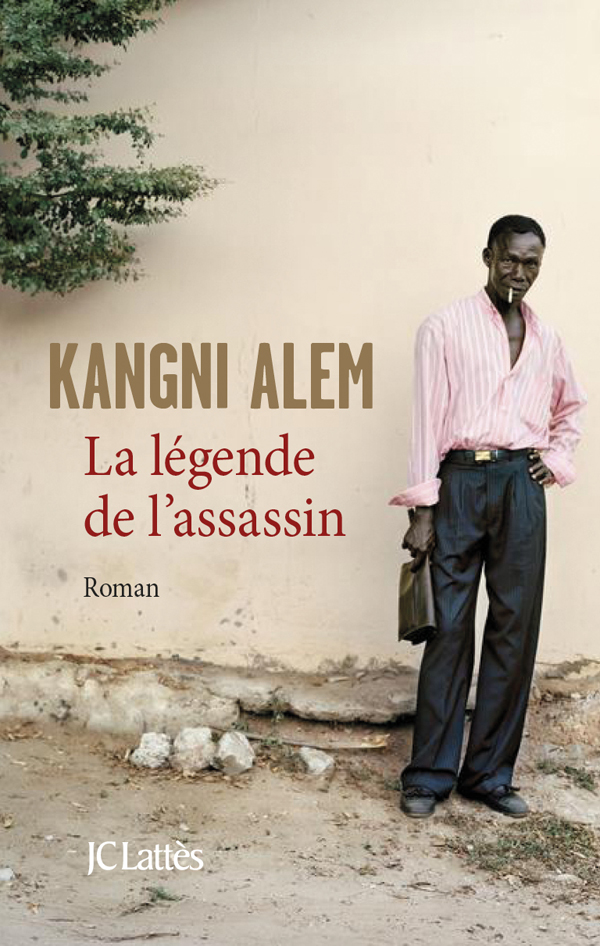 TiBrava, 14 octobre 1978, à la plage, un homme, mains ficelées dans le dos, et le buste attaché au tronc d’un cocotier, fut exécuté pour avoir décapité un jeune imam, Bouraïma. Cet homme-là s’appelait K.A.
TiBrava, 14 octobre 1978, à la plage, un homme, mains ficelées dans le dos, et le buste attaché au tronc d’un cocotier, fut exécuté pour avoir décapité un jeune imam, Bouraïma. Cet homme-là s’appelait K.A.




 Nii Ayikwei Parkes, vous ne le connaissiez pas avant, n’est-ce pas ? Moi non plus. Ma lecture du roman ghanéen en était restée à Kodjo Laing et ses airs de ”social science fiction”. Mais voilà qu’avec ce livre traduit de l’anglais par la béninoise Sika Fakambi, je découvre un auteur de polar bien sous tous rapports. Notre quelque part (Zulma, 2014) se lit comme un épisode de la série Les Experts transplanté sous les tropiques. Une jeune fille en vadrouille dans le village de Sonokrom poursuit un bel oiseau au plumage bleu et entre par hasard dans une case. Ce qu’elle découvre ? Un amas de chair et de viscères, de lymphe, une chose innommable qui bouge. Alertée, la police d’Accra débarque et conclut à un possible meurtre. Le propriétaire de la case, un certain Kofi Ata, parti en brousse, selon les villageois, ne serait pas encore de retour. L’affaire est confiée par le patron de la criminelle au jeune inspecteur Kayo, médecin légiste formé en Angleterre, qui trompe son ennui dans un laboratoire de biologie à Accra. Kayo, qui a toujours rêvé de rejoindre la criminelle et s’est fait blackbouler à chaque tentative rechigne. Il sera contraint d’accepter le job, par le chantage. Car cette affaire est une aubaine pour l’inspecteur Donkor, patron de la criminelle : il s’agit de retrouver qui se cache derrière la chose innommable, et, si possible, prouver qu’il s’agit d’un meurtre, en exhibant un coupable à n’importe quel prix ! Ce qui a priori a l’air simple va se révéler corsé comme une devinette akan. Ici, l’enquête est sophistiquée, basée sur l’utilisation de la recherche ADN. Mais que vaut la science devant la roublardise des villageois ? Toute la substantifique moelle du récit d’Ayikwei Parkes est là, dans ce jeu de cache-cache entre le jeune inspecteur et les villageois, notamment entre Kayo et le narrateur, le rusé Yao Pokou. « Nos Sages disent toujours que, parfois, lorsque le mal commis est plus grand que nous, la justice doit quitter nos mains. » L’enquêteur découvre vite ce que la maxime cache de terrible vérité. Notre quelque part est écrit comme un spoken word en ewe et en twi, mieux un slam intelligent qui a des phases de suspense digne des grands récits initiatiques. Les chapitres suivent l’ordre des jours de la semaine : nawƆtwe, kwasida, dwodwa… fida… Clin d’œil à ceux qui comprennent la langue !
Nii Ayikwei Parkes, vous ne le connaissiez pas avant, n’est-ce pas ? Moi non plus. Ma lecture du roman ghanéen en était restée à Kodjo Laing et ses airs de ”social science fiction”. Mais voilà qu’avec ce livre traduit de l’anglais par la béninoise Sika Fakambi, je découvre un auteur de polar bien sous tous rapports. Notre quelque part (Zulma, 2014) se lit comme un épisode de la série Les Experts transplanté sous les tropiques. Une jeune fille en vadrouille dans le village de Sonokrom poursuit un bel oiseau au plumage bleu et entre par hasard dans une case. Ce qu’elle découvre ? Un amas de chair et de viscères, de lymphe, une chose innommable qui bouge. Alertée, la police d’Accra débarque et conclut à un possible meurtre. Le propriétaire de la case, un certain Kofi Ata, parti en brousse, selon les villageois, ne serait pas encore de retour. L’affaire est confiée par le patron de la criminelle au jeune inspecteur Kayo, médecin légiste formé en Angleterre, qui trompe son ennui dans un laboratoire de biologie à Accra. Kayo, qui a toujours rêvé de rejoindre la criminelle et s’est fait blackbouler à chaque tentative rechigne. Il sera contraint d’accepter le job, par le chantage. Car cette affaire est une aubaine pour l’inspecteur Donkor, patron de la criminelle : il s’agit de retrouver qui se cache derrière la chose innommable, et, si possible, prouver qu’il s’agit d’un meurtre, en exhibant un coupable à n’importe quel prix ! Ce qui a priori a l’air simple va se révéler corsé comme une devinette akan. Ici, l’enquête est sophistiquée, basée sur l’utilisation de la recherche ADN. Mais que vaut la science devant la roublardise des villageois ? Toute la substantifique moelle du récit d’Ayikwei Parkes est là, dans ce jeu de cache-cache entre le jeune inspecteur et les villageois, notamment entre Kayo et le narrateur, le rusé Yao Pokou. « Nos Sages disent toujours que, parfois, lorsque le mal commis est plus grand que nous, la justice doit quitter nos mains. » L’enquêteur découvre vite ce que la maxime cache de terrible vérité. Notre quelque part est écrit comme un spoken word en ewe et en twi, mieux un slam intelligent qui a des phases de suspense digne des grands récits initiatiques. Les chapitres suivent l’ordre des jours de la semaine : nawƆtwe, kwasida, dwodwa… fida… Clin d’œil à ceux qui comprennent la langue !
