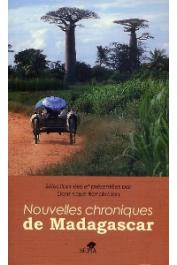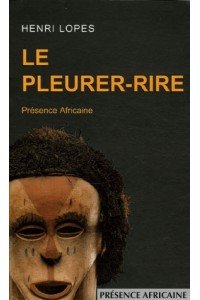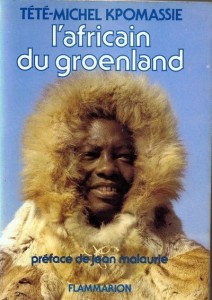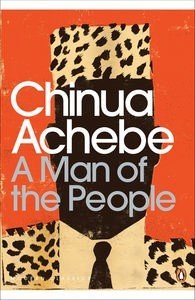D'une plume alerte et non dépourvue d'humour, Laure Lugon Zugravu propose ici un réquisitoire impitoyable contre les dysfonctions de l'aide humanitaire. Le déséquilibre des échanges avec l'Afrique et la subordination du monde diplomatique à la raison d'Etat ont précipité le continent dans un univers pétri de violence et d'arbitraire. Dès lors, les abus de pouvoir, l'impéritie, la corruption, les assassinats, le sexe, la déprime et les folles amours qui s'entremêlent dans cet ouvrage soulignent les dérives et les déroutes du monde d'aujourd'hui. Ils dénoncent en particulier l'exploitation sauvage du Congo, le rôle ambigu du journalisme d'investigation et le désarroi des gens dépêchés sur place.
D'une plume alerte et non dépourvue d'humour, Laure Lugon Zugravu propose ici un réquisitoire impitoyable contre les dysfonctions de l'aide humanitaire. Le déséquilibre des échanges avec l'Afrique et la subordination du monde diplomatique à la raison d'Etat ont précipité le continent dans un univers pétri de violence et d'arbitraire. Dès lors, les abus de pouvoir, l'impéritie, la corruption, les assassinats, le sexe, la déprime et les folles amours qui s'entremêlent dans cet ouvrage soulignent les dérives et les déroutes du monde d'aujourd'hui. Ils dénoncent en particulier l'exploitation sauvage du Congo, le rôle ambigu du journalisme d'investigation et le désarroi des gens dépêchés sur place.
Le début du roman nous transporte à l'Ambassade de France de Kinshasa où un groupe hétéroclite d'expatriés « que l'Afrique avait chiffonnés, abîmés, vaincus » (p.9) gravitent autour de l'Ambassadeur de France en compagnie de quelques journalistes, d'une poignée de consultants égarés en terre africaine, de responsables d'ONG et de mercantis locaux. C'est là que Giulia, une journaliste indépendante d'une trentaine d'années établie au Congo tombe amoureuse d'un correspondant de guerre de passage et accepte de lui donner un coup de main pour une enquête délicate.
La liaison passionnée, mais de courte durée, de Giulia et Gaétan sert de fil rouge au roman. Le passage de Gaétan à Kinshasa et ses déplacements en RDC offrent à la narratrice l'occasion d'évoquer la vie des expatriés de la capitale et les questions importantes qui agitent le pays: les cocktails auxquels Gaétan est convié soulignent la vacuité des relations sociales et la superficialité des personnes en présence; sa poursuite inlassable de faits divers susceptibles d'intéresser le grand public met en évidence les partis pris et les défauts d'une information manipulée à tous les échelons de sa production; et le voyage qu'il entreprend avec Giulia dans une province éloignée en quête de scoops, permet à la narratrice de dénoncer les innombrables abus dont sont victimes les populations locales, l'exploitation éhontée des enfants, les grenouillages, les impostures, les massacres de populations civiles, le détournement de l'aide alimentaire et les assassinats politico-économiques commandités par des compagnies minières pillant impunément les ressources du pays.
D'innombrables malheurs contribuent à l'effondrement de la région mais c'est moins le résultat désastreux d'un interventionnisme délétère qui irrite l'auteure que l'indifférence et le cynisme dont font preuve les différents acteurs associés au pillage. Face aux souffrances et à la misère engendrées par leurs coupables entreprises ou leur laisser-faire, les âmes damnées du système oublient tout et ne pensent plus qu'à elles-mêmes. L'intérêt calculé de Gaétan pour autrui n'est qu'un cas parmi d'autres. Lorsqu'il apprend, par exemple, qu'un groupe d'hommes d'affaires chinois vient d'être massacré par une quelconque milice dans la province du Kasaï, sa première réaction n'est pas de compatir à la mort violente d'innocentes victimes mais de se réjouir de l'aubaine et d'imaginer les avantages qu'il va pouvoir tirer de la situation. « Merci pour l'info, dit-il à son indicateur. Du coup, j'ai une accroche en actu, ça tombe bien » (p.65). Aucune compassion pour les défunts et leurs familles. Juste une totale indifférence aux conséquences humaines de la tragédie. De même, lorsqu'il se trouve face à face avec un groupe d'enfants remontant des tréfonds d'une mine de diamants où ils sont contraints de travailler sous la surveillance de milices armées, il ne pense ni au sort de ces esclaves des temps modernes ni à la précarité de leur situation. Non, il pense aux images qu'il va être en mesure de vendre à bon prix à une agence de presse. Le cœur sec, il montre à cette occasion, comme lorsqu'on lui signale l'assassinat « des ingénieurs chinois dégommés au Kazaï » (p.65), que le monde auquel il appartient a perdu le sens des valeurs humaines :
« Le soleil était bas, ciel fuyant, orange, parfaite lumière. En une heure, il aurait son sujet. Remontés lentement des bas-fonds miniers, les gamins couverts de poussière s'en allaient, disloqués, s'abreuver dans une auge en fer battu remplie d'eau saumâtre, bovins fatigués. Gaétan cadra serré sur la tête d'un gamin, bête de somme humaine sur fond de savane africaine d'une indécente beauté. Cette photo-là, légèrement poudrée par la poussière en suspension, était bonne » (pp.66-68)
L'égocentrisme et l'absence de préoccupations morales de Gaétan ne font pas figure d'exception dans un univers dominé par l'arbitraire. Quasiment tous les personnages du roman ont battu en retraite derrière une armure de froide indifférence.
En sus d'une galerie de personnages à la psychologie nuancée et d'une intrigue bien ficelée, il convient de relever le style incisif et plein d'esprit de l'auteure qui participe lui aussi au plaisir de la lecture. Dépeignant les « fossoyeurs du continent » avec une verve et un humour impitoyables, la narratrice joue avec les sentiments contradictoires du lecteur qui ne sait souvent plus s'il doit rire ou pleurer. Quelques lignes évoquant Joyce Wagram, une écologiste fanatique et héritière d'un magnat de l'industrie américaine, en offrent une illustration :
« Joyce Wagram, elle, portait des espadrilles. Cousues main par de faux bergers du Larzac avec de la vraie corde de chanvre cent pour cent naturelle et garantie bio, rouies dans de l'eau croupie puis teillées sans machine, bien entendu. […] Echouée en RDC après des mois de voyage en transport public avec une poignée de bergers qui s'ennuyaient ferme à évangéliser les chèvres des hauts plateaux des Grands Causses, elle avait trouvé, au lieu de bons sauvages dont elle espérait le salut du monde, des pauvres – et c'était bien leur seul mérite – qui se seraient damnés pour une bagnole ou un téléphone portable. Elle en avait alors conçu un mépris aussi puissant qu'à l'endroit des nantis. » (p.38)
Ces propos satiriques invitent au rire. Mais un rire qui se transforme rapidement en rictus car les chimères de Joyce n'expriment que trop bien un imaginaire occidental truffé de clichés et vigoureusement défendus par une armée de groupes d'influence prêts à voler au secours de l'Afrique mais incapables de prendre en compte les aspirations légitimes des Africains.
De très nombreux ouvrages ont souligné les abus des multinationales qui pillent impunément le continent; autant ont dénoncé les lacunes de l'aide humanitaire et l'inanité de la diplomatie en Afrique face aux défis de la mondialisation; mais peu de livres offrent une image aussi évocatrice et incisive du dépouillement complet des valeurs humaines que la course aux matières premières et « l'aide au Tiers-monde » infligent au Congo et au reste du monde. A lire.
 Laure Lugon Zugravu est née en 1968 en Valais. Elle est journaliste en Suisse romande. Reporter de guerre entre 1997 et 2002, elle publie Au Crayon dans la marge, récits de son expérience journalistique dans les zones de conflits. Déroutes, publié en 2011 fait suite à ce premier récit, et Lugon Zugravu indifférente aux polémiques qui ont reçu son premier roman, poursuit son chemin. Laure Lugon Zugravu est née en 1968 en Valais. Elle est journaliste en Suisse romande. Reporter de guerre entre 1997 et 2002, elle publie Au Crayon dans la marge, récits de son expérience journalistique dans les zones de conflits. Déroutes, publié en 2011 fait suite à ce premier récit, et Lugon Zugravu indifférente aux polémiques qui ont reçu son premier roman, poursuit son chemin.
|
"Déroutes", un roman de Laure LUGON ZUGRAVU
Genève: Editions faim de siècle & cousu mouche, 2011. (172p.). ISBN: 978-2-940422-11-1
Compte rendu de Jean-Marie Volet — février 2013
Publié initialement et en version longue sur http://aflit.arts.uwa.edu.au/reviewfr_lugon13.html

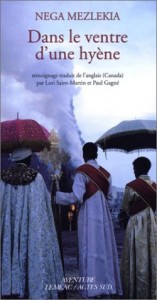 C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.
C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.