Je me souviens de cette autre question que vous m’aviez posée, Madame : « Vous considérez-vous comme un écrivain engagé ? » Avant que je ne vous eusse répondu, vous m’aviez cité vos exemples d’écrivains noirs engagés : Mongo Béti et Wole Soyinka. Et vous aviez ajouté : « On a l’impression que les écrivains africains de la nouvelle génération sont un peu plus individualistes, plus préoccupés par la question de leur visibilité que par le destin de leur pays et de leur continent. Ils ont cessé d’être la voix de leurs peuples, dans un monde pourtant marqué par la marginalité encore plus grande de l’Afrique, dans un monde qui voit ce continent retourner à ses démons : les atrocités et les barbaries chroniques. Croyez-vous, monsieur Tchak, qu’un écrivain africain, comme vous, a le droit, je dirais le luxe, de nous décrire les yeux de sa femme alors que les Éthiopiens meurent de faim et qu’on a mangé des pygmées en République Démocratique du Congo ? ».
 Chère Madame, ma réponse ne vous plaira pas, je vous la donne quand même. Récemment, pour écrire un texte de commande sur le Darfour, je me suis retrouvé devant mon écran d’ordinaire tout en fixant le dos d’un livre en particulier dans ma bibliothèque : La littérature et le mal de Georges Bataille [Lien vidéo]. Et cela m’inspira une réflexion sur moi-même, sur mon rapport aux tragédies dans certains pays africains. Par-delà moi, les écrivains et artistes que nous avons la prétention d’être. Quel est réellement l’impact de nos mots quand nous oublions les stratégies de placement, les petites comédies d’un milieu qui a la grandeur et la misère de tous les petits milieux ? Si en tant qu’êtres humains, nous parvenions à éviter d’être acteurs directs du mal, jusqu’où pouvons-nous empêcher qu’il soit commis ? Jusqu’où notre prétention à décrypter le monde nous permet-elle de prévoir des tragédies ? Jusqu’où nous aurions par exemple pu prévoir le Rwanda, le Darfour, la Côte d’Ivoire ? Je me suis demandé et je me demande toujours : après ces années de massacres au Darfour, ma voix enfin levée est-elle en moi le tardif sursaut de l’humain ou s’agit-il juste d’un travail de charognard : faire mon beurre sur les cadavres et les larmes ? En termes clairs, quand je me mettrai à parler du Darfour, à quoi cela servirait-il ? Ầ la compréhension du problème ? Ầ sa résolution ? Ou à ma propre visibilité, dans la mesure où la voix d’un écrivain mêlée à une actualité brûlante peut apporter une popularité supplémentaire à l’écrivain ?
Chère Madame, ma réponse ne vous plaira pas, je vous la donne quand même. Récemment, pour écrire un texte de commande sur le Darfour, je me suis retrouvé devant mon écran d’ordinaire tout en fixant le dos d’un livre en particulier dans ma bibliothèque : La littérature et le mal de Georges Bataille [Lien vidéo]. Et cela m’inspira une réflexion sur moi-même, sur mon rapport aux tragédies dans certains pays africains. Par-delà moi, les écrivains et artistes que nous avons la prétention d’être. Quel est réellement l’impact de nos mots quand nous oublions les stratégies de placement, les petites comédies d’un milieu qui a la grandeur et la misère de tous les petits milieux ? Si en tant qu’êtres humains, nous parvenions à éviter d’être acteurs directs du mal, jusqu’où pouvons-nous empêcher qu’il soit commis ? Jusqu’où notre prétention à décrypter le monde nous permet-elle de prévoir des tragédies ? Jusqu’où nous aurions par exemple pu prévoir le Rwanda, le Darfour, la Côte d’Ivoire ? Je me suis demandé et je me demande toujours : après ces années de massacres au Darfour, ma voix enfin levée est-elle en moi le tardif sursaut de l’humain ou s’agit-il juste d’un travail de charognard : faire mon beurre sur les cadavres et les larmes ? En termes clairs, quand je me mettrai à parler du Darfour, à quoi cela servirait-il ? Ầ la compréhension du problème ? Ầ sa résolution ? Ou à ma propre visibilité, dans la mesure où la voix d’un écrivain mêlée à une actualité brûlante peut apporter une popularité supplémentaire à l’écrivain ?
Je me pose ces questions, qui ne peuvent paraître inutiles qu’aux yeux des écrivains imbus d’eux-mêmes et qui n’ont pas encore pris conscience de leur manque total de poids non seulement dans le milieu littéraire, mais aussi et surtout dans le monde. Or, que met en action un artiste pour faire avancer une cause ? Sa notoriété. Quelle cause peut faire avancer un écrivain sans notoriété ? Voici le sens de ma question. Et que peuvent faire, même réunis avec leur bonne volonté, des écrivains sans notoriété ? J’ai éteint mon ordinateur et je me suis installé devant la télé. Je ne comprends rien au problème du Darfour, je tente de le comprendre. Je ne vois pas ce que je peux réellement faire et à quoi servirait le texte que je bricolerais. Si j’avais été Nelson Mandela, si j’avais été Youssou N’Dour, j’aurais pu mêler ma voix au concert des voix déjà audibles au sujet de ce conflit. Et, peut-être, aurais-je pu faire bouger les choses ne serait-ce qu’au rythme où avancent les cadavres.
Le rôle social et politique de la littérature semble aller de soi lorsque les auteurs viennent non seulement des pays à problèmes, mais sont aussi perçus, ou se définissent eux-mêmes, comme porte-parole des sans-voix, comme écho noble d'une conscience collective qui émerge à peine dans la conscience du monde. Les œuvres qui en sont issues auront alors le fardeau de répondre à des questions concrètes, elles subiront l'abaissante lecture sociologique et politique, donc seront situées dans la temporalité d'une cause, d'une fonctionnalité qui éclipse, si elles en ont, ce qui leur vaut en réalité leur statut d'œuvres littéraires, c'est-à-dire leur exigence esthétique. On aura par exemple vite fait de dire que Mongo Beti était un auteur engagé, ce qui pour certains signifierait un écrivain conscient de son devoir envers son peuple, donc digne de respect, et pour d'autres un écrivain d'un intérêt limité, pour ne pas dire mineur, qu'on n'a pas besoin de lire, puisqu'on sait ce que cela vaut. On réduit sa plume à sa gueule, sa plume dense, magnifique. L'engagement couplé à la littérature renvoie donc assez souvent à des visions ambiguës de légitimation et de déclassement par rapport à une certaine norme. Or, lorsqu'on dit d'un écrivain qu'il est engagé, à supposer qu'il le soit réellement, il reste toujours à préciser s'il l'est par son écriture et/ou par sa personne.
Pour ma part, je fais cette distinction entre une littérature dite engagée et un écrivain qui peut être engagé sans forcément engager son œuvre ou engager celle-ci sans s'engager lui-même. Dans tous les cas, l'engagement est souvent favorisé par certains contextes historiques, sociaux, politiques… Il s'impose plutôt à certaines personnes qui ont eu la chance ou le malheur de rencontrer l'Histoire dans ce qu'elle peut avoir d'universellement tragique. Les écrivains noirs américains, franco-antillais et guyanais, africains : Wright, Baldwin, Himes, Césaire, Damas, Fanon, Senghor, Gordimer, Brink, Coetzee, et bien d'autres dans le monde, ont émergé à l'écriture dans la prise de conscience directe des grandes tragédies mondiales ou particulières à leur pays, touchant directement ou non à leur propre place au sein de la société. Pour ceux que nous avons cités, le racisme sous toutes ses formes et le sort envisagé ou réservé à certains peuples à cause de la couleur de leur peau, ont sans aucun doute rendu incontournable un combat par la plume, donc l'émergence d'une littérature qui favorise une prise de conscience collective, l'ancrage d'une identité particulière au sein des identités mondiales. Si les peuples ne se libèrent réellement de tous les jougs qu'en donnant une part de leur sang, ils ont dans certains cas bénéficié du secours de ces armes miraculeuses que sont les romans, les poèmes, les pamphlets qui, sans faire l'effet direct des bombes, peuvent introduire dans les mailles des instances répressives et discriminantes comme une substance brutalement ou lentement corrosive.
Les livres ont parfois été les armes d'une catégorie particulière de maquisards, d'hommes et de femmes qui, grâce à leurs dons singuliers, ont peint avec une beauté rare les démons de leur société tout en offrant à voir l'universelle condition humaine dans sa part d'enfer. Ils ont exhumé l'insoutenable pour venir à bout des silences complices, pour susciter des révoltes, le vrai combat. Car l'œuvre engagée est, de mon point de vue, celle qui porte clairement la volonté de son auteur de changer les choses. Fanon voulait changer le monde, il écrivait pour cela. Nadine Gordimer voulait changer l'Afrique du sud et elle a contribué à son changement. Et c'est cette volonté claire qui explique que généralement, les textes ne suffisent pas, leurs auteurs aussi les accompagnent dans le combat de leur propre notoriété, de leur propre personne, ils s'engagent, ils deviennent militants, acteurs, à leurs risques et périls.
Beaucoup d'écrivains engagés ont été contraints à l'exil ou ont connu les ténèbres des prisons. Certains ont été fusillés ou pendus… Hugo, Soyinka, Ken Saro-Wiwa, et bien d'autres avant eux avaient eu à payer de leur vie ou d'une partie de leur liberté leur engagement pour des causes qu'ils estiment justes. D'autres paient actuellement ou paieront toujours. Ceci pour souligner la permanence, l'universalité et la nécessité de l'engagement des écrivains, et d'autres catégories de citoyens dont l'activité favorise une certaine notoriété. Mais la nécessité de l'engagement peut-elle rendre celui-ci obligatoire ? Peut-on raconter les cabrioles de son chat dans un pays qui vit un génocide ? Aurait-on pu par exemple chanter les yeux d'une belle femme par une saison de machettes au Rwanda ? Bref, l'art peut-il côtoyer l'horreur sans s'en émouvoir ? C'est peut-être à ce niveau qu'un débat semble s'amorcer dans le milieu des écrivains africains dits de la nouvelle génération, si l'on se réfère à la polémique entre les écrivains franco-congolais Alain Mabanckou et franco-malgache Jean-Luc Raharimanana, polémique qui n'est que l'écho d'un débat longtemps amorcé, ravivé au Tchad en octobre 2003 lors du Fest'Africa sous les Étoiles. De telles polémiques, au-delà de la pertinence des points de vue des uns et des autres, sont en elles-mêmes significatives d'une réalité : une génération qui se cherche, qui tente de définir son rôle, sa place dans l'Histoire actuelle, et qui, parfois, dans un souci de se démarquer des aînés, dont l'ombre est encore pesante, ou de s'en revendiquer, impose à la littérature un discours qui ne la concerne pas forcément. Si l'engagement est une nécessité, peut-il devenir une obligation ? En d'autres termes, peut-on commander l'engagement ? Quel est déjà son degré de pertinence dans certaines circonstances ?
La plupart des écrivains africains dits de la nouvelle génération, ceux qui jouissent d'une certaine reconnaissance dans un certain milieu, ceux qui sont plus ou moins visibles dans un contexte de marginalité globale, la plupart d'entre eux donc vivent hors de leur pays, et ce depuis de longues périodes. Si leurs aînés, dont Senghor demeure la figure la plus illustre, avaient été à la fois des citoyens assez visibles au cœur des contradictions de la société française et des acteurs de premier rang du destin des jeunes nations africaines, eux ont rarement cette épaisseur de vie. Ils sont plutôt assis entre deux marginalités, entre deux non-existences : cloués aux marges de la société d'accueil, ils s'effacent aussi progressivement de la mémoire de leur propre société pour ceux qui s'y étaient déjà fait une place. Ce n'est pas remettre en cause leur degré de conscience que de soutenir qu'ils ont plutôt, au mieux, une demi-vie.
Quelle pourrait être l'efficacité de leur engagement ? De quelle notoriété disposent-ils au point de la mettre au service de quelle cause ? Ou, pourraient-ils acquérir une certaine notoriété en se servant de certaines causes ? Les complexes questions de survie bassement matérielles ne constituent-elles pas pour nombre d'entre eux peut-être la cause la plus urgente ? Comment leurs œuvres, ce qu'ils considèrent comme leurs œuvres, pourraient-elles entrer dans cette complicité intime avec des consciences nationales dont ils sont pratiquement exclus ? Non lus dans leur pays, est-ce en engageant leur personne qu'ils feront entendre leur voix, au point d'agir profondément sur des consciences ? Enfin, sont-ils nécessaires ici ? Sont-ils nécessaires là-bas ? Le débat ne devrait-il pas porter plus sur leur propre destin, leur situation de dépendance sans fin qui renvoie à la dépendance de leurs pays d'origine et leur marginalité absolument logique ?
Il ne me semble pas nécessaire de répondre à ces questions qui pourraient orienter un autre débat : le destin des écrivains venant des périphéries. Dans le meilleur des cas, il arrive que des écrivains " exilés ", dont l'œuvre alimente l'hostilité consensuelle d'une large opinion envers les dirigeants de leur pays d'origine, jouissent d'un succès que ne justifie pas toujours la qualité de leurs œuvres. Ils servent d'une certaine manière de caution aux discours convenus. Formant comme des groupes d'engagés, ils deviennent une diaspora littéraire qui ne réfléchit pas toujours ou pas assez profondément sur sa propre misère. Or, généralement, quel est son destin ? Une littérature en marge de la littérature du pays d'accueil, qui peut devenir occasionnellement un bon produit commercial, mais ne s'ancre jamais dans le patrimoine culturel qui lui prête pour une durée limitée sa caution auprès des instances légitimatrices, alors qu'elle n'a nul écho dans le pays d'origine des auteurs. On a ainsi l'impression de nains qui s'illusionnent sur leur taille et croient brandir pour effrayer les démons qu'ils ont fui des épouvantails dont même les gosses riraient. Ils sont engagés, mais contre quoi et pour qui ? Leur isolement favorise généralement un militantisme du vide, c'est-à-dire une grande débauche d'énergie pour des discours progressivement désincarnés ou qui finissent par ne plus parler que de leurs auteurs et d'eux seuls. La bonne foi, pour ceux qui en ont, ne les protège pas toujours contre le risque de l'assèchement du sens dans leurs plaidoiries. L'injure suprême qui leur est faite, c'est dans certains cas, le "Vous, vous ne comprenez plus rien à notre pays", qu'on leur jette à la figure dans leur propre pays, alors que nulle part ailleurs ils n'ont réellement pu faire racine. Aussi, leur destin littéraire lui-même tient-il aux circonstances qui l'ont favorisé.
Aux États-Unis, en Espagne, ailleurs, certains auteurs cubains par exemple construisent une œuvre si liée à Castro qu'elle pourrait cesser d'intéresser quand tarira leur source. Ce tableau sombre au sujet de l'écrivain dit exilé ne peut faire oublier le destin des écrivains "locaux", ceux qui ne sont pas partis, ceux qui sont restés au pays. Plus en phase avec les réalités sociales et politiques qui pourraient conférer à une œuvre son authenticité et lui permettre d'entretenir avec un peuple une relation passionnelle (le roman La Marche en crabe de Günter Grass s'est vendu, à sa sortie en Allemagne, à quatre cent mille exemplaires en une semaine – au-delà du fait qu'il s'agit ici d'un écrivain mondialement connu, prix Nobel, c'est aussi qu'un auteur et son peuple se sont réellement rencontrés avec ce livre qui rappelle leur tragédie commune, ils se sont parlés directement aux tripes), oui, plus en phase avec les réalités qui font la puissance de certaines œuvres, sont-ils pour autant mieux lotis dans des pays plus qu'en faillite ? Quelle que soit la qualité de leurs œuvres, quel impact peuvent-elles avoir dans des sociétés qui ne les entendent pas ? Quel rôle peut jouer un écrivain dans son pays où l'écrivain n'a de statut que pour lui-même ? Quel rôle peuvent jouer ces marginaux parmi les marginaux, ces pauvres parmi les pauvres qui, après avoir écrit dans des conditions parfois pénibles, doivent ensuite réunir des fonds pour publier leurs textes à compte d'auteurs chez des éditeurs locaux n'ayant pour la plupart aucun circuit de diffusion ? Ont-ils un destin s'ils ne devenaient, même en vivant chez eux, des écrivains révélés ailleurs ?
La question, qu'il s'agisse d'un écrivain parti ou resté, quand on parle particulièrement de l'Afrique, la question est celle-ci : un écrivain, c'est quoi ça ? Ahmadou Kourouma, Mongo Beti, eux, pourtant très connus, eux aussi ont eu à le comprendre, chacun à son heure, chacun à sa manière, avant de se suivre vers le royaume où personne n'est engagé, là où tout s'apaise peut-être ! Mais pour revenir à l'engagement, en partant de l'idée qu'il n'est ni à recommander ni à être perçu avec une condescendance insultante, je soutiens que lorsqu'on parle de littérature, on parle de la création du beau, on parle de l'art. Si ce point de base n'est pas oublié, on jugera forcément une œuvre littéraire à partir de sa cohérence interne, de sa capacité à faire coïncider les particuliers et l'universel, à offrir une lecture originale de la condition humaine.
Certaines œuvres engagées n'ont survécu que parce qu'au-delà des causes immédiates qui les ont inspirées, elles ont échappé au cadre géographique de leur inspiration et à l'acide du temps. Relire par exemple aujourd'hui Amour, colère et folie de Marie Chauvet, est toujours source d'un grand plaisir, de grandes émotions, parce qu'au-delà des situations passées et actuelles d'Haïti, il s'agit d'une œuvre qui nous parle intimement, qui descend au plus profond de nous, au-delà des âges, des sexes et de la couleur de la peau. Cahier d'un retour au pays natal de Césaire conserve sa beauté et sa puissance qu'elle doit au Verbe. C'est tout simplement un très, très grand texte. Ce sont ces exigences-là, qui ne se décrètent pas, ce sont elles qui font de certaines œuvres engagées des œuvres littéraires tout court, des œuvres durables, parfois immortelles, pour autant qu'un mortel peut décréter l'immortalité. Césaire, Senghor, Damas, Brink, Jacques-Stephen Alexis, Boulgakov, Soljenitsyne, Lezama Lima, Arenas, Glissant, etc., ont eu, pour la plupart d'entre eux, une très grande conscience de la tragédie de leur peuple, mais en en faisant la peinture, ils ont touché l'Homme. En d'autres termes, ce qu'il reste de leurs textes au fur et à mesure qu'ils s'enlisent dans le temps, c'est leur valeur esthétique et leur dimension universelle.
Tous les débats ont leur utilité peut-être, mais les écrivains ne doivent pas oublier que la littérature, engagée ou pas, a ses propres exigences, que ce n'est pas forcément avec un cœur gros comme une montagne qu'on bâtit une œuvre puissante. Les bonnes intentions ne sont pas un obstacle à la bonne littérature, mais elles n'accouchent pas forcément du Voyage au bout de la nuit. Je soutiens donc que lorsqu'on parle de littérature, on parle aussi d'art. Si ce point n'est pas oublié, on jugera forcément une œuvre littéraire à partir de sa cohérence interne, de sa capacité à faire coïncider le particulier et l'universel, à offrir une lecture originale de la condition humaine. Mais l’engagement d’un écrivain médiocre peut être touchant sans que cela change notre jugement sur sa prétendue œuvre.
 L’écrivain Boubacar Boris Diop est une figure importante de la littérature africaine de langue française. On pourrait évoquer de multiples raisons pour situer l’importance du travail de l’intellectuel sénégalais qui, au-delà d’être un prosateur de talent, est avant tout un homme engagé qui n’a pas peur d’exprimer une opinion sur une place publique francophone dont les tenants et les aboutissants ne sont pas toujours clairement identifiables. Il est l’un des très grands romanciers africains à résider sur le continent et les nouvelles de La nuit de l’Imoko traduisent bien cet ancrage dans un terroir dont il hume chaque jour les senteurs, dont il ressent constamment la pulsion de vie et les injustices.
L’écrivain Boubacar Boris Diop est une figure importante de la littérature africaine de langue française. On pourrait évoquer de multiples raisons pour situer l’importance du travail de l’intellectuel sénégalais qui, au-delà d’être un prosateur de talent, est avant tout un homme engagé qui n’a pas peur d’exprimer une opinion sur une place publique francophone dont les tenants et les aboutissants ne sont pas toujours clairement identifiables. Il est l’un des très grands romanciers africains à résider sur le continent et les nouvelles de La nuit de l’Imoko traduisent bien cet ancrage dans un terroir dont il hume chaque jour les senteurs, dont il ressent constamment la pulsion de vie et les injustices.

 Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
 Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)
Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)

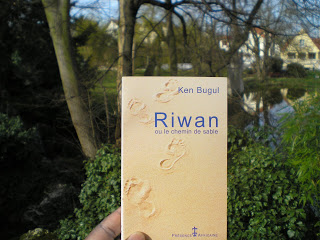


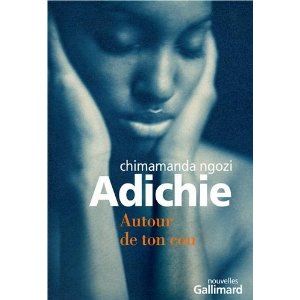
 Chimamanda Ngozi Adichie est née au Nigeria en 1977. Elle est l'auteur de trois romans, l'Hibiscus Pourpre (2003), L'Autre Moitié du Soleil (2006), et Americanah (2013), d'un recueil de nouvelles, Autour de votre cou (2009 – parution en langue originale).
Chimamanda Ngozi Adichie est née au Nigeria en 1977. Elle est l'auteur de trois romans, l'Hibiscus Pourpre (2003), L'Autre Moitié du Soleil (2006), et Americanah (2013), d'un recueil de nouvelles, Autour de votre cou (2009 – parution en langue originale).
