Moins de 48h…
C’est ce qu’il m’a fallu pour lire, dévorer devrais-je dire, les 335 pages de “Un Dieu et des Moeurs” de mon ami et compatriote El Hadji Souleymane Gassama alias Elgas. 97 pages le premier jour, les 238 pages suivantes le lendemain. D’une traite. Cela faisait pourtant deux ans que je n’avais plus terminé un livre, même en étalant sa lecture sur plusieurs mois, même s’il ne faisait que 100 pages, même s’il s’agissait d’une relecture du grand Cheikh Anta Diop. Deux ans. Ainsi, quelques jours après en avoir achevé la lecture et après avoir vécu deux années où aucun livre ne m’avait assez “accroché”, il est évident pour moi, que nous tenons là un très grand écrivain, peut être l’un des plus grands que le Sénégal n’ait jamais enfanté. Oui, rien que ça.
Que dire de ce livre ? Je commencerai par un avertissement : “Un Dieu et des moeurs” est un livre obus qui vise à heurter les consciences sans concession et parfois avec une acidité voulue afin de poser le débat sur la place de la religion (L’Islam) et de la tradition (ancestrale négro-africaine) au Sénégal. Ces deux éléments qui forment ce que nous appelons être “notre culture”, sont pour Elgas la cause fondamentale de la plupart de nos tares : fatalisme face à la misère, déresponsabilisation individuelle, indifférence complice à l’égard de l’exploitation des talibés, persistance de 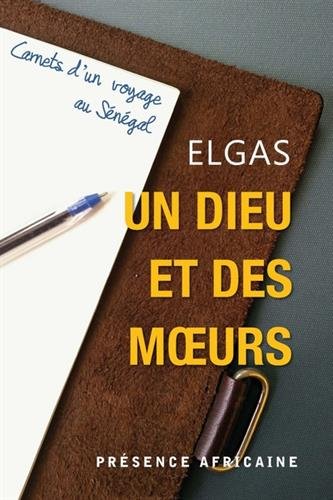 l’excision, des mariages forcés, de la croyance exacerbée dans l’irrationnel et du clanisme familial pour n’en citer que quelques-unes.
l’excision, des mariages forcés, de la croyance exacerbée dans l’irrationnel et du clanisme familial pour n’en citer que quelques-unes.
Un livre obus donc. Un livre cru où l’on sent Elgas tiraillé entre un pessimisme profond sur le devenir de la société sénégalaise et un amour irrationnel pour cette terre dans laquelle il ne se reconnait pourtant presque plus.
“Un Dieu et des moeurs” est aussi un livre construit de manière originale, à mi-chemin entre le carnet de voyages, le journal intime, le roman et l’essai. Un bric-à-brac littéraire diablement entraînant, divisé en deux grandes parties : tableaux d’un séjour et mauvaise foi. Dans Tableaux d’un séjour, Elgas brosse magistralement 15 portraits sociétaux et raconte ses 15 nuits au Sénégal, tableaux où il décrit de manière minutieuse, violente, touchante ou choquante des tranches de vies, comme celle de cette femme à peine trentenaire et déjà mère de 10 enfants, ou encore de ces talibés venus sonner à sa porte sous une pluie battante, tremblotant de froid et d’effroi à l’idée de rentrer tard chez leur “serigne” sans apporter la somme qu’il leur réclame quotidiennement. Une première partie d’une exceptionnelle qualité littéraire, parfois hilarante (L’Huile, le Sexe et les sénégalaises) et renfermant une grande sensibilité où Elgas retranscrit notamment cette lettre émouvante qu’il écrit à son Papa décédé quelques mois auparavant.
La seconde partie intitulée Mauvaise foi, moins volumineuse, et que j’aurai aimé voir développée, traite de la place de la religion dans la société sénégalaise et le dogmatisme progressif qui s’y est installé au détriment de la raison et d’une spiritualité saine ou ouverte comme l’Islam insouciant de son enfance. Elgas y explique en détail ce qu’il appelle le “fanatisme mou”, sorte de violence et d’intolérance silencieuse enfouie en chacun ou presque des musulmans modérés qui composent la majorité des sénégalais. Un avertissement franc, et salutaire du reste, y est également fait sur le morcellement confrérique du Sénégal, la fanatisation d’une partie de la jeunesse et la fragilisation d’un des piliers de la République à savoir la laïcité, rappelant que les germes de la violence religieuse qui a éclaté au sein de pays qui nous sont proches, sont également présents dans notre société et bien plus qu’on ne le pense. Elgas y exprime également un universalisme assumé du point de vue des choix politiques et culturels, point sur lequel lui et moi avons encore des divergences, divergences qui cependant s’effacent devant notre humanisme commun et l’urgence des défis sociétaux internes que les africains, représentés par les sénégalais dans ce livre, se doivent de relever avec courage et détermination.
On peut avoir l’impression, et je l’ai eue en lisant le livre, qu’Elgas se bat contre tout et contre tout le monde. Il y égratigne en effet les militants panafricanistes et leur “afrocentrisme”, la jeunesse bourgeoise dakaroise qui rejette en façade et uniquement à travers le discours l’Occident et ses valeurs mais qui vit selon ses codes au quotidien. Il attaque également le leg confrérique supposé être à la base de la concorde nationale, les hommes politiques – vus à travers son propre père – pour leur complicité intéressée dans le développement de l’obscurantisme ainsi que les intellectuels pour leurs analyses périphériques qui n’osent pas selon-lui faire une analyse complète et poser le débat, forcément douloureux, de la religion et de la tradition au Sénégal. En réalité, il me semble que ce procédé volontairement vindicatif et corrosif, parfois à la limite de la caricature, vise à susciter un débat autour de la religion et des réactions, qui quelles qu’elles soient, seront toujours plus bénéfiques que le silence assourdissant qui pèse sur la société toute entière. Silence qui, lentement mais surement, l’enfonce dans la misère, le fatalisme et l’obscurantisme. Comme l’a récemment écrit l’autre révélation littéraire de cette année 2015, Mbougar Sarr, “Un Dieu et des moeurs” d’Elgas est un livre salutaire. En effet, la Société sénégalaise, plus que jamais, a besoin de poser le débat de la religion et de la tradition en son sein. Ce livre en est une introduction, violente, mais ô combien brillante, que je vous recommande vivement.
Parole d’un lecteur admiratif.
Fary
Laisser uncommentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués par *



Bravo tres beau texte
Le commentaire de Fary a véritablement exalté mon envie de lire cette analyse introspective de notre société sénégalaise!! Malheureusement il est indisponible à Ziguinchor. Comment faire pour en disposer?