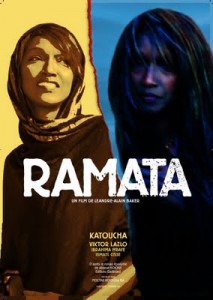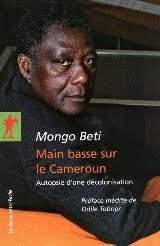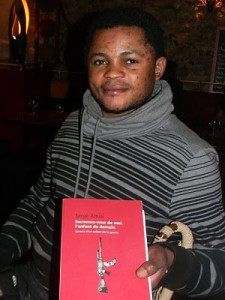Sami Tchak, de son vrai nom Sadamba Tchakoura, est un écrivain togolais lauréat en 2004 du Grand prix littéraire d'Afrique noire. A la suite de la critique de son 7ème roman, Al Capone Le Malien, Sami Tchak répond aux quesitions de Lareus Gangoueus. En gras, les questions de Gangoueus, en clair les réponses du romancier.
Sami Tchak, de son vrai nom Sadamba Tchakoura, est un écrivain togolais lauréat en 2004 du Grand prix littéraire d'Afrique noire. A la suite de la critique de son 7ème roman, Al Capone Le Malien, Sami Tchak répond aux quesitions de Lareus Gangoueus. En gras, les questions de Gangoueus, en clair les réponses du romancier.
Vous avez habitué vos lecteurs à des excursions en Amérique latine dans vos dernières parutions (Hermina, La fête des masques, Paradis des chiots ou Filles de Mexico). Qu’est-ce qui a déterminé, voir dicté ce retour en Afrique ? Est-ce que pour l’auteur que vous êtes, il y a eu des difficultés à écrire dans cet univers ?
Sami Tchak : Je pars de l’idée que chaque créateur s’inspire de tout ce qui, à un moment, l’interroge avec une sorte d’urgence. Parfois, c’est la nouveauté (la découverte) qui le stimule. Je n’ai jamais pensé qu’en tant qu’auteur togolais, il y ait un terrain ou un territoire qui s’impose à moi d’emblée, même si, contrairement à certains commentaires sur moi, je n’ai jamais laissé entendre que mon pays, ou le continent africain, était exclu de mes sources d’inspiration. Pour chaque livre, un événement, un prétexte, une situation, une expérience. L’Amérique latine m’en avait fourni et m’en fournira sans doute encore. Mais le dernier roman est né, lui, d’un moment précis dans ma vie : lorsque je me suis retrouvé à Niagassola (Guinée), dans le compte du magazine Géo, pour un reportage sur le balafon mythique de Soumaoro Kanté, classé par l’UNESCO comme patrimoine mondial immatériel de l’Humanité. D’autres éléments, puisés surtout dans l’histoire récente du Cameroun se sont par la suite introduits dans mes expériences à partir de mes voyages. Le roman est né de là. Et d’autres viendront, si la vie m’en laisse le temps et les moyens, sur ces mêmes sujets dont je tenterai de rendre davantage la complexité.
On retrouve plusieurs éléments déjà présents dans Filles de Mexico. Le premier auquel je pense est la géographie. Ce roman se déroule successivement en Guinée et au Mali avec un épisode assez long au Cameroun. La France est présente aussi. Est-ce votre côté globe-trotter qui influence cette construction géographique de vos histoires ? Ou plutôt un besoin de ne pas zoomer sur une seule cible ?
Sami Tchak : Ces éléments étaient déjà présents dans tous mes autres romans, depuis Place des Fêtes. Je dirais que pour le moment mes personnages sont des êtres assez mobiles, dont les expériences traversent des frontières. Cela ne renvoie pas à un besoin de ne pas « zoomer une cible », mais au fait assez simple que pour le moment c’est de cette manière que je trouve plus adapté de rendre compte des expériences de mes personnages. Un jour, je pourrais écrire aussi un roman dont les actions se déroulent par exemple dans une piaule ou dans une voiture. L’essentiel étant de tenter de jeter un regard relativement personnel sur le monde dans lequel on vit, sur la condition humaine, les sujets littéraires de tous les temps.
Le 2ème élément est ce personnage narrateur, René Cherin, qui fait beaucoup penser à celui de Djibril Nawo de votre précédent roman. Tous deux sont des personnages un peu pommés, se laissant porter par les situations, permettant la libération de la parole et/ou celle de l’action des personnages qu’ils observent. S’agit-il d’un artifice littéraire uniquement ou d’un discours sur la passivité et la rencontre de l’autre ?
Sami Tchak : Là aussi, il s’agit de traits qu’on retrouve chez le héros de Hermina, chez celui de La fête des masques, chez le narrateur principal du Paradis des chiots. Pas forcément des personnages paumés, mais plus des gens qui se laissent emporter, qui suivent, pour certains par une sorte de résignation, pour d’autres par curiosité ou inconscience, mais dans tous les cas c’est de cette manière qu’ils se retrouvent au cœur des secrets des autres, qu’ils voient et restituent le monde devant eux, dont l’impact sur eux devient peut-être l’élément qui les rend originaux. Leurs manières de réagir les singularisent mais aussi dévoilent, peut-être, ce qui en eux, chez eux, est universel.
Une petite différence entre Djibril Nawo et René Cherin. Djibril a des origines togolaises comme vous, alors que René est blanc et il sort de sa campagne bien française, même s’il a vécu dans une de ces banlieues très mondialisées d’Ile de France. A-t-il été difficile pour vous de vous glisser dans la peau de ce personnage ?
Sami Tchak : Entre Djibril Nawo et René Cherin, la différence va au-delà de ces aspects soulignés. Mais cela n’est peut-être pas le plus important. Prenons en compte juste René. Il n’a pas vécu dans une banlieue, mais dans le vingtième arrondissement de Paris, dans un immeuble où en effet il croise des hommes et des femmes venus, pour la plupart d’entre eux, d’ailleurs. Il ne m’a pas été plus difficile, ni plus facile, de me mettre dans la peau d’un journaliste blanc se retrouvant dans des pays africains qu’il ne l’avait été pour moi lorsque j’écrivais dans les années 1980 mon premier roman en faisant parler une femme. C’est le même travail pour tenter de rendre crédibles les voix des gosses d’un quartier difficile d’une capitale latino-américaine ou la voix d’un jeune Français fils d’immigrés africains. Même pour un roman dit autobiographique, je crois que le travail de l’écrivain consiste, entre autres contraintes, à se mettre sous la peau de ses personnages. La véritable question, à mon avis, c’est s’il le réussit toujours !
Il y a comme une sorte d’inversion des rôles – du rapport dominant/dominé – qu’on a du mal à concevoir parfois dans le contexte africain actuel, notamment ce rapport de fascination qui le lie à tous les personnages qui gravitent autour d’Al Capone ?
Sami Tchak : Je ne sais pas si on peut parler de rapport de dominant/dominé, mais il est, en effet, moins fréquent qu’on mette en scène des Blancs, quels qu’ils soient, qui, dans un pays africain, découvrent des personnages qui les fascinent, qui ne viennent pas vers eux comme des mendiants de situation, mais comme des « maîtres » qui les aspirent dans leur monde. Mais la personnalité de René, mieux que la couleur de sa peau, explique la situation qui s’est créée, le rapport vertical entre Al Capone et lui. Le photographe n’a pas éprouvé la même fascination, on peut même parler, de son côté, d’une sorte de répulsion pour le faux prince et ses mœurs. Il est donc resté totalement à l’écart de cet univers, il n’a éprouvé de l’intérêt que pour les paroles de Namane Kouyaté. Peut-être parce que lui, le photographe, était un habitué du terrain, avait déjà établi des liens avec beaucoup de sociétés africaines qu’il interroge pour comprendre leurs vérités les plus ancrées.
Al Capone le Malien est un feyman, un escroc camerounais d’envergure internationale. Comment avez-vous été conduit à créer ce personnage ténébreux, complexe, charismatique, très moderne ?
Sami Tchak : Je me suis inspiré des histoires de feymen qui ont réellement existé, au premier rang desquels Donatien Koagne, celui qu’Al Capone considère comme son dieu. Comme dans mes autres romans, il me faut du concret, à partir duquel ma liberté d’écrivain a un sens.
Une autre figure introduit ce roman, celle de cet ancien diplomate guinéen ; Namane Kouyaté. Homme dévoué passionnément à son épouse et à son art de joueur de balafon et de griot mandingue. Enraciné dans l’histoire, dans la tradition orale, il est antithèse d’Al Capone. Avez-vous souhaité reproduire, en confrontant ces deux personnages, le choc de deux mondes tel que Chinua Achebe, version 2010 ? Une collision frontale entre le matérialisme bling-bling d’Al Capone et l’« archaïsme » d’une culture millénaire incarnée par un balafon enfermé dans une vieille case ?
Sami Tchak : J’ai tenté de montrer la complexité des éléments qui composent nos identités. Bien sûr, il y a une véritable opposition entre les visions du monde de Namane et d’Al Capone, mais ce qui me semble encore plus important, c’est la façon dont ces mondes si antagoniques cohabitent, font la modernité, le dynamisme de nos sociétés. Si on prend le cas de Donatien Koagne, le plus célèbre des feymen, on verra que c’est sur les symboles des sociétés anciennes de son pays qu’il a construit son mythe. Il s’est autoproclamé roi du Cameroun et on le voit habillé comme un roi, avec sa canne, tous les symboles extérieurs qui vont avec, dont l’or. Al Capone, avant qu’on ne sache qui il est, se présente aussi comme un prince venu à Niagassola pour voir un symbole du pouvoir ancien, le balafon. Namane Kouyaté, l’homme toujours en veste et cravate, incarne sans doute une certaine identité, fondée sur ce que le passé a de plus glorieux. Mais c’est aussi un homme de son temps. Les choses sont relativement plus complexes dans la réalité, elles ne peuvent être simples dans les livres qui s’en inspirent.
On pourrait vous reprocher de regarder cet effondrement des valeurs avec une pointe de sarcasme quand vous mettez en scène cette photo avec ces notables de Niagassola qui veulent être immortalisés devant la limousine du feyman… Qu’en pensez-vous ? Y-a-t-il des choses à rattraper ?
Sami Tchak : Pour me reprocher une sorte de sarcasme, il faut me prêter ce sarcasme. C’est ce que je viens de dire : les choses ne sont pas aussi simples, ni dans la réalité, ni dans le livre. Si vous vous référez à un autre moment du livre, vous le remarquerez encore plus aisément : Namane Kouyaté parle d’un féticheur, Moustapha Diallo, assez riche dont l’une des passions consiste à acheter des voitures de luxe. Moustapha Diallo existe réellement, et ce que je dis de lui est authentique. Il vous suffit de chercher sur Internet le féticheur Moustapha Diallo du Mali pour découvrir ce personnage. Ce n’est donc pas parce que les vieux sont bien ancrés dans leurs valeurs qu’ils demeurent insensibles aux symboles actuels de la puissance, de la richesse, du pouvoir. Et il me semble que je regarde l’effondrement de certaines valeurs avec une pointe de tristesse. Je ne sais s’il y a des choses à rattraper, mais il est possible, au moins sur un plan individuel, de ne pas céder facilement à la fascination de tout ce qui brille.
(La suite de l'interview est consultable sur le blog de Gangoueus : http://gangoueus.blogspot.com/2011/02/interview-de-sami-tchak-sur-al-capone.html)
Interview réalisée par Lareus Gangoueus