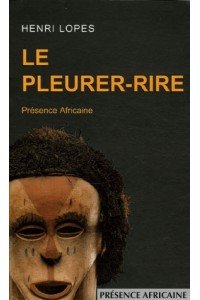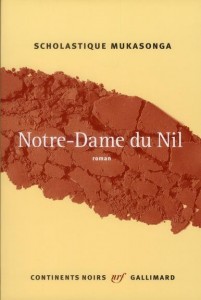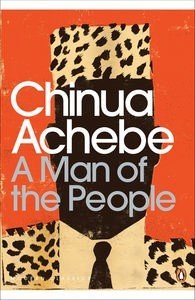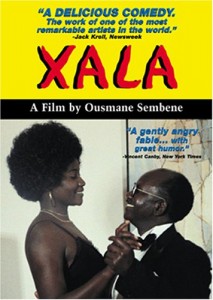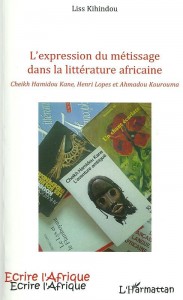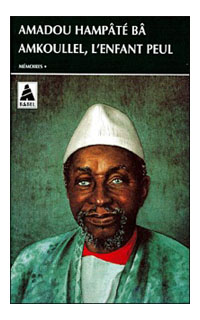La littérature congolaise célèbre cette année ses noces de diamant. En effet, cela fait soixante ans qu'elle existe. Elle naquit en 1953 avec la publication du roman Coeur d'Aryenne, de Jean Malonga. Ce dernier, auteur du Sud du Congo, se déporte dans le Nord du pays, plus précisément à Mossaka, pour y faire vivre ses personnages, Mossaka où l'auteur n'a pas du tout vécu mais où il se projette par le pouvoir de l'imagination.
 Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
Or Jean Malonga, premier écrivain congolais, ouvre la voix par un message de paix, un message d'unité, il nous invite à bâtir des ponts entre les régions et les ethnies. "Bâtir des ponts culturels", c'est le leitmotiv des festivités qui vont commémorer la naissance de la littérature congolaise, il y a soixante ans de cela, et Jean Malonga est naturellement la figure tutélaire de ces célébrations, qui ont officiellement démarré ce samedi 19 octobre au salon du livre de L'Haÿ-les-Roses.
Des écrivains, des admirateurs de la littérature congolaise, des patriotes venus faire honneur à leur littérature ont répondu présents à cette invitation à la Noce, et nous avons trinqué ensemble pour une littérature encore plus forte et plus vive. Mais avant de boire à la santé de la littérature du Congo Brazzaville, nous avons d'abord hommage à Léopold Pindy Mamonsono, écrivain, animateur de l'émission littéraire "Autopsie" sur télé Congo, organisateur d'événements culturels et littéraire, bref une figure importante du paysage littéraire congolais, qui a rejoint ses ancêtres le 8 octobre dernier. Nous avons ensuite vogué sur le fleuve Congo, car le voyage était au coeur de cette fête à L'Hay-les-Roses. Le modérateur Aimé Eyengué, initiateur de ces festivités, s'est improvisé commandant à bord et nous a conduits du Congo au Mékong avec l'écrivain aux doubles origines vietnamienne et congolaise Berthrand Nguyen Matoko. Belle coïncidence : le Vietnam était à l'honneur à cette édition 2013 du festival du livre et des arts de L'Haÿ-les-Roses, le Congo aussi. Berthrand Nguyen Matoko a parlé de ses livres dans lesquels, souvent, il brise le silence et les tabous, par exemple dans son Flamant noir, publié chez L'Harmattan, qui a fait beaucoup parler de lui. Nous avons fait escale au Rwanda avec le Docteur Roland Noël qui a évoqué son expérience là-bas à travers son livre Les Blessures incurables du Rwanda, publié aux éditions Paari. Ce livre a fortement retenu l'attention du public, il a été réédité et est au programme dans une université de France, a souligné l'auteur, médecin de profession.
 Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)
Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)
Suivons les traces des artistes Jacques Loubelo et Emilie-Flore Faignond, donnons tout notre amour à notre pays, donnons la meilleure part de nous. Si nous, les premiers, ne bâtissons notre pays avec le ciment de l'amour, de l'entente, de la fraternité, de la paix, comment pourra-t-il tenir debout face aux intempéries, comment pourra-t-il résister au loup qui rôde pour le détruire ? Heureusement que dans le conte, l'un des trois petits cochons avait bâti en dur, et non avec de simples branchages ou de la paille. Alors, Congolais, congolaises, avec quoi bâtis-tu le Congo ?
Les prochaines célébrations auront lieu le 10 novembre, à la Maison de l'Afrique à Paris, puis le 12 décembre, aux Galeries Congo, toujours à Paris. A Brazzaville, elles auront lieu du 20 au 22 décembre 2013. Il y en aura aussi à Pointe-Noire, à la mi-décembre.
Liss Kihindou, article initialement paru sur son blog