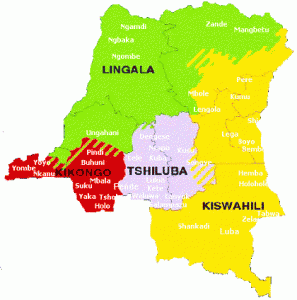Une grande partie de l’Afrique centrale semble aujourd’hui complètement en dehors des radars médiatiques et diplomatiques. Qui pense au Burundi, qui chaque heure, sombre un peu plus dans la violence ? Au Congo-Brazzaville, où les voix dissidentes ne nous reviennent plus qu’en de lointains échos. Faut-il inexorablement attendre le terrorisme et la guerre pour faire mine de s’intéresser à l’Afrique ? Comment ignorer qu’ils ne sont que les produits de nos indifférences d’hier ?
Une grande partie de l’Afrique centrale semble aujourd’hui complètement en dehors des radars médiatiques et diplomatiques. Qui pense au Burundi, qui chaque heure, sombre un peu plus dans la violence ? Au Congo-Brazzaville, où les voix dissidentes ne nous reviennent plus qu’en de lointains échos. Faut-il inexorablement attendre le terrorisme et la guerre pour faire mine de s’intéresser à l’Afrique ? Comment ignorer qu’ils ne sont que les produits de nos indifférences d’hier ?
Tant bien que mal, le petit Burundi avait pourtant réussi à trouver un équilibre politique. C’était les accords d’Arusha, en 2000. Ils mettaient fin, progressivement, à une guerre civile qui avait coûté la vie à plus de 300 000 personnes. Ils établissaient aussi un partage du pouvoir entre la majorité hutu et la minorité tutsi et des principes simples comme la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. Ces accords sont aujourd’hui en lambeaux. Après deux mandats, le président Pierre Nkurunziza s’est accroché à son fauteuil coûte que coûte, au prix d’une spirale de violence inouïe, d’assassinats ciblés, de journalistes malmenés, voire torturés. Passé à tabac par les services de renseignement, le correspondant de l’AFP et RFI a été contraint de se réfugier à l’étranger. Le pouvoir a également menacé à mots couverts une envoyée spéciale de la radio française accusée d’”action perturbatrice”, de “reportages de malédictions” et de “fausse informations incendiaires”. Depuis fin avril, des centaines de personnes ont été tuées, même si le bilan précis est difficile à établir. 5.000 soldats de l’Union africaine sont annoncés pour mettre fin aux violences. Mais quand et pour faire quoi ? Comment les déployer sans l’accord du pouvoir ?
Du côté de la communauté internationale, les appels à la modération et au calme se succèdent depuis des mois, sans effet. Le dialogue inter-burundais, piloté par l’Ouganda, est au point mort. Quand bien même les critères ethniques ne recouvrent pas les multiples lignes de fractures dans le pays, les chancelleries sont tétanisées par le fantôme de 1994. Les 800 000 victimes, tutsis et hutus modérés, du génocide rwandais qu’elles n’avaient pu empêcher. Si le pire advenait, l’ONU, dans une note dévoilée il y a quelques jours, reconnaît qu’elle ne pourrait y faire face sans moyens supplémentaires. L’ampleur des violences dépasserait “les capacités de protection des Nations Unies”, déplore ce texte.
Des appels de la communauté internationale, il y en a, aussi, au Congo-Brazzaville, mais si peu. Le paysage politique y est comme congelé. Le pays visiblement indissociable de son président Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir par les armes en 1997, après une guerre civile, encore une. Pour 2016, une constitution l’empêchait de s’accrocher au pouvoir. Qu’importe, une autre a été écrite à la hâte et adoptée par référendum en octobre. Quelques jours avant le vote, François Hollande avait estimé que Denis Sassou Nguesso avait, après tout, tout à fait le droit de consulter son peuple. La France est il est vrai un partenaire historique du Congo, où Total est le principal acteur de secteur pétrolier. Aussitôt critiqué par les ONG et l’opposition congolaise, le président français avait rectifié le tir quelques heures plus (trop) tard par un communiqué condamnant toute violence et rappelant l’importance de la liberté d’expression.
Puisque les critiques se font rares, la présidentielle au Congo a été avancée au mois de mars au lieu du mois de juillet. Avec cet inattendu changement de calendrier, l’opposition redoute de n’avoir ni le temps, ni les moyens de préparer la campagne, mais qui s’en soucie ? Les opposants ont certes depuis longtemps perdu une partie de leur crédibilité. Sans accès aux médias, ni véritable aura au sein d’une population désabusée, ils sont souvent divisés, sans ressources, exposés aux appels du pied et aux francs CFA de la présidence, qui bénéficie à plein des ressources pétrolières.
Le 20 octobre, des jeunes sont descendus dans la rue aux cris de “Sassoufit”. La répression des manifestations a fait 17 morts selon l’opposition. Dix jours après, cette même opposition annonçait des grandes marches dans tout le pays, pour contester les résultats du référendum. Sans explications crédibles, les manifestations ont finalement été annulées. Interrogé à Paris, l’écrivain Alain Mabanckou, tout en appelant le président à laisser le pouvoir, a dénoncé l’attitude d’une opposition “qui quand ça a commencé à crépiter s’est cachée et a laissé la jeunesse congolaise sous les balles”. Pessimiste, il a même prédit deux nouveaux mandats pour Denis Sassou Nguesso, “vu le larbinisme de l’opposition”.
A Bujumbura comme à Brazzaville, tout est fait pour que rien ne change. Ailleurs la situation de ces deux pays comme bien d’autres en Afrique, suscite au mieux une vague indifférence, au pire, des réponses dégainées comme des boomerang, pour dire qu’après tout “c’est ça l’Afrique”. Comme si “là bas”, plus qu’ailleurs, un président avait le droit de disposer de son peuple à guise, et de faire de son pays son jardin tâché de sang… Jusqu’à quand ?
Adrien de Calan









 « Allô Allô » non pas en signe d’interjection ; mais parce que c’est l’appellation du téléphone portable au Congo ; comme pour rappeler qu’il n’a pas été inventé dans ce pays. Mais c’est aussi révélateur de la créativité actuelle dans ce pays de 4,5 millions d’habitants avec un PIB par habitant de 4500 dollars en PPA, plus que la moyenne africaine, et un taux de croissance moyen de 5% entre 2005 et 2013.
« Allô Allô » non pas en signe d’interjection ; mais parce que c’est l’appellation du téléphone portable au Congo ; comme pour rappeler qu’il n’a pas été inventé dans ce pays. Mais c’est aussi révélateur de la créativité actuelle dans ce pays de 4,5 millions d’habitants avec un PIB par habitant de 4500 dollars en PPA, plus que la moyenne africaine, et un taux de croissance moyen de 5% entre 2005 et 2013. Enfin, La référence, c’est l’autre pour l’ensemble de la population dans la mesure où l’essentiel, voire presque la totalité des produits consommés sont importés. Les chaînes de télévision nationales ne sont pas accessibles, en tout cas pas en ville et en particulier dans les hôtels et restaurants. Tout se passe comme si chacun vivait dans son référentiel sans être soumis au reflet de ce que sont les autres. L’Etat ne se préoccupe pas en premier lieu des plus pauvres ; il se réfère d’abord aux plus fortunés. Cela se comprend parfaitement dans un pays où 65% du PIB est généré par l’exploitation du pétrole.
Enfin, La référence, c’est l’autre pour l’ensemble de la population dans la mesure où l’essentiel, voire presque la totalité des produits consommés sont importés. Les chaînes de télévision nationales ne sont pas accessibles, en tout cas pas en ville et en particulier dans les hôtels et restaurants. Tout se passe comme si chacun vivait dans son référentiel sans être soumis au reflet de ce que sont les autres. L’Etat ne se préoccupe pas en premier lieu des plus pauvres ; il se réfère d’abord aux plus fortunés. Cela se comprend parfaitement dans un pays où 65% du PIB est généré par l’exploitation du pétrole. Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.
 Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)
Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)