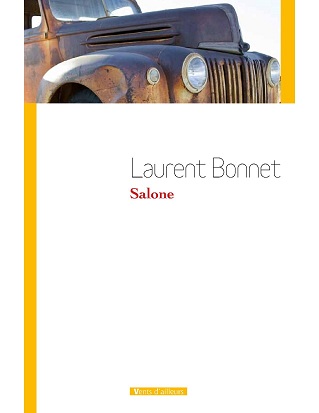Qu’est-ce que la maison de la faim ? Voilà une question qu’il est légitime de se poser à lecture du livre éponyme de l’auteur et icône Zimbabwéen Dambudzo Marechera (1955-1987). Il est plus difficile de savoir quelle serait la réponse légitime. On doit admettre d’emblée que c’est plusieurs choses à la fois, et simultanément aucune de ces choses. C’est un peu cette construction instable et pourrie qui fait office de maison au narrateur. C’est aussi le Township tout entier qui s’étend jusqu’aux confins de la misère. Ou même le régime rhodésien qui repose sur la terre suppliciée de la ségrégation et de la violence. La maison de la faim, c’est l’univers de Marechera. Son monde. Son œuvre. Son obsession, et la nôtre. Elle est là, sous vos yeux, cette construction fragile.
Qu’est-ce que la maison de la faim ? Voilà une question qu’il est légitime de se poser à lecture du livre éponyme de l’auteur et icône Zimbabwéen Dambudzo Marechera (1955-1987). Il est plus difficile de savoir quelle serait la réponse légitime. On doit admettre d’emblée que c’est plusieurs choses à la fois, et simultanément aucune de ces choses. C’est un peu cette construction instable et pourrie qui fait office de maison au narrateur. C’est aussi le Township tout entier qui s’étend jusqu’aux confins de la misère. Ou même le régime rhodésien qui repose sur la terre suppliciée de la ségrégation et de la violence. La maison de la faim, c’est l’univers de Marechera. Son monde. Son œuvre. Son obsession, et la nôtre. Elle est là, sous vos yeux, cette construction fragile.
Eclairée par la lumière blafarde du crépuscule, on distingue son architecture tourmentée. Il n’y a pas de cohérence de construction. Pas de porte d’entrée ni de sortie. Des pseudo-couloirs qui ne mènent nulle part et des salles indéterminées. Pas vraiment comme un labyrinthe. Juste un splendide amas de matériaux de récupération à vous en brûler les yeux. On passe brusquement de la cuisine aux latrines sans transition. De la tôle à la soie. Mais tout est soit déchiqueté soit brûlé. L’on ne peut voir qu’une multitude de briques fendues, reliées par la glaise d’une société malade. Ce sont les vestiges encore chauds de la violence et de la souffrance sans nom qui l’érige et la saccage d’un même coup de pelle. Ce qui laisse apercevoir une bâtisse inachevée : ici une poignée nue posée sur le sol ; là une esquisse de fenêtre brisée comme autant de provocation d’un architecte nihiliste qui trébuche sur ses propres outils.
La décoration intérieure et son ambiance génèrent elles aussi leurs troubles propres. Les peintures murales d’une couleur ocre sont recouvertes de graffitis et de leitmotivs entêtants. Des démons de toutes les couleurs y sont représentés. Des mouches écrasées jalonnent la tapisserie. On aperçoit à plusieurs reprises des trains menaçants, comme celui qui écrase le père de Dambudzo, comme le train de l’histoire qui broie les os de la Rhodésie. Et surtout, les murs sont couverts de tâches, tâches de sang de héros noirs imaginés qui se confondent avec leurs antithèses, et tâches réminiscences de la pourriture intestinale comme seule symbolique unificatrice d’une existence. Quelques tableaux sont accrochés çà et là, au petit malheur la chance : ici une scène de combat entre le peuple Ndebele et les colons anglais, là des guérilléros africains modernes fusillés par des forces de sécurité. Entre une scène de viol au milieu d’une foule surexcitée et la vision d’un corps reposant dans une geôle faiblement éclairée, les peintures suantes ont tendance à dégouliner sur les citations de Swift et de Yeats tracées à l’encre fine, au milieu d’un chant Shona.
Si l’on jette subrepticement un coup d’œil à travers la fenêtre, on peut y voir « Dieu essorer ses sous-vêtements sales ». Entre les bruits d’éructations, les rires heurtés et les cris des enfants battus par leurs mères, on peut y entendre « un nuage de mouches venu des toilettes voisines fredonner l’Alléluia de Haendel ». Et puis la maison de la faim sent le cannabis et l’alcool, le vomi et la rose. On distingue une odeur d’encens mêlée à celle du sperme dans une coexistence aigue et blasphématoire.
C’est dans cette demeure qu’évoluent les habitants de la maison de la faim. Peut-être devrions-nous commencer par les maîtres de maison. Ils sont deux. La faim et la soif. La faim, ce n’est pas seulement la sensation déchirante de vide stomacale et l’envie irrépressible de se sustenter. C’est aussi un besoin de tendresse humaine et de considération. La soif, ce n’est pas seulement la recherche hébétée d’eau pour humidifier sa gorge sèche, c’est aussi la quête d’un absolu artistique et intellectuel. Celui de s’envoler au-delà « de la merde infecte qu’avait été la vie et qu’elle continuait à être à ce moment précis » : « toute la jeunesse noire était assoiffée, nous asséchions toutes les oasis de la pensée ».
Esclaves de ces deux maitres, hantant la maison d’un pas de somnambule, on aperçoit le fantôme mutilé de l’architecte, Dambudzo, nom que l’on devine et qui n’est jamais donné. Celui du génie et celui de l’épave. Celui de l’autobiographe et celui du créateur. Le schizophrène nécessaire qui nous assène son mal-être avec le marteau de la honte et l’enclume de la fierté. On assiste, entre quelques hallucinations grandioses ou démoniaques à quelques passages de lucidité sociopolitique intense. Ce poète vénérien subit des sensations extrêmes qui l’amènent aux limites de la conscience et de la folie, jusqu’au point où l’on ne sait plus vraiment si les phénomènes extérieurs ne sont que des projections de son esprit ou si ses états intérieurs ne sont que des éléments organiques du décor.
Décor qu’il partage avec les autres habitants de la maison de la faim. Peter, son frère, qui l’injurie quand il voit qu’il achète des livres. Immaculée, nom bien ironique de la fille de prêtre enceinte de Peter qui la bat, et pour laquelle le narrateur dévoue un amour platonique. Harry, son frère, l’ami ou l’ennemi de Dambudzo, on ne sait pas. Patricia, l’amante blanche avec laquelle Marechera est roué de coup par les manifestants pro-apartheid. Ou encore Julia, cette fille qui le drague dans un bar miteux d’Harare (alors Salisbury), avec Zimbabwe écrit en gros sur ses gros seins. Il y a aussi ces hallucinations effrayantes qui parlent et harcèlent et rient, comme dans un cauchemar. Puis ce clochard accueillit dans la maison de la faim, lançant des bribes de fables à la face réjouie de l’auteur. « Ce qu’il préférait, c’était me voir écouter attentivement des histoires racontées de travers, délirantes et fragmentaires » raconte ce dernier. C’est peut-être ce que nous préférons aussi : se perdre avec un malaise certain dans ces règlements de compte divers et circulaires qui ne s’arrêtent jamais.
Car il n’y a pas de fin à la maison de la faim. C’est l’éternelle tâche dans la mémoire des hommes. La plaie jamais refermée de l’horreur. La suture du ciel laissant couler la pisse amère du divin. Je ne peux en dire plus. Je vous ai décrit la maison. A vous de décider d’y entrer ou pas. La seule chose que je peux vous promettre, c’est que vous n’en sortirez pas immaculé.
Maxime Chaury
 Du 5 au 7 février aura lieu à Brazzaville (Congo) le sommet Build Africa, premier forum d’affaires et d’investissement dédié exclusivement aux infrastructures sur le continent.
Du 5 au 7 février aura lieu à Brazzaville (Congo) le sommet Build Africa, premier forum d’affaires et d’investissement dédié exclusivement aux infrastructures sur le continent.