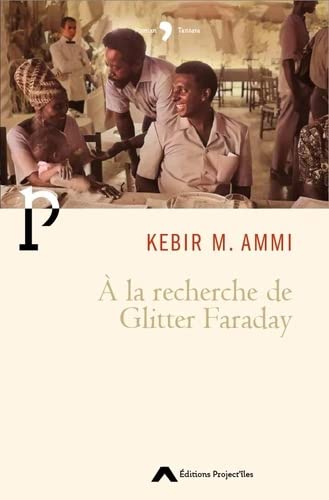C’est un roman à lire sur les sons du jazz, Archie Shepp ou Charles Mingus de préférence, une contrebasse qui vous transperce la peau nappée d’un langoureux saxophone empreint de nostalgie ; les joies et les peines d’un peuple qui a traversé l’esclavage et l’oppression. « Jazz is a black Power ! ».
A la recherche de Glitter Faraday, dernier roman de Kébir Ammi, nous plonge dans l’histoire des Black Panthers, ce célèbre groupe d’auto-défense américain qui avait fait un détour par Alger entre les années 60 et 70 lorsque celle-ci était « la Mecque des révolutionnaires ». C’est Amilcar Cabral, héros de la lutte bissau-guinéenne, qui avait baptisée la ville blanche ainsi lorsqu’il avait dit lors d’une conférence en 1968 que « les musulmans vont en pèlerinage à La Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération nationale à Alger ».
Jamais une ville africaine n’avait réuni autant de résistants, d’exilés et de militants anticolonialistes. « Alger n’était pas n’importe quelle ville. Alger était le sanctuaire de tous ceux qui voulaient vivre debout. Alger était le seuil de toutes les promesses ». Miriam Makeba y avait chanté en arabe « Ana horra fi El Djazaïr » (je suis libre en Algérie), Archie Shepp faisait valser son saxo avec les Touaregs du désert, Nelson Mandela déclamait la lutte des peuples et Franz Fanon la condition noire… Le séjour des Black Panthers à Alger restera gravé dans l’histoire de cette ville même si on n’en garde que d’infimes traces dont ce roman dévoile l’existence.
Il en reste ainsi un bar mythique, « les exilés », tombé en décrépitude, honni par les gardiens de la bonne morale, « une route qui monte » au milieu de la Médina et où un crime abject avait été commis il y a bien longtemps, des pensions au charme ottoman où avaient séjourné des résistants noirs et puis surtout un manuscrit, écrit de « sang et de larmes », et qui fera le voyage jusqu’aux confins de l’Amérique. Du Montana au Nouveau Mexique, en passant par Detroit, la Nouvelle Orléans, le Nebraska…le fameux manuscrit, déjà trempé dans le sang de la lutte des peuples, s’est mêlé au sang de la violence raciale américaine. Car malgré les combats menés par le célèbre pasteur qui avait fait un rêve, malgré la fin officielle de la ségrégation aux Etats-Unis, dûment édictée par une loi en 1964, les noirs n’avaient toujours pas les mêmes droits que les blancs. Et il n’est pas interdit de penser que cela perdure jusqu’à aujourd’hui…
Tout commence et tout s’achève à Alger
Au moment de succomber aux coups de la police algérienne dans la sinistre rue en dédale de la Médina, un poète contestataire, Sellam, confie un mystérieux manuscrit à son ami Black Panther, Glitter Faraday, qui l’embarque avec lui aux Etats-Unis. Ce dernier, accusé d’avoir séjourné dans le pays des ennemis communistes, finira défiguré par les blancs et à moitié fou. Mais son document passera de main en main, comme une parole biblique sacrée, jusqu’à arriver chez un jeune réalisateur qui en fera un film décrivant le périple de ces noirs américains brisés chez eux et rêvant d’atteindre la terre promise algérienne.
L’histoire nous est raconté par un écrivain algérien- dont on découvrira le lien avec les autres acteurs bien plus tard- qui part à la quête de ce fameux manuscrit aux Etats-Unis. Il suit d’abord les traces de Glitter Faraday, ensuite tous ceux qui l’avaient connu de près ou de loin, tous militants de la cause noire et autochtone, tous ayant expérimenté leur combat dans leur chair. Nous plongeons dans l’Amérique des suprémacistes blancs où les Noirs sont chassés comme des chiens, pendus aux arbres, condamnés à fuir et à se cacher dans des motels coupe-gorge au milieu des déchets et des crachats. Les regards les guettent avec méfiance. La plume de l’auteur prend tout son temps pour décrire les expressions des visages, les silences comme les demi-mots. Ambiance western. Et puis, au milieu de la fumée glauque, des barmaids maquillées comme un camion volé balancent un nom. Et c’est reparti pour un tour ! Notre narrateur explorateur tient une nouvelle piste à la quête du manuscrit. Hit the road Jack !
Les terres des grandes promesses non advenues
Si le roman décrit des tranches de vie qui s’emboitent les unes dans les autres dans cette Amérique profonde sonnée par la chaleur et les courses-poursuites, au fond, ni le personnage de Glitter Faraday ni ses compagnons de lutte, ni même ce trésor convoité qu’est le manuscrit, ne sont des buts en soi. Kébir Ammi décrit en réalité une trajectoire initiatique à la recherche de soi et de la fraternité qui lie les humains. Il livre une longue complainte, très jazzy, d’une Amérique et d’une Algérie qui s’offrent en miroir malgré la distance qui les sépare. Toutes les deux ont mal tourné après les discours des leaders d’antant. Toutes les deux n’arrivent pas à offrir un avenir meilleur et équitable à leurs enfants. Ce sont des terres de grandes promesses non encore advenues : « Je continuais à fredonner le poème de Ted Joans, sur la route qui longe l’océan et je me souvenais de Sellam qu’on n’arrêtait pas de coffrer pour rien, parce qu’il dénonçait un régime militaire forcené et brutal, qui n’avait rien à envier à celui qui avait prévalu pendant plus de cent ans. La révolution a été un vrai gâchis : elle a été détournée de ses fins. L’Algérie méritait mieux qu’une bande de trouffions, ivres de leur force, des soudards galonnés, qui avaient confisqué le pouvoir et qui ne reculaient devant rien pour préserver leur prébende ».
Or, lorsque les portes de l’espoir demeurent fermées, que reste-t-il ? « L’humanité est notre seul bien, l’unique rempart, le seul destin de tous les peuples », dira Sellam le poète algérien.
Note sur l’auteur

Fils d’un père algérien et d’une mère marocaine, Kébir M. Ammi est un écrivain dont l’œuvre s’inspire des questions identitaires, de l’exclusion et des appartenances culturelles. Il vit en France et a longuement résidé aux Etats-Unis où il a fait connaissance avec le parcours des Black Panthers. Auteur prolifique, il confronte l’Histoire avec les problématiques des sociétés actuelles à travers les portraits de personnages qui ont marqué leurs temps comme l’Emir Abdelkader, Saint Augustin, Ben Aicha ou El Hallaj, Il est notamment l’auteur des « Vertus immorales », « La Fille du vent », « Mardochée » et « Un génial imposteur».