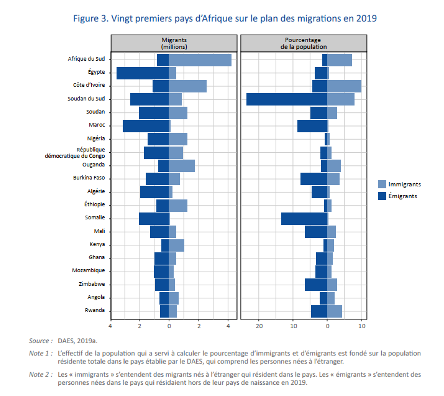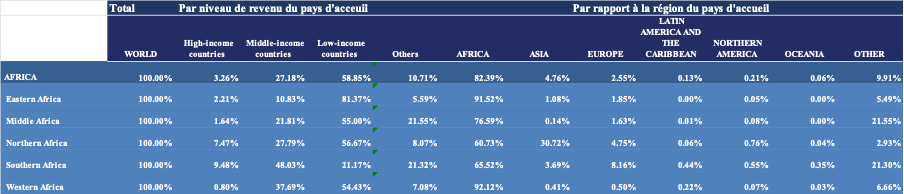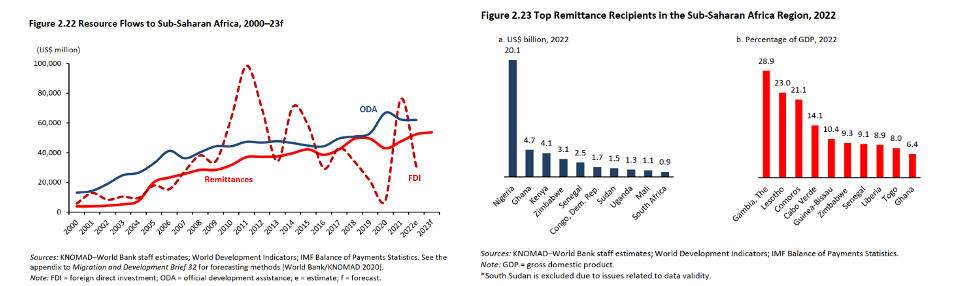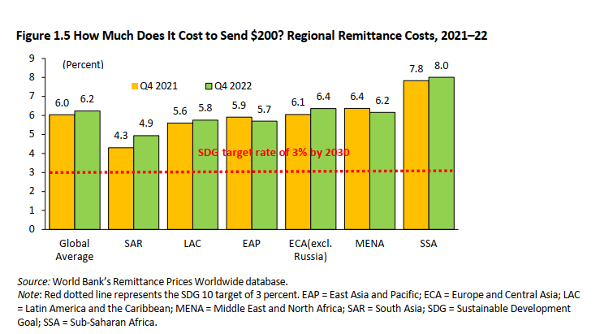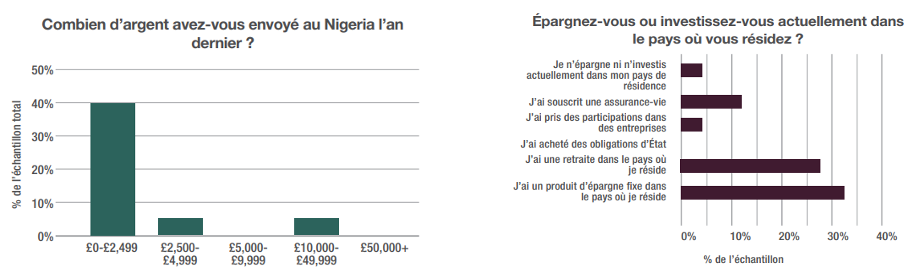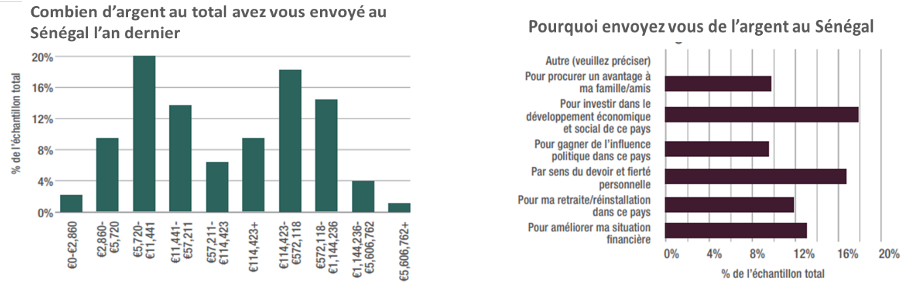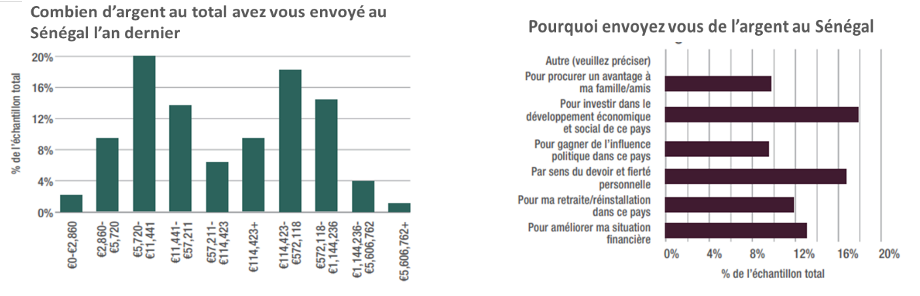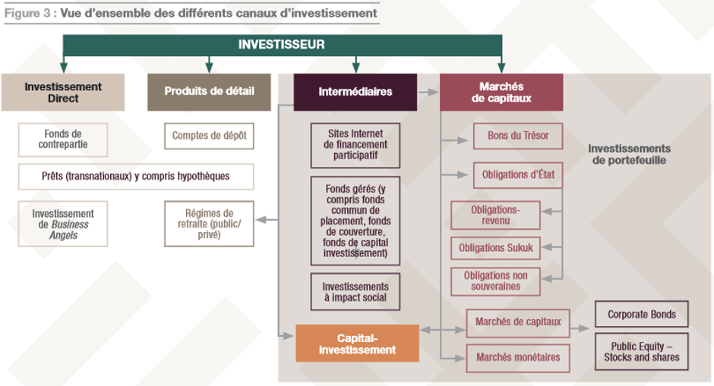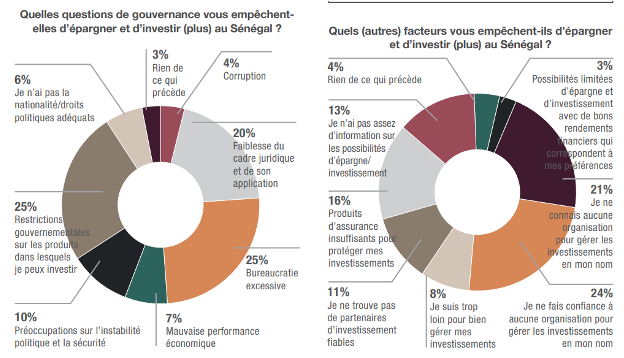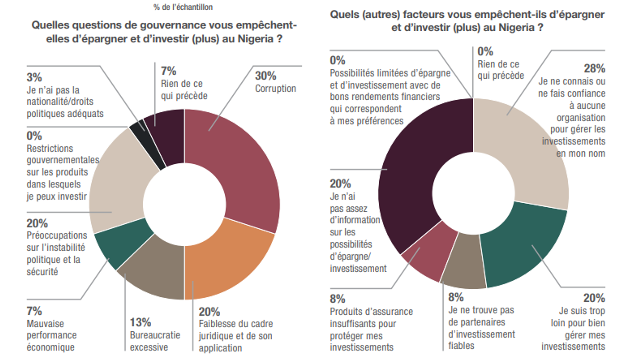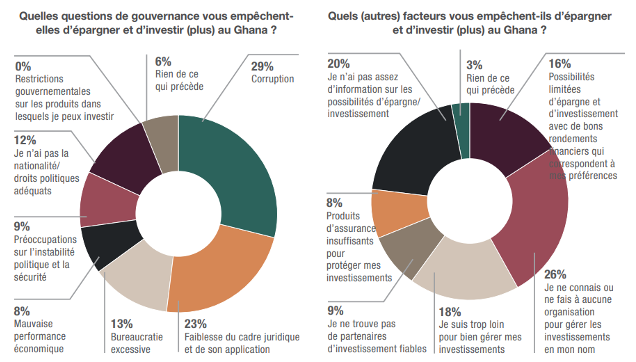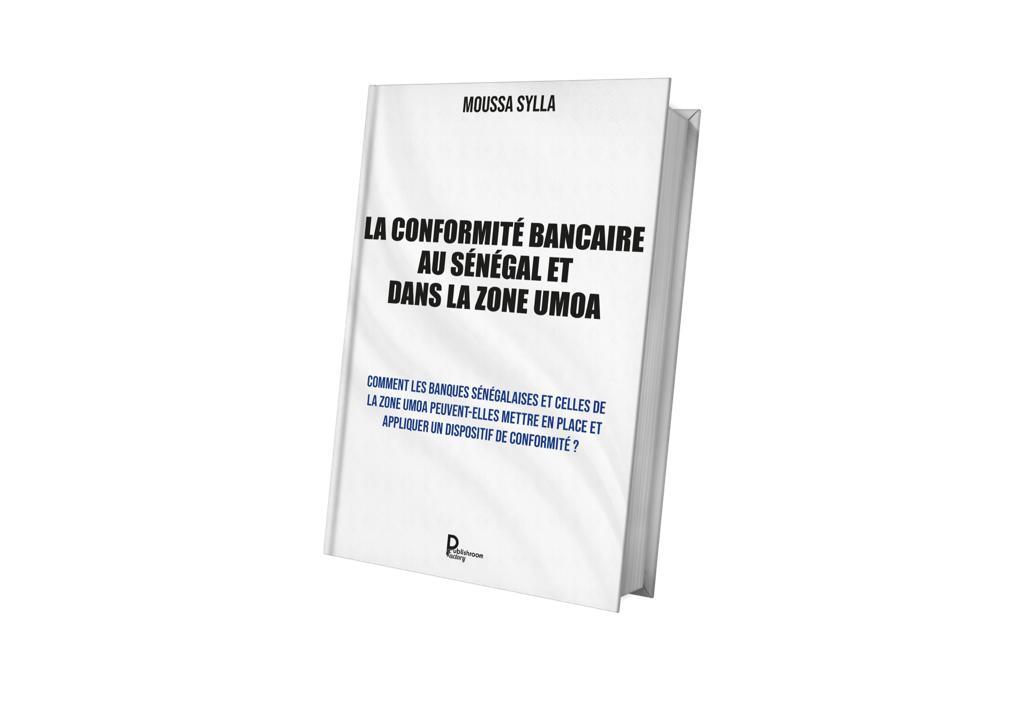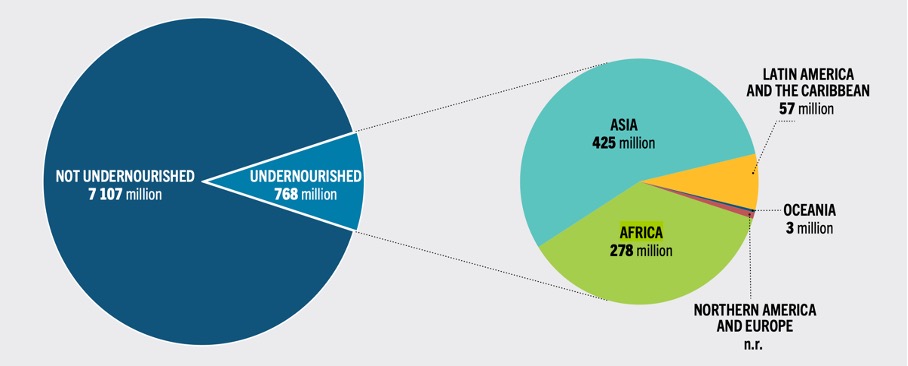Par Mamadou Lamine FALL, docteur en Sciences politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste en coopération internationale pour le développement, la coopération Nord-Sud et la paix et la sécurité internationale.
Résumé
L’hostilité grandit à l’égard de l’influence des puissances étrangères sur les économies africaines. Des mouvements comme France Dégage axent leur lutte dans ce sens : « Ce slogan vise la France institutionnelle qui en collusion avec le capitalisme, vampirise les peuples ici en Afrique francophone et ailleurs – Comment pouvons-nous vivre la souveraineté monétaire pendant que notre monnaie est frappée en France » ?[1]
Cette hostilité est l’une des raisons pour lesquelles les mouvements sociaux se multiplient en Afrique ces dernières années mais ce n’est pas l’unique raison. Au plan interne, la gabegie et la gestion chaotique du pouvoir poussent les citoyens et les organisations de la société civile à interpeller les gouvernants sur leur attitude irresponsable. Il s’agit là, d’une question cruciale parce que la gestion du pouvoir est une affaire de tous. Il est nécessaire d’avoir des acteurs neutres capables de réguler le champ politique pour garantir l’ordre, la justice et la cohésion nationale. La société civile apparaît ainsi comme un maillon essentiel dans la pacification du jeu politique, si et seulement si, elle assume sa mission de manière autonome et objective.
Mots clés : Société civile, transparence et parti politique.
Introduction
La prolifération des organisations de la société civile en Afrique constitue une preuve évidente du rejet des politiques des grandes puissances comme la France: «
Au Mali, au Sénégal et plus récemment au Tchad, lors des mouvements de protestation, les jeunes du continent s’en prennent aux symboles de la présence française en Afrique ».[2]
L’ère des gestions unilatérales est révolu. Les pays africains abritent de plus en plus de mouvements issus de la société civile qui prennent en charge certaines questions ou doléances qui ne sont pas satisfaites par l’État. Nous ne sommes plus à l’époque des grandes dictatures, relais de ces puissances internationales, où il est quasiment impossible de porter certains combats au nom de la justice sociale et du partage équitable des ressources. Les gouvernements africains sont désormais surveillés comme du lait sur le feu. Il n’est plus permis de dicter une politique ou une vision aux gouvernés. La gestion participative devient un levier fondamental pour la réussite de tout projet de société.
Nous sommes ainsi loin de l’époque où la France imposait ses dirigeants aux pays francophones, comme le note Banncel Nicolas : « C’est largement au moment de la transition vers les indépendances qu’a été mis en place un système de formation et de sélection des élites africaines susceptible de préserver les intérêts de l’ancienne métropole et de conserver ses principales prérogatives, malgré la décolonisation. Tout était alors en place pour que soit maintenue la connivence entre le première génération de dirigeants, puis les suivantes, et les autorités françaises ».[3]
En conséquence, les populations africaines veulent désigner leurs propres leaders en toute autonomie et en toute liberté sans l’ingérence d’un pays tiers comme la France. C’est ce qu’on peut noter dans les propos du Malien Issa Ndiaye lors d’une interview accordée aux journalistes de la BBC sur le sentiment anti-français en Afrique: « Je pense que ce rejet de la politique française vient essentiellement de là. On a le sentiment que ceux qui sont au pouvoir dans nos différents pays en Afrique le sont par la volonté de la France. Et ils sont maintenus au pouvoir par le fait de la puissance française. Et qu’il n’ont pas de légitimité populaire en dehors de cela », dit-il ».[4]
Il s’avère nécessaire maintenant de définir la notion de société civile et pour cela, nous allons citer la définition de la Banque Africaine de Développement concernant ce concept: « La société civile recouvre un ensemble d’activités humaines et associatives qui s’opèrent dans la sphère publique en dehors du marché et de l’Etat. Elle est la libre expression des intérêts et aspirations de citoyens organisés et unis autour d’intérêts, d’objectifs, de valeurs ou de traditions, et mobilisés pour mener des actions collectives en tant que bénéficiaires ou parties prenantes au processus de développement. Bien que la société civile se démarque de l’Etat et du marché, elle n’est nécessairement pas en contradiction avec eux. En dernière analyse, elle exerce une influence sur ces deux entités qui l’influencent en retour ».[5]
Toujours dans cette même logique de conceptualisation, la notion de mouvements sociaux fait référence à une dynamique de groupe tendant vers le changement social, comme le souligne l’historien Alain Touraine.Il définit le mouvement social comme « une action collective des individus en vue d’un changement social ; cette action est destinée à contrôler les orientations sociales de leur environnement. C’est le dépassement du mouvement contestataire du groupe, et la mise en cause du pouvoir et de sa domination ».[6]
En outre, les mouvements populaires constituent une réponse significative aux nombreux problèmes dont souffrent les citoyens africains à savoir : la pauvreté, le sous-développement, l’insécurité, l’endettement, la dépendance vis-à-vis de l’aide etc.
Par ailleurs, les mouvements anti-français montent au créneau pour dénoncer l’attitude de la France dans le fonctionnement et l’organisation des pays francophones, comme nous pouvons le constater dans les mots de l’écrivain Boubacar Boris Diop: « l’arrivée à maturité d’une génération qui ne se sent pas concernée par ce que la France a pu représenter pour ses aînés, qui regarde de moins en moins vers elle»[7]
Cela dit, l’analyse de ce thème pose une question essentielle à savoir : Comment décrire la trajectoire et le rôle des mouvements sociaux africains ? Le sens de ce questionnement influencera nos futures approches. Dans un souci méthodologique, nous allons nous appuyer sur des postulats théoriques et pratiques pour élucider notre démarche. L’étude de ce thème fait appel à des considérations épistémologiques, mais elle se focalise aussi sur des exemples concrets concernant les actions menées par les mouvements sociaux en Afrique.
- Genèse des mouvements sociaux
Dans cette partie, l’étude sera orientée vers la naissance des mouvements sociaux en Afrique. Nous allons ainsi tracer l’origine de ces mouvements dans deux périodes à savoir : les mouvements sociaux des années 60 et les mouvements sociaux des années 90
A/ Les mouvements sociaux des années 60
Contrairement à ce qu’on pense, l’origine des mouvements sociaux remonte bien longtemps en Afrique, dès les années 60. Il faut savoir que le contexte était très particulier dans la mesure où, les sujets de revendication portaient sur l’occupation coloniale comme le souligne Thomas Deltombe : « Partout en Afrique, des syndicats, des associations, des intellectuels, des partis politiques réclament l’égalité de traitement et la fin du racisme ».[8]
Les pays africains étaient sous le contrôle de la puissance coloniale. Cette puissance imposait sa culture, contrôlait l’administration et s’adonnait au pillage des ressources comme l’explique l’historienne Samia ElMechat : « Tout d’abord, l’administration coloniale est dotée d’instruments de commandement et de contrôle lui permettant d’asseoir la domination coloniale. Il n’existe pas de contrepoids véritable au pouvoir qui lui est dévolu, aucune limitation ne venant faire obstacle à cette concentration du pouvoir administratif »[9]
Cette situation étant devenue intenable, c’est pour cette raison que nous avons assisté à l’apparition des mouvements de lutte et de contestation contre l’occupation coloniale.
Ainsi, plusieurs mouvements populaires ont vu le jour et les relations entre les puissances coloniales et les mouvements de contestation étaient devenus alors plus tendues et plus difficiles. Nous allons mentionner, ici l’attitude des mouvements étudiants anticoloniaux selon Pascal Bianchini: « Pour résumer cette tentative très brièvement, j’ai distingué trois âges dans l’histoire des mouvements étudiants africains : celui de l’anticolonialisme, notamment, dans le cadre du militantisme diasporique de la West African Students’ Union (Wasu) et de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (Feanf), celle de l’anti-impérialisme, avec une effervescence militante, liée au développement d’organisations de la gauche révolutionnaire de la fin des années 1960 jusqu’au début des années 1980, et enfin celui des luttes contre l’ajustement structurel et pour la démocratisation des régimes africains durant les années 1990 en particulier ».[10]
En clair, l’indépendance des pays africains a été portée par les mouvements des étudiants africains en France. Il s’agit de l’Association des Étudiants du Rassemblement Démocratique Africain (AERDA) dirigée par Cheikh Anta Diop et la Fédération des Étudiants d’Afrique Noire en France (FEANF) comme le souligne Nicolas Bancel en ces termes : « Enfin, Nicolas Bancel a proposé une analyse de cette période en croisant histoire institutionnelle des élites et histoire culturelle de la jeunesse. Il repère deux phases dans le mouvement étudiant, la première entre 1946 et 1956 marquée par une diversité d’associations et la seconde, à partir de 1956, caractérisée par l’unification du mouvement au sein de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF). Tout en reconnaissant que l’AERDA reste mal connue, il note que cette association, durant la première période, est « l’un des creusets de la formation politique des militants nationalistes étudiants ». [11]
Beaucoup de membres issus de ces mouvements anticoloniaux ont finalement crée des partis politiques, c’est le cas de Cheikh Anta Diop avec sa formation politique dénommée, Rassemblement National Démocratique (RND), créée en 1976 et légalement reconnue en 1981. Il en est ainsi pour le parti de Majhemout Diop, le (PAI) Parti Africain de l’Indépendance, crée en 1957.
Toutes ces raisons mentionnées ci-dessus, montrent clairement que les mouvements sociaux ne datent pas d’aujourd’hui contrairement aux idées reçues.
B/ Les mouvements sociaux après les années 1960
La trajectoire des mouvements sociaux est à tracer dans le temps, car un phénomène marquant est venu changer la donne. Il s’agit de trois événements majeurs.
Le premier est que les mouvements sociaux de l’époque coloniale ont finalement vu leur lutte être couronnée de succès puisque la grande majorité des pays africains ont accédé à l’indépendance dans les années 1960. Les mouvements populaires disparaissent pour devenir des partis politiques. C’est le cas de l’Algérie avec le Front de Libération National (FLN) qui a participé activement à l’indépendance de ce pays maghrébin. Le FLN prend la connotation d’un parti politique après l’indépendance de l’Algérie comme le mentionne le sociologue algérien Nacer Djabi: « Durant les trois premières décennies de l’Algérie indépendante, le mouvement associatif national s’est réduit comme peau de chagrin. Suspecte aux yeux du parti unique, la société civile se résumait alors aux « organisations de masse », qui n’étaient rien d’autre que des satellites du FLN. En 1987 toutefois, le pouvoir lâche du lest, et l’Algérie s’inspire de la fameuse loi française de 1901 pour réglementer l’activité associative. Vingt ans plus tard, la société civile s’impose chaque jour un peu plus comme un partenaire essentiel des autorités dans l’élaboration des politiques publiques et la prise de décisions ».[12]
Le deuxième point concerne la lutte des années 1980 avec les politiques d’ajustement structurel des institutions de Breton Woods, Les dirigeants des pays africains nouvellement indépendants sont considérés comme des mauvais gestionnaires des ressources publiques dans la mesure où, ils ont mal géré les fonds alloués par la Banque Mondiale et le FondsMonétaire International pour construire le développement économique du continent. Cette situation a conduit les bailleurs de fonds à promouvoir une gestion inclusive et participative dans la gouvernance des ressources publiques.. C’est dans ce contexte que les organisations de la société civile se créent un peu partout en Afrique pour garantir la transparence dans la mise en oeuvre des projets et programmes de développement: «
À partir des années 1980, avec la crise de l’État « développementaliste » et les premiers plans d’ajustement structurels, les pays africains deviennent plus dépendants de l’aide publique internationale et aussi des modèles d’organisation occidentaux. En 1989, le « consensus de Washington » impose, à travers les grands bailleurs de fonds, une vision néolibérale qui vise à étendre le rôle du marché et à restreindre celui de l’État. Dans le contexte du début des années 1990, le rôle politique des sociétés civiles africaines s’affirme comme le moteur des démocratisations, au point de surpasser celui des partis politiques dénoncés comme les refuges d’un personnel politique inamovible ».[13]
Le troisième point concerne le basculement des pays africains vers la démocratie dans les années 1990. Après l’indépendance, le parti unique qui reflétait le champ politique avec une opposition quasi inexistante, cède la place au multipartisme et au développement de la presse privée. Le pouvoir est devenu alors un objet de convoitise. Des élections libres et transparentes deviennent le seul moyen légitime pour accéder au pouvoir et les institutions publiques sont de plus en plus acculées par une opposition farouche et une presse écrite très critique. À cela s’ajoute, la naissance progressive des mouvements sociaux qui militent pour la plupart pour le respect de la démocratie et des libertés , comme on le remarque ici : « En Afrique, les luttes de démocratisation sont de plus en plus portées par des mouvements sociaux ».[14]
Par ailleurs, nous allons aborder le rôle de quelques mouvements populaires en Afrique.
Au Sénégal, on peut citer le mouvement « y’en a marre » crée en 2011 et le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine « FRAPP-France Dégage » lancé en 2017 et qui est une coalition de 17 organisations militant pour les mêmes causes. Ces mouvements populaires ont été à l’origine de plusieurs manifestations et contestations contre la vie chère, la corruption et l’influence de la France dans les secteurs clés de l’économie.
En Ouganda, on peut citer l’exemple de Black Monday Movement composé d’ONG et d’organisations de la société civile. Ce mouvement citoyen envahissait tous les lundis les grandes artères de Kampala pour dénoncer la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics.
Au Congo, c’est le même sentiment avec la coalition « Publiez ce que vous payez » qui mène des actions de contestation contre la corruption.
Enfin, au Burkina Faso, le « Balai citoyen » est un exemple concret, inspiré par le mouvement « y’ en a marre » du Sénégal, a été créé en 2013 pour porter le combat concernant la justice et la transparence dans la conduite des affaires publiques.
C/ Les points de revendication des mouvements sociaux après les années 90
Il s’avère nécessaire de faire le point sur les points de revendication des organisations de la société civile.
Le domaine politique
Les mouvements de la société civile sont très regardants sur la bonne marche de la démocratie et ils interviennent dans presque tous les domaines de la vie sociale, comme on le souligne ici : «Les citoyens ne veulent plus être des observateurs passifs au sein des organisations de masse, mais veulent plutôt façonner les résultats et jouer un rôle plus actif et participatif dans les processus de prise de décision. Ainsi, les citoyens se réunissent en groupes locaux de manière spontanée et informelle – y compris via les médias sociaux – pour débattre et résoudre des problèmes spécifiques ».[15]
Ils jouent un rôle d’intermédiaire entre le pouvoir et l’opposition et tentent même parfois de réconcilier les deux camps en cas de conflit ou de crise politique. Le rôle de la société civile en tant que contre-pouvoir est fondamental. De même que la séparation des pouvoirs telle que théorisée par Montesquieu. Mais, cette séparation est de plus en plus remise en cause en raison de son caractère théorique. C’est pourquoi, la société civile joue un rôle indéniable dans ce sens. Non seulement, elle milite pour le respect de la séparation des pouvoirs, mais aussi, lutte pour la bonne marche de la démocratie. On peut citer entre autres, le respect du calendrier électoral, la tenue des élections libres et transparentes, l’indépendance de la justice etc.
Enfin, la société civile en assurant son rôle, participe à la pacification de l’espace politique et du coup, son existence devient indispensable dans une démocratie.
Les autres thèmes de contestation
La mauvaise conduite des affaires publiques ainsi que les promesses électorales non tenues font naître des revendications tout azimut. Les thèmes de contestation sont de plusieurs natures.
La mauvaise gestion des finances publiques est devenue un problème majeur en Afrique, surtout que les cas de détournement sont très fréquents, c’est le cas de l’Ouganda, comme on le remarque ici : « Les médias se font l’écho d’un rapport accablant du contrôleur général ougandais, accusant des fonctionnaires, y compris certains responsables au sein du bureau du Premier ministre, du détournement de quelque 15 millions de dollars. L’argent était destiné à des projets de développement dans le nord du pays, dévasté par une longue guerre civile. Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre, Amama Mbabazi, reconnait qu’ « un vol massif » a eu lieu ».[16]
Les populations pensent que les hommes politiques s’enrichissent illégalement et le phénomène reste impuni: « Néanmoins, très rapidement, les nouveaux dirigeants ont réalisé les limites de leur pouvoir dans un tel cadre; c’est ainsi qu’à travers des théories apparemment nationalistes, mais souvent démagogiques, le contrôle de l’administration par le politique s’est répandu entraînant un dérapage budgétaire, le recul de la neutralité de l’administration et à la longue, le recul de la croissance. Cette situation qui a aussi créé de nouvelles ambitions politiques (la politique étant de plus en plus perçue comme l’échelle la plus courte vers l’enrichissement personnel) a entraîné l’instabilité politique, faute de réelle perspective d’alternance ».[17]
Ensuite, le pouvoir est vu comme une ascension sociale. Il suffit d’être dans un poste de responsabilité pour devenir riche à un rythme très rapide. C’est la raison majeure qui incite les acteurs de la société civile à jeter le discrédit sur les acteurs du pouvoir. La situation est beaucoup plus inquiétante lorsqu’on sait que la majorité des pays sous-développés ont un budget déficitaire. Le thème de la contestation semble être légitime puisqu’il dénonce ces pratiques malsaines qui ne font qu’aggraver la pauvreté et la précarité.
En outre, d’autres sujets brutaux sont couverts par la société civile, à l’instar de l’équité et la justice. En effet, dans un pays, où la justice est à deux vitesses, les cas de dénonciation d’un pouvoir judiciaire infaillible vont certainement se multiplier. C’est ce que nous observons dans la plupart des pays africains. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par Afrobaromètre sur l’indépendance de la justice en Afrique, comme on le note ici : « Une enquête Afrobaromètre sur les institutions judiciaires a révélé que les tribunaux sont parmi les institutions suscitant le plus de méfiance en Afrique. Près de la moitié des personnes interrogées (43 %) font « pas du tout ou juste un peu » confiance aux tribunaux. Par ailleurs, 33 % des personnes interrogées pensent que tous ou la plupart des juges et des magistrats sont corrompus, et 54 % estiment qu’il est « difficile ou très difficile » d’obtenir de l’aide auprès des tribunaux. ».[18]
Enfin, la tenue des élections libres et transparentes fait défaut le plus souvent en Afrique: « L’adage s’est appliqué à plusieurs élections africaines récentes où les citoyens se sont rendus aux urnes et ont vu le décompte de leurs bulletins de vote manipulés. Les commissions électorales ont annoncé des résultats invraisemblables, qui ont été immédiatement contestés. Les parties lésées ont été invitées à « aller devant les tribunaux » pour obtenir réparation, mais les juges ont rejeté leurs requêtes et confirmé le résultat favorable au président sortant, qui a été dûment investi. Les félicitations ont alors afflué de la part des dirigeants africains et étrangers malgré la fraude électorale avérée. Les récentes élections en République démocratique du Congo (RDC), au Zimbabwe, en Égypte, au Gabon, en Sierra Leone, à Madagascar et en Ouganda semblent avoir suivi cette tendance ».[19]
Généralement, le processus électoral est émaillé de conflits, c’est le point de vue du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS) sur la question dans une note publiée en 2017 : « La violence électorale est déclenchée pendant la période électorale quand des parties en position de force ou de faiblesse constatent que l’autre partie établit de manière unilatérale les règles du jeu électoral qui la favorisent. Les sujets sur lesquels ce déclenchement est plus rapide restent : la mise en place du fichier électoral, la mise en place de l’administration électorale et les résultats électoraux. La violence électorale se manifeste par des actes tels que : la violation du cadre juridique ; les paroles blessantes ou indécentes ; les assassinats ; les coups et blessures entre supporters rivaux ; l’intimidation des adversaires, des électeurs ou des agents électoraux ; le bourrage des urnes ; l’exclusion de communautés »[20]
Comme, nous le savons, la composition de l’organe chargé d’organiser les élections pose beaucoup de problèmes. Les acteurs ne sont pas toujours d’accord sur la légitimité de certains membres de l’organe en question. Du côté du pouvoir, on tente de rassurer, mais on peine à convaincre et du côté de l’opposition, c’est l’amertume et la désolation. En dernier lieu, la société civile cherche à calmer le jeu en invitant les acteurs à discuter et s’entendre sur un minimum de consensus.
Il en est de même après la proclamation des résultats, beaucoup de contestation sont notées pouvant même entraîner des scènes de violences indescriptibles. Les conflits post-électoraux sont visibles un peu partout en Afrique. C’est pourquoi, la société civile s’implique davantage dans tout le processus électoral pour garantir la transparence de celui-ci. Pour assurer la fiabilité des élections, les organisations de la société civile mènent une mission importante comme le mentionne Emmanuel Koukoubou en ces termes : « En somme, il est à retenir que si l’action de la société civile à l’intérieur de la CENA est difficile à appréhender, elle est particulièrement remarquable en dehors de la commission électorale. Dans cette posture, c’est un rôle de garant de la transparence des élections que les organisations de la société civile se sont attribuées ».[21]
Cette liste n’est pas exhaustive, la société civile s’intéresse à d’autres questions comme l’environnement, la protection des données personnelles, la justice sociale etc.
Ainsi, force et de constater que le rôle des mouvements sociaux est primordial pour le bon fonctionnement d’un pays. Le plus important, c’est qu’ils doivent assurer leurs missions avec indépendance et impartialité. Ils doivent rester à équidistance des parties. Souvent, on reproche à la société civile de prendre partie. Autrement dit, le pouvoir la considère comme une opposition alors que sa mission doit être celle d’un organe d’alerte et de sensibilisation.
Bibliographie
[1] GUEYE Daouda, « À PROPOS DU CONCEPT « FRANCE DÉGAGE » », 02/08/219, disponible sur https://www.seneplus.com/opinions/propos-du-concept-france-degage
[2] LÔ Ndèye Khady & Bouboutou- BOUBOUTOU-POOS Rose-Marie « Sentiment anti-français « : quelle est son histoire en Afrique et pourquoi il resurgit aujourd’hui »?, 28 mai 2021, disponible sur https://www.bbc.com/afrique/region-56971100
[3] Nicolas Banncel, « La voie étroite : la sélection des dirigeants africains lors de la transition vers la décolonpisation », Dans Mouvements 2002/3 (no21-22), p.28
[4] LÔ Ndèye Khady & Bouboutou- BOUBOUTOU-POOS Rose-Marie « Sentiment anti-français « : quelle est son histoire en Afrique et pourquoi il resurgit aujourd’hui « ?, 28 mai 2021, disponible sur https://www.bbc.com/afrique/region-56971100
[5] Document Banque Africaine de Développement et Fonds Africain de Développement, « COOPERATION AVEC
LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE POLITIQUE ET DIRECTIVES », OESU, octobre 1999
[6] https://www.lemondepolitique.fr/cours/sociologie/contemporains/_alain_touraine.htm
[7] Fanny Pigeaud, « Manifestations et critiques de Bamako à Dakar Présence française en Afrique, le ras-le-bol », LeMondediplomatique.fr, Mars 2020 disponible sur https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/PIGEAUD/61500, consulté le 26 août 2021.
[8] Deltombe Thomas : « Afrique 1960, la marche vers l’indépendance », Le Monde- diplomatique, disponible surhttps://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_histoire_critique/a5326
[9] https://books.openedition.org/pur/104279?lang=fr
[10] BIANCHINI Pascal, « l’âge anticolonialiste à l’âge anti-impérialiste : Le rôle charnière de l’Union générale des étudiants ouest-africains (Ugeao) à Dakar (1956-1964) », Comprendre le Sénégal et l’Afrique aujourd’hui (2023), pages 497 à 517
[11] MOURE Martin (2023), « Cheikh Anta Diop, l’AERDA et le mouvement étudiant africain à Paris. Une autre Histoire des luttes pour l’indépendance de l’Afrique », Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, n° 4, 35-47, disponible sur : https://oap.unige.ch/journals/rhca/article/view/04mourre
[12] Djabi Nacer, « Société civile », 22 août 2008, disponible sur https://www.jeuneafrique.com/115719/societe/soci-t-civile/
[13] QUANTIN Patrick « Le rôle politique des sociétés civiles en Afrique : vers un rééquilibrage », Dans Revue internationale et stratégique 2008/4 (n° 72), pages 29 à 38
[14]Akindèse Francis et Zina Ousmane, « L’État face au mouvement social en Afrique », Revue Projet 2016/6 (N° 355), pages 83 à 88
[15] Cristina Buzasu, « Le rôle de la société civile dans l’élaboration des politiques », 19 juin 2020
[16] Essoungou André-Michel, « Le réveil de la société civile en Afrique » Afrique Renouveau, Décembre 2013
[17]ALAO Sadikou, « Société civile et bonne gouvernance »
[18] NANTULYA Paul, « La mainmise du régime sur les tribunaux en Afrique », 27 février 2024, disponible sur https://africacenter.org/fr/spotlight/la-mainmise-du-regime-sur-les-tribunaux-en-afrique/
[19] NANTULYA Paul, « La mainmise du régime sur les tribunaux en Afrique », 27 février 2024, disponible sur https://africacenter.org/fr/spotlight/la-mainmise-du-regime-sur-les-tribunaux-en-afrique/
[20] Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (UNOWAS) « COMPRENDRE LA VIOLENCE ÉLECTORALE POUR MIEUX LA PRÉVENIR » 6 décembre 2017, disponible sur https://unowas.unmissions.org/fr/comprendre-la-violence-%C3%A9lectorale-pour-mieux-la-pr%C3%A9venir