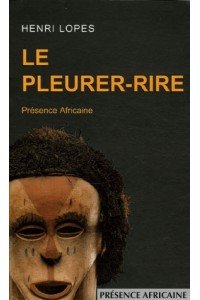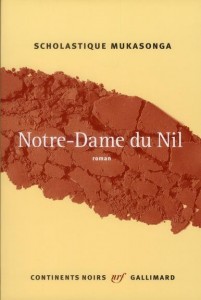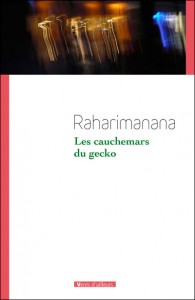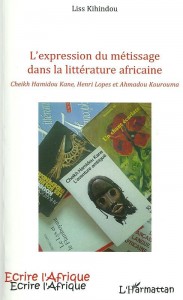Le Congo est encore une colonie française, l’homme Blanc y est maître, tout-puissant, libre d’exploiter les ressources du pays en même temps que ses ressources humaines, avec la bénédiction du prêtre qui se charge d’inculquer aux autochtones que le Blanc représente leur salut : il leur apporte la civilisation, il leur apporte aussi le salut par la foi. Le climat de peur instauré conjointement par la menace de l’Enfer et la puissance des armes de l’homme blanc garantit au colon la soumission des Noirs dont la priorité est désormais de sauver leur peau. Mais la conscience du pouvoir et l’avidité sans bornes qui incite toujours à posséder plus alors qu’on en a déjà trop, poussent parfois à la folie, pour ne pas dire à l’inhumanité. Si Roch Morax avait un cœur, celui-ci devient un roc, inapte à être sensible, ni même à être reconnaissant des bienfaits reçus.
Le Congo est encore une colonie française, l’homme Blanc y est maître, tout-puissant, libre d’exploiter les ressources du pays en même temps que ses ressources humaines, avec la bénédiction du prêtre qui se charge d’inculquer aux autochtones que le Blanc représente leur salut : il leur apporte la civilisation, il leur apporte aussi le salut par la foi. Le climat de peur instauré conjointement par la menace de l’Enfer et la puissance des armes de l’homme blanc garantit au colon la soumission des Noirs dont la priorité est désormais de sauver leur peau. Mais la conscience du pouvoir et l’avidité sans bornes qui incite toujours à posséder plus alors qu’on en a déjà trop, poussent parfois à la folie, pour ne pas dire à l’inhumanité. Si Roch Morax avait un cœur, celui-ci devient un roc, inapte à être sensible, ni même à être reconnaissant des bienfaits reçus.
Roch Morax est le Blanc qui règne à Mossaka et ses environs, dans le Nord du Congo-Brazzaville, une région inondée une bonne partie de l’année, de sorte que les déplacements ne se font qu’en embarcation. Ses affaires sont florissantes : vente d’ivoire, de caoutchouc, de produits de la chasse et de la pêche… Ses désirs sont des ordres. Ses ordres doivent être exécutés avec la plus grande diligence, même au péril de sa vie. Qu’est-ce que la vie d’un Nègre de toutes façons, pour Roch Morax et ceux qui lui ressemblent, sinon qu’elle doit servir au bien-être du Blanc ?
Autant les Noirs sont considérés comme des êtres inférieurs, indignes de la moindre considération de la part du Blanc, autant lorsqu’il s’agit d’assouvir une lubricité intempestive, la femme noire, et bien souvent la jeune fille noire, devient une denrée dont Roch Morax ne peut se passer. Des vierges lui sont livrées, car le bonhomme a les moyens d’obtenir tout ce qu’il désire, toutes celles qui ont le malheur de lui plaire deviennent siennes, même s’il s’agit de la femme de son dévoué serviteur, son sauveur même.
Personne ne restait jamais longtemps au service des Morax à cause de la cruauté du maître, sa femme notamment avait du mal à trouver un cuisinier. Yoka, de la tribu Likouba, finit par accepter. C’est un excellent cuisinier qui a fait ses armes à Brazzaville. Il est marié avec la fille du chef du village de Mossaka, Dongo. Tous deux ont deux enfants : un fils, Mambeké, sportif hors pair, et une fille, Omboka. Le couple blanc de son côté a une fille, Solange. Interdiction formelle est faite à Solange et Mambeké de se fréquenter. Mais la jeunesse n’a aucune considération pour les préjugés, les deux enfants se voient en cachette et échangent leurs savoirs. Solange, qui a environ dix ans, apprend à lire et à écrire à Mambeké qui en a douze. Lui, en retour, lui apprend à nager, à pêcher etc.
Un jour, Solange est entraînée dans les flots du grand fleuve, et serait morte si Mambeké ne s’était pas jeté à l’eau pour la sauver. En remerciement, Roch Morax fera emprisonner sous des prétextes fallacieux son dévoué serviteur Yoka, le père de Mambéké, pour pouvoir mieux jouir de sa femme qu’il trouve irrésistible. Le petit Mambéké est battu puisque l’on découvre que les deux enfants continuaient à se voir, et Solange est envoyée au couvent à Léopoldville, ancien nom de Kinshasa. Roch Morax peut désormais donner libre cours à ses excès, au grand désespoir de sa femme qui, découvrant la conduite ignoble de son mari, se laisse mourir.
 Prendre la plume pour écrire, à cette période de l’histoire, n’est pas une petite chose. C’est même une responsabilité dont Jean Malonga, premier écrivain congolais, est conscient. Il veut montrer l’hypocrisie ou la mauvaise foi qui consiste à faire croire qu’on ne s’installe en Afrique que par pur dévouement, pour apporter la ‘‘civilisation’’ à des êtres humains qui, donc, avant le Blanc, n’avaient pas de vie, n’étaient pas organisés, ne savaient rien, bref étaient dans la nuit totale ! Il a voulu donner la mesure des abus qui ont été commis pendant la période coloniale : ce ne sont pas seulement les richesses du pays qui sont pillées ; mais les vies privées qui sont bafouées, les viols qui sont commis sans que personne ne s’en émeuve, pas même les soi-disant hommes d’église, constituent des faits plus révoltants encore.
Prendre la plume pour écrire, à cette période de l’histoire, n’est pas une petite chose. C’est même une responsabilité dont Jean Malonga, premier écrivain congolais, est conscient. Il veut montrer l’hypocrisie ou la mauvaise foi qui consiste à faire croire qu’on ne s’installe en Afrique que par pur dévouement, pour apporter la ‘‘civilisation’’ à des êtres humains qui, donc, avant le Blanc, n’avaient pas de vie, n’étaient pas organisés, ne savaient rien, bref étaient dans la nuit totale ! Il a voulu donner la mesure des abus qui ont été commis pendant la période coloniale : ce ne sont pas seulement les richesses du pays qui sont pillées ; mais les vies privées qui sont bafouées, les viols qui sont commis sans que personne ne s’en émeuve, pas même les soi-disant hommes d’église, constituent des faits plus révoltants encore.
Des petits Métis, œuvre de Roch Morax, naissent comme des champignons de jeunes filles qui ne sont encore elles-mêmes que des enfants, qui voient leur avenir compromis : qui acceptera de les épouser ? Qui s’occupera de leurs enfants ? Un tout petit nombre de géniteurs blancs acceptent de reconnaître leurs enfants métis ou les traitent avec dignité, comme on peut le voir dans la saga d’Aurore Costa, Nika l’Africaine, dans laquelle le Blanc Manuel pleure sa Négresse Kinia, l’amour de sa vie, et fait tout pour récupérer les deux filles qu’elle lui a données. Je lis avec d’autant plus de plaisir un roman que celui-ci provoque un agréable télescopage dans mon esprit : des scènes de différents romans se croisent dans ma mémoire, tel personnage me fait penser à tel autre et je me laisse entraîner dans une ronde dans laquelle des romans que j’ai appréciés, écrits à différentes époques, par différents auteurs, me tiennent la main : Outre Nika l’Africaine, c’est aux Montagnes bleues de Philippe Vidal, avec la scène du sauvetage de l’enfant du maître, que je pense, c’est de Noir Négoce d’Olivier Merle, dont je me souviens, roman dans lequel on voit l’amour naître entre Blancs et Noirs, à une époque où les peuples ne sont pas encore prêts à une union entre personnes de couleur différente. C’est surtout à African Lady, l’excellent roman de Barbara Wood, que je pense, et il n’en faut pas plus pour que mes doigts se mettent tout de suite en action, pour aller sortir ce roman et relire certains passages chers à ma mémoire. Je pense bien que c’est le roman que mes doigts ont caressé un nombre incalculable de fois, suivi en cela par Au bonheur des Dames de Zola… Je m’égare !
Revenons à Jean Malonga. Tout le monde ne se ressemble pas, tous les Blancs ne sont pas des Roch Morax. Comme le dit si bien Henri Djombo dans sa préface, Cœur d’Aryenne, comme toute œuvre littéraire, « dépeint l’homme non seulement dans ce qu’il a de bestial mais aussi dans ce qu’il a de noble ». La femme de Morax ainsi que sa fille Solange ont plutôt un cœur généreux et c’est sur la jeunesse que se porte l’espoir de Jean Malonga, espoir en l’avènement d’une Humanité faite non d’Aryens, c’est-à-dire de gens qui se considèrent supérieurs, avec d’autres qui passeraient pour inférieurs, mais faite de personnes qui se respectent, qui peuvent s’aimer librement, se compléter, comme le symbolisent Solange et Mambeké, que le destin met sur la route l’un de l’autre. Les nombreux kilomètres qu'on a ménagé entre eux ne les ont pas empêchés de se retrouver… et de s’aimer.
Enfin cette œuvre qui marque la naissance de la littérature, en 1953 (ou en 1954 ? Les sources sont parfois contradictoires, comme on peut le voir dans un numéro de la Revue Notre Librairie, consacré à la littérature congolaise, qui indique 1953 comme année de publication de ce roman dans la Revue des Editions Présence Africaine, puis fournit une autre date quelques pages plus loin : 1954), cette œuvre, disais-je est enfin disponible, grâce aux Editions Hémar et Présence Africaine. La volonté de voir cette œuvre rééditée est née à la suite de la célébration des 60 ans de la littérature congolaise, fin 2013.
Jean Malonga distille dans le texte français des expressions typiques du Nord du Congo. C’est une œuvre que j’aurais aimé intégrer à mon corpus lorsque j’ai publié L’Expression du Métissage dans la Littérature Africaine, puisqu’il s’agit du premier roman congolais, et que déjà son auteur manifeste le désir de faire honneur à la culture de son pays, à ses coutumes, à ses langues, en particulier le Likouba, que Solange, la jeune française, apprend et parle avec aisance. Là encore, je pense à Noir Négoce où le héros du roman, motivé par l’amour, se met à apprendre le wolof en un temps relativement court pour pouvoir communiquer avec sa princesse noire sans intermédiaire. Pour terminer avec les comparaisons, l’intelligence de Mambeké peut faire penser à celle de Christian, le héros des Montagnes bleues. Sa capacité à assimiler les connaissances, à mémoriser les textes ahurissent, c’est le mot, le Père Hux, qui n’aurait jamais soupçonné de telles capacités chez un Nègre.
J’ai aussi aimé la dose d’ironie dont Jean Malonga habille son texte. En voici un exemple :
« Il paraît que cette insouciance invraisemblable de laisser deux enfants, deux gamins ensemble, surtout de race différente – une blanche, c’est-à-dire une maîtresse, et un petit nègre qui n’est autre chose qu’eun vil objet – était un grand crime, une atrocité sans nom au yeux du « bon » Père Hux. Comme cela se devait, il avait d’abord fait un sermon sentencieux à Solange, puni sévèrement Mambeké et averti les parents inconscients et coupables de ce lèse-humanité aryenne. – Ma petite Solange, avait susurré l’apôtre de la fraternité humaine. Ma petite Solange, mais tu es extraordinaire. Comment oses-tu te faire conduire en pirogue par un petit Nègre tout sale ? N’as-tu pas peur de te voir jeter à l’eau par ce sauvage qui se régalera ensuite de ta chair si tendre ? N’as-tu pas peur de te contaminer de sa vermine ? Je ne te comprends pas, mon enfant. Non, réellement, je ne peux pas arriver à te comprendre. Oublies-tu donc que tu es une Blanche, une maîtresse pour tous les Nègres, quels qu’ils soient ? Il faut savoir garder ses distances, que diable ! – Mais mon Père, avait essayé de protester l’innocente Solange. Mais, mon Père, Mambeké est un garçon très habile. Il manie la pagaie mieux que tous ceux de la factorerie. En outre, il est poli, correct, discipliné et ne m’a jamais rien dit de méchant. Il se couperait lutôt la main que de me voir souffrir. Je m’amuse énormément à son bord. »
(Cœur d’Aryenne, pages 22-23)
Liss Kihindou, l'article est tiré de son blog Valets des livres
Jean Malonga, Cœur d’Aryenne, Editions Hémar et Présence Africaine, 2014, 192 pages, 7 €. Première publication Revue Présence Africaine 1953.

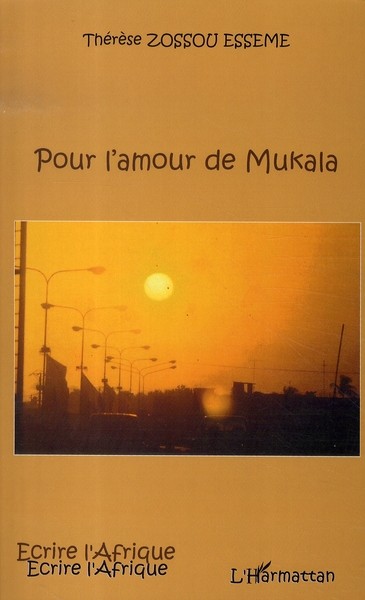 Pour l'amour de Mukala de Thérèse Zossou Esseme est un court récit qui se lit comme on écoute un aïeul nous raconter un conte merveilleux. Merveilleux à cause de l'intervention de faits qui échappent à la raison, des choses qui relèvent du mystique, comme les hommes ayant un double animal qui meurent lorsque ce dernier est tué. Cette croyance, largement répandue en Afrique, est le sujet même du roman Mémoires de Porc-épic d'Alain Mabanckou. Merveilleux aussi parce qu'on a l'impression que, malgré les péripéties, malgré les terribles épreuves auxquelles les deux personnages principaux, Daniel Dika et Yvonne – appelée aussi Mukala – doivent faire face, dans ce roman comme dans les contes, tout est bien qui finit bien. Ce roman se lit comme si on était l'oreille privilégiée d'un ami qui nous fait des confidences, nous fait part de ses souvenirs, de ses espérances, de sa vision de la vie et de l'Afrique.
Pour l'amour de Mukala de Thérèse Zossou Esseme est un court récit qui se lit comme on écoute un aïeul nous raconter un conte merveilleux. Merveilleux à cause de l'intervention de faits qui échappent à la raison, des choses qui relèvent du mystique, comme les hommes ayant un double animal qui meurent lorsque ce dernier est tué. Cette croyance, largement répandue en Afrique, est le sujet même du roman Mémoires de Porc-épic d'Alain Mabanckou. Merveilleux aussi parce qu'on a l'impression que, malgré les péripéties, malgré les terribles épreuves auxquelles les deux personnages principaux, Daniel Dika et Yvonne – appelée aussi Mukala – doivent faire face, dans ce roman comme dans les contes, tout est bien qui finit bien. Ce roman se lit comme si on était l'oreille privilégiée d'un ami qui nous fait des confidences, nous fait part de ses souvenirs, de ses espérances, de sa vision de la vie et de l'Afrique.