 Dans un entretien exclusif du blog cinéafrique d'Anoumou Amekudji, le réalisateur sénégalais Moussa Touré (à gauche sur la photo, aux côtés d'Anoumou Amekudji) aborde la question des migrations dans le cinéma africain. Il constate que par rapport à l’importance des thèmes de l’émigration et de l’immigration dans la réalité, les films africains n’en parlent pas beaucoup. Moussa Touré évoque aussi les réalités des immigrés dans leurs pays d’accueil, sans perdre de vue les difficultés de tous genres qu’ils rencontrent une fois de retour dans leurs pays d’origine. Le cas des femmes que certains immigrés confient à leurs mères au moment de quitter l’Afrique, le préoccupe aussi. Au cours de cet entretien, le cinéaste Touré a parlé aussi de la genèse de son film La pirogue sélectionné pour le festival de Cannes, qui a pris fin le 27 mai 2012.
Dans un entretien exclusif du blog cinéafrique d'Anoumou Amekudji, le réalisateur sénégalais Moussa Touré (à gauche sur la photo, aux côtés d'Anoumou Amekudji) aborde la question des migrations dans le cinéma africain. Il constate que par rapport à l’importance des thèmes de l’émigration et de l’immigration dans la réalité, les films africains n’en parlent pas beaucoup. Moussa Touré évoque aussi les réalités des immigrés dans leurs pays d’accueil, sans perdre de vue les difficultés de tous genres qu’ils rencontrent une fois de retour dans leurs pays d’origine. Le cas des femmes que certains immigrés confient à leurs mères au moment de quitter l’Afrique, le préoccupe aussi. Au cours de cet entretien, le cinéaste Touré a parlé aussi de la genèse de son film La pirogue sélectionné pour le festival de Cannes, qui a pris fin le 27 mai 2012.
De manière générale, dans les films africains, quelle est la place qu’occupe l’émigration vers l’Occident ?
Moussa Touré : Je crois que les films reflètent la vie de tous les jours. Si on compare le phénomène de l’émigration dans la réalité, à sa présence dans les films africains, je pense qu’ils n’en parlent pas beaucoup. Je pense que l’émigration est très légère dans les films. La vraie réalité de l’émigration africaine vers l’Europe n’est pas assez représentée dans le cinéma africain. La majeure partie des films africains a été produite par l’Europe. Pour que votre scenario soit accepte, il faut que vous tombiez d’accord avec les producteurs européens, qui ont décidé de produire votre film. Vous savez, l’Afrique est documentaire, et les gens veulent la fictionner. Quoiqu’il en arrive, ils veulent en faire des fictions. L’Africain aime bien la réalité. Quand il va voir un film, il y recherche la réalité. Comme nous sommes des Africains, nous sommes obligés tout en réalisant des fictions, d’essayer de voir la réalité. Quand nous sommes dans la fiction, on essaie d’y mettre du réel, de la poésie, et bien d’autres choses.
 La vraie réalité de l’immigration, si on veut la poser au cinéma, il faut faire des documentaires. D’ici décembre, je vais faire un film qui s’appellera La pirogue. Il m’a fallu deux ans pour convaincre les producteurs, que pour faire un film sur cet aspect de l’immigration, il faut que ce soit mi-documentaire, mi-fiction. Moi je n’ai pas envie de faire un film de fiction pour dire juste qu’il y a cinq ou quinze jeunes qui emprunte une pirogue pour aller en Espagne. En faisant ce film, ce n’est pas freiner l’immigration, mais apporter de nouveaux éclairages sur la question de l’immigration. Vous savez comment les Africains s’intègrent ? Ils s’intègrent de manière horrible, sauf les Maliens. C’est le cas des Maliens qui m’a vraiment intéressé là-bas. Ils s’intègrent d’une autre manière. Ils travaillent dur et envoient de l’argent au pays. Alors que les Sénégalais, les Togolais, et les autres, aiment bien manger, s’habiller, et en même temps ils veulent s’intégrer dans leur société d’accueil. Les deux ne marchent pas souvent ensemble. D’ici peu de temps, vous verrez un long-métrage sur l’immigration, qui s’intitulera La pirogue. Bon nombre de gens ne sont pas encore au courant de sa prochaine sortie.
La vraie réalité de l’immigration, si on veut la poser au cinéma, il faut faire des documentaires. D’ici décembre, je vais faire un film qui s’appellera La pirogue. Il m’a fallu deux ans pour convaincre les producteurs, que pour faire un film sur cet aspect de l’immigration, il faut que ce soit mi-documentaire, mi-fiction. Moi je n’ai pas envie de faire un film de fiction pour dire juste qu’il y a cinq ou quinze jeunes qui emprunte une pirogue pour aller en Espagne. En faisant ce film, ce n’est pas freiner l’immigration, mais apporter de nouveaux éclairages sur la question de l’immigration. Vous savez comment les Africains s’intègrent ? Ils s’intègrent de manière horrible, sauf les Maliens. C’est le cas des Maliens qui m’a vraiment intéressé là-bas. Ils s’intègrent d’une autre manière. Ils travaillent dur et envoient de l’argent au pays. Alors que les Sénégalais, les Togolais, et les autres, aiment bien manger, s’habiller, et en même temps ils veulent s’intégrer dans leur société d’accueil. Les deux ne marchent pas souvent ensemble. D’ici peu de temps, vous verrez un long-métrage sur l’immigration, qui s’intitulera La pirogue. Bon nombre de gens ne sont pas encore au courant de sa prochaine sortie.
Quels sont les premiers films africains sur la thématique de l’immigration, et comment ont-ils abordé la thématique ?
Le premier film dans ce domaine, est La noire de… de Sembène Ousmane. Sembène faisant partie des premiers cinéastes africains ayant vécu à l’étranger, ne pouvait qu'ouvrir une porte comme celle-là. Vous savez, l’émigration des Africains vers l’Europe ne date pas d’aujourd’hui. Elle a commencé par les gens qui nous président maintenant. Les présidents Wade et Diouf, ont tous été des immigrés en France. Ils revenaient au pays soit avec des femmes blanches, soit ils épousaient au pays des femmes qui ont également été immigrées à Paris. A l’époque de la sortie de La noire de… les films étaient quand même distribués, ce qui fait que les gens avaient pu voir le film. Mais je crois que les Européens l’ont regardé d’une manière assez paternaliste. Parce que La noire de… est un film très fort. Il y attaquait l’Europe d’une manière ou d’une autre. Mais les Européens l’ont vu d’une autre manière.
En Afrique, les gens à ce moment n’étaient pas très intéressés par l’immigration. Seuls des intellectuels s’intéressaient à cette thématique. Aujourd’hui, ce sont plutôt les analphabètes qui émigrent le plus. Les réalités ont changé. Ce qu’on peut dire, c’est que les intellectuels qui ont émigré, ont fait des films sur eux-mêmes. Parce que l’histoire de La noire de… c’est celle de Sembène docker. Ces intellectuels ou immigrés étaient à la recherche d’eux-mêmes, et le cinéma leur est tombé dessus. La plupart de ceux qui font partie de la génération de Sembène ne sont pas allés en Europe dans le but de faire du cinéma. Ils sont partis pour immigrer, et sont finalement devenus cinéastes. Quand on regarde bien, la plupart de ces cinéastes sont mariés ou ont été mariés avec des blanches. Voilà comment est né le cinéaste africain. Le cinéma africain a débuté par l’immigration il y a plus de cinquante ans… Et aujourd’hui, on voit une autre génération de cinéastes africains, qui a émigré en Europe. C’est la génération des personnes comme Abderrahmane Sissako.
Parlant de cette nouvelle génération de cinéastes africains, quelle est la particularité du traitement du thème de l’immigration chez elle ?
Ils ont immigré avec des cigares. Leurs prédécesseurs étaient un peu rudes. Eux ils sont arrivés, ils ont regardé, ils ont été plus malins. Ils se sont attachés à des gens. Ils se sont rendu compte qu’ils pouvaient se poser la question, afin de faire avancer leur carrière. Leur cas est une nouvelle sorte d’immigration, avec un bagage cinématographique, avec un bagage d’intelligence, et puis de la subtilité. Donc ce sont des immigrés subtils. Et dans leur film, cette subtilité est présente, parce qu’il ne faut pas trop frustrer l’autre. Si on veut vraiment parler de l’immigration, c’est frustrant. En France, quand on y est, il ne faut pas frustrer. Il faut rentrer dans la subtilité. Comme on le dit à propos des films français, “il y a beaucoup de subtilités”. Mais dès lors que tu es direct, on va dire que tu es raciste…
Sur le plan cinématographique, le problème que les cinéastes africains ont par rapport à l’immigration, est que dès qu’ils habitent dans un quartier, on les prend pour des immigrés. Un cinéaste est après tout un cinéaste. Leurs collègues français sont bien considérés, alors qu’eux ils sont toujours classés dans la catégorie des immigrés. Cela se remarque quelque part dans leurs films. Moi qui suis ici au Sénégal, je suis plus reconnu qu’eux. Qui va me prendre dans ma maison pour un immigré? Jamais ! Et cela se reflète même dans nos dires. Et nos dires, ce sont nos films. La nouvelle génération de cinéastes africains, qui est dispersée en France, est en train de retourner en Afrique, parce qu’ils ne se sentent pas très bien en Occident, et ils n’osent pas exprimer exactement ce qu’ils veulent dire. Par conséquent, en général ils parlent du retour dans leurs films. C'est le cas de Mama Keïta dans L’Absence par exemple.
A part L’Absence de Mama Keïta qui aborde la question du retour, y-a-t-il d’autres exemples que vous pourriez nous donner ?
Je peux citer des cinéastes comme Abderrahmane Sissako, Jean-Marie Teno, qui parlent du retour dans leurs films Octobre, et Clando. Même le film Teza de l’Ethiopien Hailé Gerima, dans lequel il fait aussi l’historique de son pays. C’est bien beau d’être quelque part et de parler de son pays d’origine. C’est un aspect intéressant de l’immigration. Etre en Afrique, et faire un film dans lequel on prend des positions politiques, n’est pas la même chose que de le faire depuis New York. Voilà la nouvelle génération !
De manière générale, pour le Sénégalais moyen dans la société où vous vivez, qu’est-ce qui symbolise à ses yeux la réussite de l’immigré aujourd’hui ?
De nos jours, ce qui symbolise la réussite c’est d’avoir une belle voiture, une belle villa et puis avoir deux femmes. L’autre symbole de la réussite de l’immigré est de porter des choses qui brillent. Il n’y a pas autre chose. Je fais un film sur la folie. Je suis en train de le monter. Le film, je l’ai tourné à l’hôpital Fann spécialisé dans le traitement des troubles mentaux, à Dakar. Le tournage m’a pris cinq ans. Tous les mercredis, j’étais sous l’arbre à palabres avec les malades. Dans ce film, tous les jours que Dieu fait il y a une femme dont le mari est immigré, qui devient folle et est emmenée à l’hôpital pour les soins. Ces femmes viennent souvent de la banlieue, tandis que les maris sont originaires la plupart du temps de Touba. Les femmes dont je parle dans le film logent souvent dans une grande maison avec les belles-mères, qui deviennent finalement les maris. Ces épouses d’immigrés sont donc traumatisées par les attitudes des belles-mères. Ce qui reflète la réussite d’un bon immigré, c’est d’avoir une femme traumatisée. Le retour que vous évoquez sera fait de retours catastrophiques. Catastrophiques ! Catastrophiques ! Que font les immigrés en Occident ? Ils font du commerce. Qui achète maintenant ? J’étais à Barcelone récemment. Dans les magasins il y a deux personnes. Dans les restaurants il n’y a personne. Les immigrés vendent des choses à la sauvette. Personne n’achète plus rien. Tout le monde le sait. Préparons-nous à des retours catastrophiques de ces immigrés, car il n’y a plus d’argent.
Selon vous, malgré les problèmes que vous évoquez, les immigrés vont rentrer ou vont rester en Occident ?
Je pense qu’ils vont préférer mourir là-bas, que de rentrer au pays. Nous qui sommes ici, nous n’allons pas accepter de prendre en charge des immigrés. Nous avons déjà d’autres personnes sur place ici qu’il faut prendre en charge. Ils vont se débrouiller. Je ne pense qu’ils aient le courage de rentrer. Ils ont fait du mal à plein de femmes ici. Ils sont venus arracher des femmes à la vie tranquille qu’elles menaient au pays. Nous leur en voulons pour tout cela.
Propos recueillis par Anoumou Amekudji, l'intégralité de l'interview est disponible sur son blog, cinéafrique.org
 Comment vivre tout en sachant qu’on est en train de passer son dernier jour sur la terre, à côté de ceux qui vous aiment et vous méprisent?
Comment vivre tout en sachant qu’on est en train de passer son dernier jour sur la terre, à côté de ceux qui vous aiment et vous méprisent?


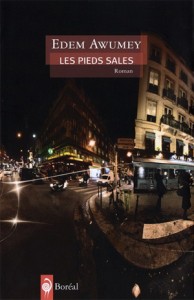 Passionné par les romans traitant de
Passionné par les romans traitant de 