 Mère d’une petite fille de 11 ans, d’origine ivoirienne, Lynda Aphing-kouassi est la Directrice Générale du Cabinet International KAIZENE, un des cabinet de formation de renom en Afrique basé à Londres Pall Mall Piccadilly et à Abidjan Zone 4.
Mère d’une petite fille de 11 ans, d’origine ivoirienne, Lynda Aphing-kouassi est la Directrice Générale du Cabinet International KAIZENE, un des cabinet de formation de renom en Afrique basé à Londres Pall Mall Piccadilly et à Abidjan Zone 4.
Diplômée de l’université de Hull, elle a commencé à travailler dans le domaine bancaire à Santander, la Société Générale, Vaultex (une filiale du groupe HSBC) en tant que responsable d’équipe, directrice des investissements puis banquière d’affaires à Londres, membre du Conseil d’Administration de l’Organisation for Talents Within (organisation non gouvernementale à Atlanta) et membre de l’Institut des Directeurs de Londres (I.O.D). Elle milite en faveur d’une Afrique innovante, capable de prendre son destin en main à travers l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes. Lynda est résolument engagée à apporter sa pierre à l’édifice pour le développement de l’Afrique.
ADI : Pouvez-vous nous en dire plus sur les origines du cabinet KAIZENE ?
Tout d’abord sachez que le Cabinet KAIZENE vient du mot « Kaizen » d’origine japonaise qui une très ancienne pratique de formation qui signifie détermination, le changement pour le meilleur ainsi que la continuité dans le développement et le perfectionnement.
La pratique « Kaizen » est reconnue mondialement comme une méthode compétitive aboutissant au succès, mais est également le pilier de la stratégie d’avancement que toute organisation devrait pratiquer selon nous, car elle assimile à la fois le développement personnel et celui de l’entreprise.
Ainsi créé depuis 2015, KAIZENE, Cabinet international basé à Londres et à Abidjan, est spécialisé dans le renforcement des capacités des entreprises publiques et privées, Formations Professionnelles, compétences techniques et non techniques, Coaching, Responsabilité sociétale et Conférence annuelle sur les infrastructures et BTP à savoir :
1.DÉCEMBRE 2015 : OIL MINING AND GAS – LONDRES
2.AVRIL 2016 : SECTEUR PÉTROLIER DÉFIS ET OPPORTUNITÉS – ABIDJAN
3.OCTOBRE 2016 : ELECTRIFICATION DE L’AFRIQUE – CAPE TOWN
4.DÉCEMBRE 2017 : BTP ET INFRASTRUCTURES – DAKAR
5.DÉCEMBRE 2018 : BTP ET INFRASTRUCTURES – KIGALI
La 6ème édition est prévue en Ethiopie en Octobre 2019
ADI : Vous avez décidé de créer votre propre entreprise. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Apres identification de certains problèmes axés sur le capital humain j’ai eu La volonté de contribuer au développement de nos sociétés et en particulier de fournir des services à valeur ajoutée permettant de renforcer nos capacités et de renforcer l’importance du capital humain dans les entreprises et de promouvoir les talents pour le développement de notre société.
Mon objectif est également de travailler avec les entreprises pour développer leurs missions de RSE afin de créer des actions durables pour nos pays et de contribuer à l’autonomisation de la femme.
Mais surtout parce que j’avais un rêve de grande envergure auquel je croyais vraiment qui répondait a un problème de notre société et pour lequel je travaille avec acharnement et détermination.
ADI : Faites-vous face à beaucoup de concurrence ? Quelle stratégie avez-vous adopté afin de relever ce défi ?
Le marché de nos jours est de plus en plus concurrentiel, nos collaborateurs représentent alors notre atout principal.
Nous mettons l’accent sur les formations ludiques qui sont à caractère personnel, nous offrons également des formations sur mesure, un coaching en développement personnel et par-dessus tout, nous n’oublions pas nous-mêmes de nous former et de nous documenter constamment pour être les meilleures versions de nous-mêmes afin de pouvoir aider les autres à travers nos formules afin d’être les meilleures versions d’eux-mêmes. Nous travaillons aussi sur des programmes axés pour les femmes et leur développement.
ADI : Comment avez-vous financé votre début de la phase création d’entreprise ?
J’avais quelques économies, pas un montant énorme mais je me suis néanmoins engagée et j’ai même offert des formations gratuites afin de me faire connaitre.
J’ai surtout eu la Fondatrice de l’école Grain de soleil qui a eu confiance en nous et a accepté de nous donner une chance ce qui nous a permis d’avoir un fond de roulement pour continuer et ainsi démarra notre belle expérience.
ADI : Qu’en est-il du marché de la formation et du coaching en Afrique ?
L’optimisation de nos ressources humaines nécessite d’une part la convergence entre les objectifs personnels de vos employés (liberté d’expression-image- recherche de reconnaissance mesurée), et d’autre part le développement de la culture et la vision de l’entreprise. C’est ainsi que la formation prend tout son sens. De nombreuses études démontrent l’efficacité de la formation dans la croissance de l’entreprise et dans le processus de développement d’un État. Les résultats de la formation sont concrets et mesurables tant dans la productivité que dans la montée en puissance économique du pays.
Grâce à ses effets de levier sur la croissance et l’emploi, la formation professionnelle est primordiale pour les pays développés et nos pays en développement, en zones rurales et urbaines. Elle permet d’accompagner la croissance et la compétitivité des entreprises d’une part, et prévenir l’exclusion des jeunes du marché du travail d’autre part, car vecteur d’une croissance inclusive et durable.
Le coaching est très important car, sert à réécrire notre histoire, nous permet d’impacter positivement, de créer l’inspiration en l’autre et de devenir un leader ; étant ainsi une solution pertinente et efficace qui permet d’explorer les solutions possibles pour résoudre la situation actuelle d’une personne et l’aider à définir ses actions à mettre en œuvre pour atteindre ses solutions désirées. Concernant le coaching axé sur le genre précisément des femmes, le travail s’accentue davantage sur leur développement personnel, leur personnalité, l’intelligence émotionnelle et sur leur estime de soi afin de prendre leur place dans les postes directionnels et aussi de mieux s’affirmer dans la société.
ADI : Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face et qui vous suivent aujourd’hui ?
L’intégration :
Il faut apprendre à mieux connaitre son environnement et l’intégrer sans complexes. La meilleure manière de l’intégrer est d’être humble et demander de l’aide quand le besoin se présente. Rester soi-même mais faire preuve de sérieux quand il s’agit du travail. Comprendre sa motivation première.
Le genre :
Le fait d’être une femme dans le passé ne facilitait pas le sérieux durant les échanges et parfois ses échanges déviaient vers le rapport social. Il a fallu une rigueur et une fermeté pour obtenir les contrats par mérite me voyant parfois obligée de refuser certains si je sentais que l’intérêt était autre que le travail. L’absence de parité également à des postes de responsabilité il est important de regarder la femme dans le milieu du travail comme son égal et surtout lui donner la crédibilité qu’elle mérite dans ses taches.
L’estime de soi :
La connaissance de moi et la confiance en moi la détermination et la motivation m’ont beaucoup aidé à surmonter ses principales difficultés parmi d’autres car ils m’ont permis d’apprendre à avoir confiance en moi, à croire en moi et à apprécier les échecs et m’en souvenir comme des expériences positives me permettant de ne rien regretter. Par-dessus tout le support de ma famille, ma fille et mon réseau féminin m’ont permis d’aller au-delà de ses difficultés et de les surmonter avec force et ténacité. Eviter de compromettre sa moralité et ses principes.
La réputation :
Nous commettons tous des erreurs et ne pouvons pas faire l’unanimité le plus important est de continuer à travailler et croire au processus. Chaque erreur est une leçon il faut savoir se relever après ses erreurs et quelque soit la durée se relever et faire preuve de force et de détermination pour ne pas laisser la place au découragement quand les critiques ne sont pas positives. Réparer du mieux que possible ses fautes et continuer l’aventure la détermination le travail bien fait et le temps nous feront toujours surmonter le négatif et répareront toujours notre réputation. Par-dessus tout faire de son mieux pour préserver sa réputation mais continuer à prendre des risques pour se développer et de diriger selon ses principes et ses valeurs. Ne jamais laisser l’opinion négative des personnes définir qui nous sommes.
Cependant, aujourd’hui j’ai pu surmonter toutes ces difficultés et je peux affirmer qu’elles n’existent plus.
ADI : C’est quoi pour vous la responsabilité sociétale et quel est son importance pour les entreprises ?
La Responsabilité sociétale pour moi c’est le développement humain et le respect de notre Environnement.
C’est l’élément prioritaire dans le développement des entreprises. Ainsi, dans toutes les actions que nous menons (nos prestations, projets et activités, etc.), nous nous assurons de leur valeur ajoutée. Il en est de même pour chacun de nos employés avec lesquels nous formons une « Unité de développement ».
Toute entreprise et tout Etat pour se développer et être productif doit se doter d’une politique de gouvernance adéquate et adopter des règles de conformité et d’éthiques qui permettent de répondre aux préoccupations sociales et environnementales de droits de l’homme et des clients et la RSE favorise le respect des droits de l’homme et contribue au développement durable et bien-être de nos sociétés en prenant en compte les attentes de toutes les parties prenantes. Une politique de RSE est nécessaire pour tous et son importance est à un très haut niveau.
ADI : Quelle est la stratégie globale de votre entreprise pour l’atteinte des ODD ?
A Kaizene nous insistons plus sur :
- L’Accès à une éducation de qualité : à travers nos formations qualifiantes, spécialisées et adaptées aux besoins des professionnels et aux jeunes que nous encourageons dans leurs initiatives d’entrepreneuriat après identification de leur aptitudes à être entrepreneurs car nous ne sommes pas tous appelés à être entrepreneurs.
- L’Égalité du genre : par notre engagement pour l’entrepreneuriat féminin autonomisation de la femme, la parité dans les conseils d’administration, la formation des femmes et des jeunes sur le leadership féminin, la confiance en soi et l’estime de soi, la prise de parole et la communication parmi tant d’autres.
- L’Innovation et les infrastructures : chaque année nous organisons des conférences ayant pour but de répondre aux défis infrastructurels de notre continent. Ces conférences visent à accroitre les investissements en faveur de l’innovation, l’énergie, des logements et des transports afin de travailler à la réduction de la pauvreté et de palier aux soucis de nos populations.
- Les Partenariats pour les objectifs mondiaux : l’un des objectifs de nos conférences annuelles est de favoriser la création de partenariat entre le secteur public et privé et des synergies autour des enjeux infrastructurels pour le développement du continent, des enjeux de la formation avec pour objectifs de pouvoir outiller nos populations afin de favoriser un partenariat gagnant- gagnant.
ADI : Quels conseils donneriez-vous aux étudiants et aux jeunes diplômés qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat ?
- Aux femmes tout d’abord, elles doivent être conscientes que leur féminité n’est pas une faiblesse, mais une opportunité à saisir afin d’exceller dans tout milieu.
- Rester soi-même et ne pas accepter ce qui n’est pas acceptable. Avoir une estime de soi et se documenter constamment, faire des recherches car la connaissance est notre pilier comme nous le traduit la bible. Etre Humble et ne pas laisser la société dicter qui nous devons êtres.
- Ensuite, définir ce que représente pour chacun la réussite professionnelle (réussite financière, de réussite sociale, d’accomplissement de soi, de bonheur au travail, de conciliation travail-famille, inspirer les autres…). Cette étape est essentielle afin d’établir un plan d’action et de développement pour y arriver. Pour exceller dans quoi que ce soit, il est essentiel de miser sur ses talents.
- Il est donc essentiel de connaitre ses forces naturelles et ses limites (sans oublier son objectif !) afin de pouvoir les utiliser, optimiser le développement de leur carrière, atteindre leurs objectifs, en misant sur les accélérateurs et la formation appropriée cela pour maîtriser notre intelligence émotionnelle et ne pas hésiter à en apporter de l’empathie et notre maîtrise du risque afin de contribuer au développement du changement.
- L’entrepreneuriat n’est pas un moyen de devenir milliardaire à la première tentative c’est vraiment une expérience difficile, qui nécessite un travail avec acharnement et l’identification d’une solution a un problème de la société et une confiance en Dieu, en soi et en son idée. Mais une expérience magnifique.
- Se doter d’un état d’esprit de gagnant et assumer ses échecs et accepter les critiques et rester patients.
- Un autre point à prendre en considération est de développer son réseau de contacts car le succès, c’est aussi les relations. Pour booster votre carrière, il faut savoir s’entourer des bons contacts et réseaux d’influence auprès desquels l’on peut s’instruire, apprendre mutuellement et se développer tous ensemble. Il faut trouver son mentor cette personne assez connecte qui pourrai en tout temps et en toute chose se porter garant pour vous et garant de vos références.
Tels sont pour Lynda Aphing-kouassi d’excellents moyens de favoriser le développement de nos entrepreneurs.
Pour plus d’info :



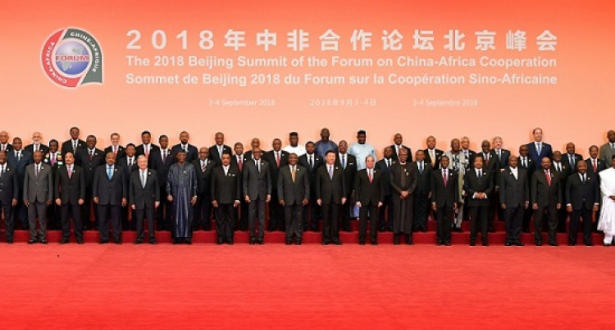

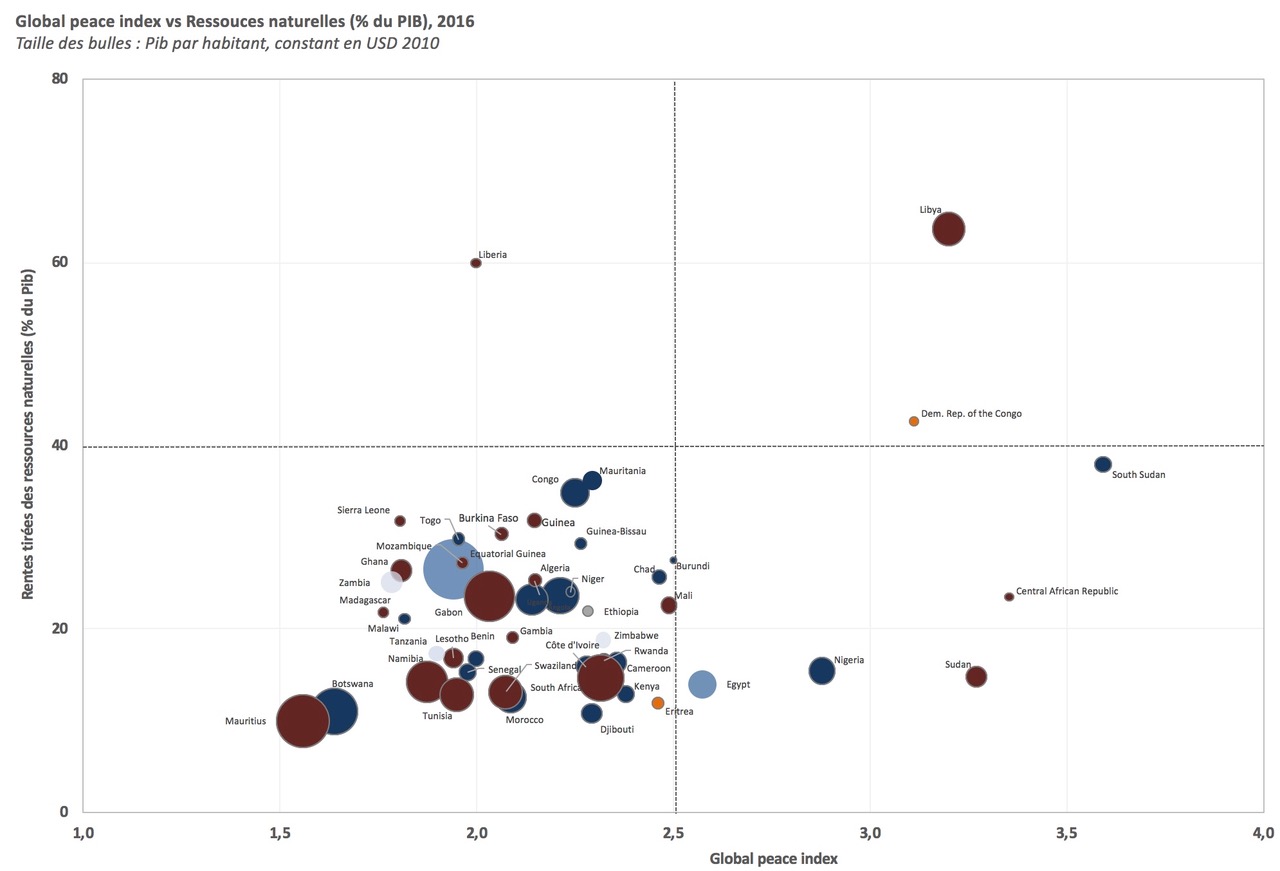
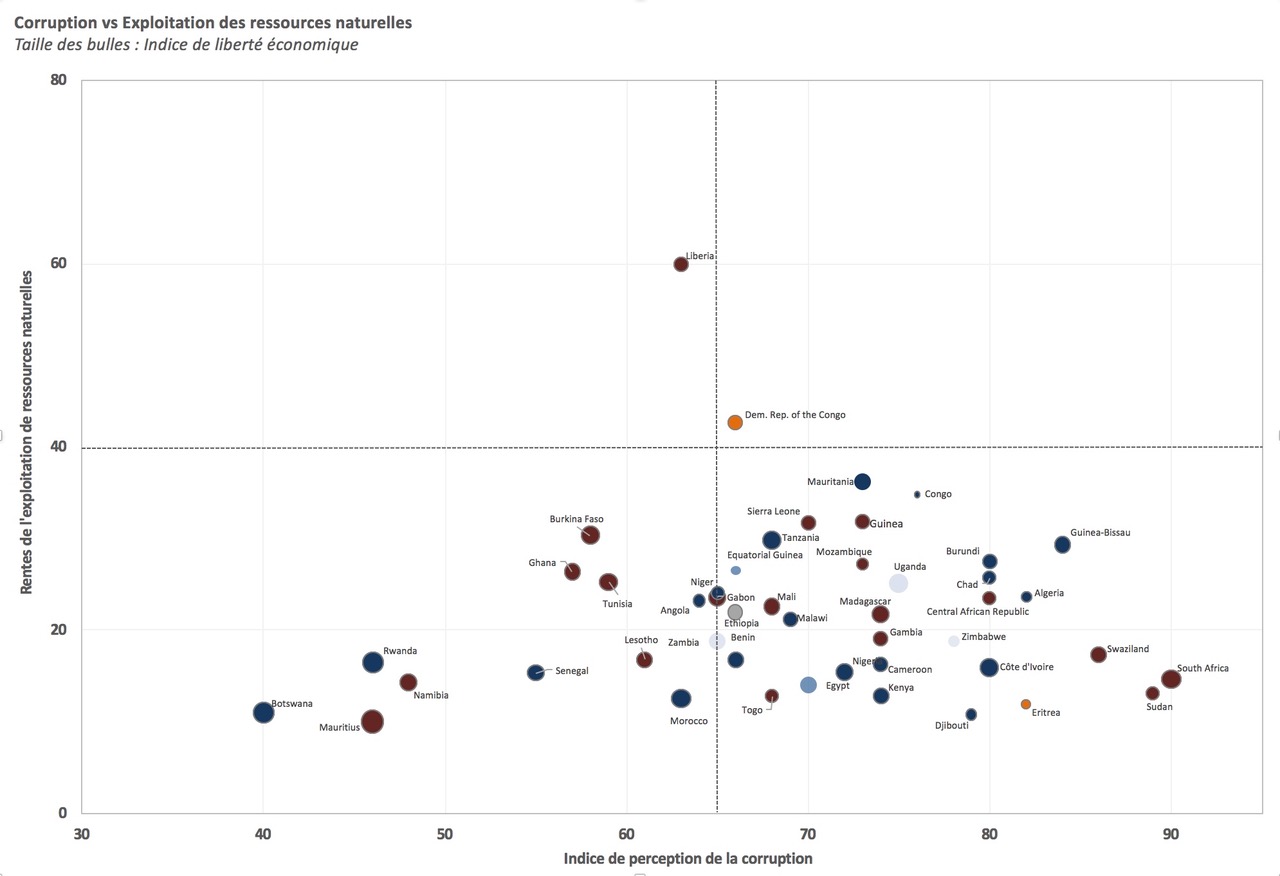

 La naissance de la zone de libre échange continentale (ZLEC), dont l’accord a été signé en grande pompe le 21 mars au sommet de l’Union Africaine (UA) à Kigali, s’inscrit dans une trajectoire linéaire. Dans les années suivant les indépendances, le panafricanisme avait le vent en poupe, favorisant une velléité d’initiatives intergouvernementales de coopération économique multisectorielle et d’initiatives bilatérales ou multinationales mono-sectorielles. Le traité d’Abuja, en 1994, en prévoyant la Communauté Économique Africaine (CEA) d’ici 2027, pose les jalons de l’intégration continentale avec une monnaie commune, une mobilité des facteurs de production et la libre circulation des biens et des services. Le traité ouvre aussi la voie à la mise en place de Communautés Economiques Régionales (CER). Depuis lors, quatorze CER ont été créées
La naissance de la zone de libre échange continentale (ZLEC), dont l’accord a été signé en grande pompe le 21 mars au sommet de l’Union Africaine (UA) à Kigali, s’inscrit dans une trajectoire linéaire. Dans les années suivant les indépendances, le panafricanisme avait le vent en poupe, favorisant une velléité d’initiatives intergouvernementales de coopération économique multisectorielle et d’initiatives bilatérales ou multinationales mono-sectorielles. Le traité d’Abuja, en 1994, en prévoyant la Communauté Économique Africaine (CEA) d’ici 2027, pose les jalons de l’intégration continentale avec une monnaie commune, une mobilité des facteurs de production et la libre circulation des biens et des services. Le traité ouvre aussi la voie à la mise en place de Communautés Economiques Régionales (CER). Depuis lors, quatorze CER ont été créées Comme au début de chaque année, le mois de janvier 2018 n’a pas échappé aux ballets d’annonces des performances macroéconomiques des pays africains. Et comme depuis un certain nombre d’années maintenant, l’Afrique est au premier rang en matière d’économies les plus prospères ; certains classements positionnant d’ailleurs six pays africains dans le top dix des économies en croissance sur l’année à venir.
Comme au début de chaque année, le mois de janvier 2018 n’a pas échappé aux ballets d’annonces des performances macroéconomiques des pays africains. Et comme depuis un certain nombre d’années maintenant, l’Afrique est au premier rang en matière d’économies les plus prospères ; certains classements positionnant d’ailleurs six pays africains dans le top dix des économies en croissance sur l’année à venir. L’ANC a voulu offrir une sortie honorable à son leader contesté en lui proposant de présenter lui-même sa démission. C’était sans compter sur la tenacité de Jacob ZUMA qui tenait à son baroud d’honneur. Il s’est accroché au pouvoir contre vents et marées. Il a défié son propre parti en refusant dans un premier temps de démissioner. La menace de la motion de censure initiée par son propre camp le 14 fevrier 2018 a cependant eu raison de lui.
L’ANC a voulu offrir une sortie honorable à son leader contesté en lui proposant de présenter lui-même sa démission. C’était sans compter sur la tenacité de Jacob ZUMA qui tenait à son baroud d’honneur. Il s’est accroché au pouvoir contre vents et marées. Il a défié son propre parti en refusant dans un premier temps de démissioner. La menace de la motion de censure initiée par son propre camp le 14 fevrier 2018 a cependant eu raison de lui. La Banque Africaine de Développement a publié le mercredi 17 janvier dernier l’édition 2018 de son rapport sur les Perspectives Economiques en Afrique. Cette édition se démarque des précédentes et marque une certaine rupture dans la production de ce document. L’institution semble s’être appropriée totalement l’exercice, tant dans la forme que dans le fond. Le document sera désormais publié à la mi-janvier de chaque année, au lieu de juin, période traditionnelle de publication du rapport. L’institution assure vouloir être celle qui propose en premier des informations économiques sur l’Afrique, prenant ainsi à contre-pied le Fmi qui jusque-là établissait des prévisions sur les performances économiques en Afrique, en avril de chaque année. Le volume est réduit de moitié et seule la BAD a produit et signé cette édition – contrairement aux autres éditions co-signées avec l’OCDE et le PNUD. Elle va proposer aussi des sous rapports pour chacune des cinq régions du continent, une première.
La Banque Africaine de Développement a publié le mercredi 17 janvier dernier l’édition 2018 de son rapport sur les Perspectives Economiques en Afrique. Cette édition se démarque des précédentes et marque une certaine rupture dans la production de ce document. L’institution semble s’être appropriée totalement l’exercice, tant dans la forme que dans le fond. Le document sera désormais publié à la mi-janvier de chaque année, au lieu de juin, période traditionnelle de publication du rapport. L’institution assure vouloir être celle qui propose en premier des informations économiques sur l’Afrique, prenant ainsi à contre-pied le Fmi qui jusque-là établissait des prévisions sur les performances économiques en Afrique, en avril de chaque année. Le volume est réduit de moitié et seule la BAD a produit et signé cette édition – contrairement aux autres éditions co-signées avec l’OCDE et le PNUD. Elle va proposer aussi des sous rapports pour chacune des cinq régions du continent, une première. Depuis un certain nombre d’années, on voit se multiplier partout en Afrique des “Journées Nationales des TIC”, portées et promues par des ministres de l’Economie Numérique qui veulent de plus en plus nous faire croire que le numérique ou le digital serait la réponse à tous les maux de l’Afrique.
Depuis un certain nombre d’années, on voit se multiplier partout en Afrique des “Journées Nationales des TIC”, portées et promues par des ministres de l’Economie Numérique qui veulent de plus en plus nous faire croire que le numérique ou le digital serait la réponse à tous les maux de l’Afrique. L’ Année 2018 démarre sous les pires auspices en République démocratique du Congo, ce pays qui porte si mal son nom, où des forces de l’ordre usent de gaz lacrymogène et tirent à balles réelles à la sortie des églises.
L’ Année 2018 démarre sous les pires auspices en République démocratique du Congo, ce pays qui porte si mal son nom, où des forces de l’ordre usent de gaz lacrymogène et tirent à balles réelles à la sortie des églises. 