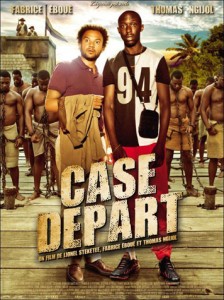Aïcha Dème se définit comme une activiste ou une agitatrice culturelle. À Dakar, où se côtoient allègrement, sans forcément se toucher, le gratin local et les gens issus de la banlieue, tous également nourris à grands coups d’afflux culturels émanant des quatre coins du monde, elle se débat, depuis pratiquement une décennie, après avoir sacrifié son emploi de l’époque, pour assouvir sa passion de l’art, de la culture, et du divertissement. Portrait d’une figure incontournable de l’univers culturel sénégalais.
Si le grand public la connaît très peu – il s’agit là d’une personne discrète qui préfère rester derrière les projecteurs, les témoignages de sympathie et de reconnaissance de la part des professionnels du milieu affluent. Ancienne professionnelle de l’informatique, c’est en 2009 qu’elle se décide à changer de voie pour s’orienter dans la promotion d’une culture sénégalaise très peu présente sur la toile. Armée de son expérience de passionnée qui avait assisté à un grand nombre d’événements culturels[1], et qui cherchait compulsivement à rassembler des infos sur les sujets, elle réussit très rapidement à se faire un carnet d’adresses et à acquérir une certaine légitimité dans le milieu. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée d’un agenda en ligne, ayant compris la force que représentaient les nouveaux outils de communication dans cette entreprise. Elle crée donc AgenDakar, le premier portail sénégalais entièrement dédié à la culture, sous la forme d’un hub permettant de recenser les évènements et productions artistiques dans la presqu’île et au-delà. Sur le même site, elle a pendant longtemps tenu un journal de bord, signé Aïe-Chat, son avatar félin, dans lequel elle croquait, avec bienveillance, le monde culturel dakarois, partageait ses expériences, ses coups de cœur, donnait ses impressions après les rencontres, concerts et autres festivals de la région, en ponctuant ses articles de « Miaou » légers et bien sentis.
Elle est aujourd’hui très active sur les réseaux sociaux, où nous avons pu abondamment échanger. « Dakar vibre, Dakar bouillonne, et Dakar déborde de créativité, répète-t-elle inlassablement. Je considère que c’est un devoir de mettre cela en lumière, et en plus j’adore le faire. C’est complètement grisant et je pense que personne n’a jamais été aussi heureux que moi de changer de métier ».
Quand, de façon terre à terre, je lui rappelle que la pauvreté frappe la majorité des habitants de la région, ce qui laisse assez peu de place à toute initiative culturelle, elle me corrige : « Le Dakar culturel s'extirpe comme il peut de la misère. La créativité est bien présente, et les jeunes sont débrouillards. Le Dakar le plus créatif, le plus actif et le plus vibrant, c'est celui qui connaît le plus la misère. C'est celui de la culture urbaine, celui de la banlieue ». Puis elle rajoute, lucide : « Bien sûr, quand on parle culture, il y a toujours cette niche, ces trucs de bourgeois où on retrouve les mêmes personnes entre expositions, danse contemporaine et autres… Mais tu trouveras des expos dingues au cœur de la Médina, avec des vernissages agrémentés de « gerte caaf » et « café Touba »[2], ainsi que des initiatives incroyables menées par les gens de la banlieue ». Elle prend l’exemple du Festa2H, d’africulturban : « Ce festival a été créé il y a dix ans maintenant, avec dix personnes et zéro de budget. Aujourd'hui, ils sont mille à y être affiliés, avec un budget de 150 000 euros pour chaque édition. Ils ont créé des emplois, formé des jeunes, ont des projets avec des détenus pour leur réinsertion. Ils font bouger des montagnes avec un dynamisme et un professionnalisme remarquables. Ils ont aussi formé les premières femmes « graffistes » et DJs au Sénégal ». À l’évocation du frein que peuvent constituer les prétendues valeurs sénégalaises que sont le « masla »[3] et autres, elle répond de façon catégorique :
« Ce sont des gens directs et carrés, qui ont envie d’aller vite, et bien. Amadou Fall BÂ, le directeur de Festa2H, par exemple, est un modèle d’efficacité. Il est réputé dans Dakar pour répondre à tous ses mails même à 4 heures du matin », conclut-elle, badine.
Quand je note que, finalement, la culture au Sénégal souffre surtout de l’indigence des relais entre les acteurs du monde artistique et le grand public, elle réagit : « Justement, j’allais te dire que c’est là que se situe notre rôle. Tout le monde n’a pas conscience du travail qu’abattent ces gens, mon combat, c’est de le faire savoir, de montrer cette Afrique créative qui bouge et fait bouger les lignes de Johannesburg à Nouakchott ». Car l’œuvre de Aïcha est essentiellement panafricaine. Elle est aujourd’hui vice-présidente de « Music in Africa », une plate-forme continentale qui permet, entre autres, de faciliter les échanges culturels entre pays.
Concernant AgenDakar, Aïsha a passé la main. Elle se consacre notamment à son agence d’ingénierie culturelle, qui propose divers services sur des plates-formes variées. Elle est intervenue dans plusieurs talks de par le monde afin de présenter l’entrepreneuriat culturel – si cher à son idole Angélique KIDJO qu’elle a eu la chance d’interviewer ; et a aussi lancé, entre autres initiatives, la vague CultureMakers afin « de mettre en lumière tous les trésors culturels partout en Afrique ».
Vous pourrez trouver toute son actualité sur son site personnel, vitrine polyvalente, où il est possible de retrouver ses anciennes chroniques, même si, freudienne, elle déclare vouloir tuer le Chat, symbole d’une vie passée.