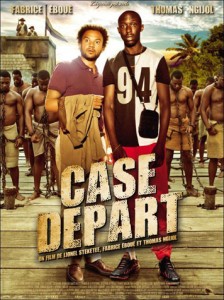La croissance économique africaine est peut-être discutable et exagérée, mais il l’est tout autant de suggérer que l’Afrique devrait suivre aveuglément les traces des états émergents et autoritaires d’Asie.
La croissance économique africaine est peut-être discutable et exagérée, mais il l’est tout autant de suggérer que l’Afrique devrait suivre aveuglément les traces des états émergents et autoritaires d’Asie.
Dans sa récente publication dans Foreign Policy, Rick Rowden affirme que le bas niveau d’industrialisation de l’Afrique laisse penser que le continent n’est pas « le miracle de croissance » que décrivent certains observateurs. Son article, qui est une réponse à une analyse très optimiste publiée par McKinsey, The Economist, et Time Magazine, entre autres, bat en brèche l’hypothèse d’une croissance économique en Afrique, la qualifiant de « mythe ». Selon lui, étant donné que l’Afrique ne participe qu’à une infime partie du commerce mondial, elle ne peut pas être mis au même niveau que les économies asiatiques.
Des exemples à suivre
Si Rowden a raison d’attirer l’attention sur l’exagération irrationnelle qui va souvent de pair avec l’évocation d’une « croissance économique africaine », son argumentation reste très affaiblie, du point de vue analytique et des solutions préconisées. Tout d’abord, Rowden présente une description très enjolivée de la « croissance miracle » des pays de l’Asie de l’Est. Il affirme que ce groupe – souvent désigné par l’expression « Tigres de l’Asie » et comprenant la Corée du Sud, Taïwan, et Singapour, avec la Chine en plus – a réussi à développer sa capacité de production, en créant en très peu de temps des emplois. Selon lui, étant donné que ces pays ont effectué « un très bon travail », les économies africaines devraient, logiquement, en faire de même.
Cependant, si les politiques industrielles asiatiques ont rapidement donné des résultats, elles ont aussi été appliquées par le biais de plans autoritaires et répressifs qui ont souvent mené à des violations manifestes des droits de l’homme. Ainsi, on entend souvent parler de technocrates bénévoles, de subventions généreusement allouées, de stratégies d’exportation intelligemment conçues, et de protectionnisme afin de favoriser l’industrie locale. En revanche, on entend beaucoup moins parler des règles quasi-martiales, de la répression dans le travail, des prêts accordés de façon opaque aux nababs, ou encore des manifestations violentes contre les changements constitutionnels non démocratiques ; tous ces points furent pourtant des parties intégrantes de ce « modèle de développement ».
Que dirait-on d’un Etat africain qui imposerait la loi martiale et maintiendrait les salaires bas au nom d’une « compétitivité internationale », un Etat qui marcherait sur les droits des travailleurs, où seraient arrêtés les responsables des syndicats ? Un Etat qui dans le même temps fermerait les yeux sur les activités des industriels corrompus, tant que les quotas d’exportation sont satisfaits ? Un Etat qui pourtant recevrait une aide importante des USA en échange des terres extirpées aux paysans locaux qui perdent ainsi leur principal gagne-pain ? Séduisantes méthodes, non ? Ceci est pourtant une description de la Corée du Sud lors de sa phase de croissance « miracle ». Et si le programme de réforme agraire coréen (initié, il faut le préciser, par l’armée américaine) a mené à une distribution plus équitable des terres, certains observateurs affirment que cela n’a pas amélioré la situation des paysans, qui devaient rembourser leurs dettes, sur une durée de cinq ans, à des taux usuraires, au gouvernement qui dans le même temps continuait à maintenir artificiellement les coûts de production à un bas niveau.
 Mais malgré la répression et l’autoritarisme mis en place, des pays comme la Corée du Sud et Singapour n’ont pas réussi leur mutation en une seule décennie, ce qui représente les délais que se fixent les « afro-optimistes » dans leur analyse, et que Rowden rejette en déclarant qu’il n’y a pas encore eu de révolution structurelle pouvant le permettre. Mais nos réserves ne se portent pas seulement sur l’expérience est-asiatique. L’Angleterre a été prise par Rowden dans son article comme autre exemple (comme l’original, en réalité) de la doctrine du « développement par l’industrialisation ». Il faudrait rappeler les implications du processus « d’industrialisation » de l’Angleterre : l’asservissement et la colonisation de la moitié de la planète pour faciliter l’accès aux matières premières, l’exploitation de la classe ouvrière domestique en tant que main d’œuvre bon marché, et le cercle d’inclusion qui consistait en la privatisation d’une terre sous un prétexte agricole, poussant tous les habitants, à l’exception des propriétaires, vers le dénuement, et, par extension, les usines et les mines, où beaucoup d’entre eux périrent.
Mais malgré la répression et l’autoritarisme mis en place, des pays comme la Corée du Sud et Singapour n’ont pas réussi leur mutation en une seule décennie, ce qui représente les délais que se fixent les « afro-optimistes » dans leur analyse, et que Rowden rejette en déclarant qu’il n’y a pas encore eu de révolution structurelle pouvant le permettre. Mais nos réserves ne se portent pas seulement sur l’expérience est-asiatique. L’Angleterre a été prise par Rowden dans son article comme autre exemple (comme l’original, en réalité) de la doctrine du « développement par l’industrialisation ». Il faudrait rappeler les implications du processus « d’industrialisation » de l’Angleterre : l’asservissement et la colonisation de la moitié de la planète pour faciliter l’accès aux matières premières, l’exploitation de la classe ouvrière domestique en tant que main d’œuvre bon marché, et le cercle d’inclusion qui consistait en la privatisation d’une terre sous un prétexte agricole, poussant tous les habitants, à l’exception des propriétaires, vers le dénuement, et, par extension, les usines et les mines, où beaucoup d’entre eux périrent.
Des données peu fiables
Même en se basant sur des données strictement économiques, l’analyse de Rowden reste faible. Son point de vue sur le plan de la production semble être essentiellement basé sur deux rapports : un de l’ONU, et un autre de la Banque Africaine du Développement (BAD). Toute analyse de la BAD doit être prise avec des pincettes, car il s’agit quand même d’une institution qui a déclaré qu’il y avait 300 millions d’africains appartenant à la classe moyenne, considérant que tous ceux qui gagnaient entre 2 et 20 dollars appartenaient à cette catégorie. 60% de ce groupe gagnait entre 2 et 4 dollars par jour, franchissant à peine le seuil de pauvreté… La critique, basée sur de telles données, passe à côté des avancées qu’a connues le secteur de la production, sur le terrain. Des zones de traitement industriel émergent dans beaucoup de marchés locaux, d’Ethiopie au Ghana, participant à l’approvisionnement de plusieurs industries, autant à l’est qu'à l’ouest du continent, dans des secteurs aussi divers que le textile, les chaussures, le bois et les meubles, le cuir, l’automobile, et d’autres biens de grande consommation. L’application du Africa Growth and Opportunity Act, une loi américaine, a permis la multiplication par trois des importations – hors pétrole – américaines provenant de l’Afrique sur des produits tels que les textiles et vêtements, les produits agricoles manufacturés et les chaussures.
Ce choix de Rowden pose d’autres problèmes, en ce sens qu’il nourrit une vue simpliste qui présente les produits manufacturés comme de simples marchandises ; en considérant que les matières premières et les ressources naturelles sont de « mauvais » types d’exportation, et affirmant qu’une grande dépendance dans les produits basés sur ce type de ressources est l’indication d’un « bas niveau de diversification économique et d’une absence de progrès technologique ». Il s’agit là d’une très vieille idée reçue, émise par les économistes Raul Prebisch et Hans Singer. Mais les choses ne sont aussi simples : certains penseurs ont déjà fait remarquer qu’en se basant sur une réflexion aussi étriquée, un pays comptant beaucoup d’ateliers de pressurage à une échelle industrielle serait considéré comme « développé », nonobstant la qualité de vie de ses citoyens.
L’idée que les pays développés doivent passer des exportations de produits à base de ressources naturelles à celles des produits manufacturés est trop simpliste, surtout quand on considère le fonctionnement réel des marchés. Le profil commerçant de beaucoup des actuels pays riches et industrialisés du monde – le Canada, les USA, la Norvège, l’Australie et la Nouvelle-Zélande inclus – compte une grande part d’exportation de ressources et marchandises naturelles. Les marchés des puissances émergentes sont souvent dominés par des exportations de produits naturels aussi. L’agriculture, les combustibles et les produits miniers comptent pour 63% des exportations du Brésil, comparé aux 32,8% d’exportations de produits manufacturés – tout en important 72% de produits industriels. Il s’agit là d’un pays dont le commerce repose essentiellement sur ses ressources naturelles, et il s’agit aussi d’un pays qui, de par ses multiples initiatives sur le plan de la protection sociale, a, de façon historique, réduit les inégalités de façon plus drastique que quiconque, et a aussi capitalisé la plus grande évolution en terme de bien-être de ses habitants sur les cinq dernières années, d’après une étude du Boston Consulting Group.
Le Chili, aujourd’hui membre de l’OCDE, a une économie essentiellement dominée par l’exploitation de ressources naturelles, surtout le cuivre. Les éléments manufacturés constituent seulement 13% des exportations du pays. Et l’un des Etats en voie de développement les plus brillants en Afrique – et l’un des rares, globalement, à avoir un modèle solide de gouvernance démocratique – est le Botswana, grand pays exportateur de diamants. Rick Rowden semble considérer les exportations de produits naturels comme un indicateur de sous-développement, en notant qu’ils ont baissé « jusqu’à un niveau aussi bas que 13% en 2008 » en Asie et dans le Pacifique, constituant de toute évidence une avancée majeure : c’est tout simplement faux. Ces marchés ont des taux très bas d’exportations de ce type parce qu’ils n’ont pas plus de ressources naturelles que ce qu’ils consomment, ce qui en fait de faibles exportateurs. Il n’y a qu’à voir les efforts fébriles des compagnies de pétrole asiatiques en Afrique pour comprendre que leurs pays d’origine seraient très satisfaits si, grâce aux bienfaits de la géologie, ils avaient plus de ressources de ce genre dans leur sol.
 Ce qu’il faut noter, c’est que les pays ne « laissent pas tomber » leurs exportations de produits naturels dès lors qu’ils deviennent industrialisés, ou qu’ils sont en voie de le devenir, comme des enfants enlèveraient les petites roues de leurs vélos. En vue d’un développement réussi, ce qui importe, ce n’est pas qu’un pays choisisse de vendre des produits manufacturés ou le contraire : le succès repose sur des paramètres plus complexes, sur les institutions locales et les résultats obtenus.
Ce qu’il faut noter, c’est que les pays ne « laissent pas tomber » leurs exportations de produits naturels dès lors qu’ils deviennent industrialisés, ou qu’ils sont en voie de le devenir, comme des enfants enlèveraient les petites roues de leurs vélos. En vue d’un développement réussi, ce qui importe, ce n’est pas qu’un pays choisisse de vendre des produits manufacturés ou le contraire : le succès repose sur des paramètres plus complexes, sur les institutions locales et les résultats obtenus.
Un optimisme mesuré
Certains observateurs trop optimistes concernant l’Afrique se sont peut-être laissés aller à une exubérance clairement irrationnelle, en ne considérant que les revenus à foison, les télévisions à écran plat, et la classe moyenne composée de 300 millions de personnes. Mais on ne peut pas simplement considérer la croissance en Afrique comme un mythe, surtout si on prend en compte les bases sur lesquelles Rowden s’appuie. Si les économistes sont prompts à présenter les Etats asiatiques comme les symboles et les modèles d’une industrialisation fulgurante, ils ne devraient pas passer sous silence les réalités socio-politiques de ces pays– les structures autoritaires inhérentes à une évolution capitaliste rapide. De plus, il est nécessaire d’effectuer plus de recherches sur le terrain afin d’établir avec exactitude la valeur qu’acquiert le marché africain ; à ce niveau, citer deux rapports ne suffit pas.
Les économies des pays africains ont, bien sûr, besoin de développer les secteurs requérant plus de main d’œuvre, couvrant la production industrielle d’assemblage, les services, et une gamme variée de produits manufacturés. En réalité, ce processus est déjà en cours, mais se manifeste d’une façon différente : l’évolution « rapide » n’est pas une considération neutre en terme de délais, et en la préconisant, il faut être prêt à accepter les plans politiques qui en sont à l’origine. Les défenseurs d’un « état de croissance » peuvent arguer que la douleur est le prix à payer pour la réussite économique, et que les générations futures en seraient les premiers bénéficiaires. Mais nous devons garder à l’esprit aussi bien les processus que les objectifs, sans omettre les réalités qui ont sous-tendu ces processus. En fin de compte, avant d’encourager certains modèles, nous devrions avoir cette maxime de Confucius en mémoire : « N’impose jamais aux autres ce que tu n’accepterais pas pour toi-même ».
Adam Robert Green, article initialement paru chez notre partenaire Think Africa Press, traduit de l'anglais par Souleymane LY