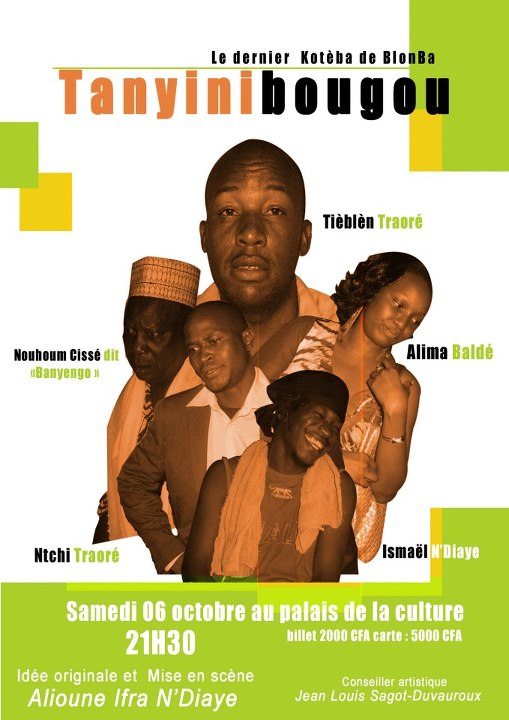La chose la plus choyée. Tel signifie en français Limbvani, le nom de ce Téké de 46 ans, heureux papa de deux enfants, issu d’une fratrie de onze frères et sœurs, enfant star dans le Brazza des eighties, qui revient d’une tournée de plusieurs mois en Amérique latine et au Québec, avec son adaptation d’Hamlet. Adaptation née en 2004, lors d’une résidence à Dakar et qui en huit années d’existence, a été représentée dans 31 pays, parmi lesquels on peut citer l’Allemagne, l’Argentine, le Chili, le Niger, le Sénégal, la Suisse.
La chose la plus choyée. Tel signifie en français Limbvani, le nom de ce Téké de 46 ans, heureux papa de deux enfants, issu d’une fratrie de onze frères et sœurs, enfant star dans le Brazza des eighties, qui revient d’une tournée de plusieurs mois en Amérique latine et au Québec, avec son adaptation d’Hamlet. Adaptation née en 2004, lors d’une résidence à Dakar et qui en huit années d’existence, a été représentée dans 31 pays, parmi lesquels on peut citer l’Allemagne, l’Argentine, le Chili, le Niger, le Sénégal, la Suisse.
Hamlet est une pièce du XVIIe siècle, de l’Anglais William Shakespeare, qui traite de thèmes existentiels et de société comme le vide de l’existence, le suicide, la crainte de l’au-delà, l’avilissement de la chair, le mariage forcé ; à travers le meurtre d’un roi par son frère qui, d’amant, deviendra l’époux de la veuve et le nouveau roi, conformément à la tradition. Face à ce couple criminel, un jeune prince, Hamlet, partagé entre son devoir de vengeance pour l’honneur de son père et ses devoirs de prince pour l’harmonie du royaume.
Hugues Serge Limbvani (HSL), notre Téké, a repris à 90% cette pièce élisabéthaine pour en faire une création originale, où l’action se déroule en terre africaine et où le doigt est pointé sur la condition féminine : mariage forcé, voie au chapitre, gloire et vertu de l’hymen préservé. Autant de sujets d’alors, qui sont encore d’aujourd’hui. Concours de circonstances, heureux hasard, un Gangoueus (mon responsable de rubrique) au carnet d’adresses bien rempli ? Toujours est-il que lorsqu’elle s’est présentée, j’ai saisi l’occasion de suivre la troupe Bosangani qui, après son périple international, a fini sa saison à Chinon. Je vous propose ci-après le journal de bord de cette intrusion au cœur d’une troupe de théâtre.
Mercredi 14/11/2012
8H : dans le cheval blanc mécanique
Départ de Porte d’Italie pour Chinon. A l’arrière, bouches en o et yeux ébaubis de fatigue, les têtes ballottent au rythme de notre cheval blanc mécanique : les uns sont en récupération de nuits trop courtes, les autres sont en conversation très privée. A l’avant, je suis assise entre le metteur en scène congolais HSL et l’Ivoirien Diabate Ngouamoué aka Polonius, aka 1er fossoyeur ; une bibliothèque vivante, thésard, ethno-méthodologue, qui a connu l’école (rendue obligatoire par décret colonial à tous les enfants de l’Afrique Occidentale Française) à l’âge des prémisses de l’adolescence (pour lui, jugement supplétif pour lui donner la chance d’une éducation pour tous). Les échanges sont riches. On égratigne aussi bien la géopolitique, la culture de la palabre que la distance entre nos élites intellectuelles auréolées de savoirs exotiques et leurs anciens. Les premiers récits passionnants de tournée des uns et des autres me parviennent également. Le brouillard épais, la musique de Wendo, de Madilu, d’Akedengue ou d’Aznavour passe ainsi presque inaperçue. Les kilomètres semblent foulés au grand galop, nous voilà déjà au cœur de la cité médiévale.
12H : un déjeuner haute culture
Une forteresse royale, une Vienne au repos, une ville de vins, de fortifications, telle est Chinon, le pays de François Rabelais ; ce prêtre catholique évangélique, médecin et auteur humaniste qui accoucha au XVIe siècle d’un géant glouton : Gargantua. Pour nous accueillir à l’Espace Rabelais, des techniciens : Fred, le baraqué ; Francis, le chocovore : une tablette pour une tasse de café. Des membres du service culturel de la mairie : Sarah, la stagiaire cherchant sa voie et qui a commis la bévue d’avouer aimer manger épicé. Nos amis de Bosangani, spécialistes du détournement verbal s’en donneront à cœur joie. Un des nombreux moments d’anthologie que j’aurai à partager avec eux. Il y a également Viviane du pôle administratif et financier, Elise, Eric, Chloé, Franck…
Au menu, après les betteraves et salades piémontaises de l’entrée, Viviane nous sert un couscous halal ! Le Sénégalais Abdoulaye Seydi aka Laerte, aka Rosencrantz, aka Marcellus, aka un Comédien, interroge : « Viviane, aurons-nous demain un Tiep bou dien ? » Et c’est reparti ! Viviane devient enfant de la Teranga, on la donne en mariage au célèbre petit frère du grand Youssou, ce chanteur qui voulait devenir président. Désormais on appelle Viviane, Madame Ndour. Après le couscous, suivront les fromages, yaourts, fruits, cafés, desserts chocolatés. Vous avez dit gargantuesque ? Zygomatiques, mâchoires et langues ont fait leur travail. La suite !
 14H : spectacle vivant – une gestion à flux tendus
14H : spectacle vivant – une gestion à flux tendus
Nouvelle salle. Nouvelle arène. Après s’être sustentés et avoir donné à sa langue un petit échauffement avec des jeux de mots hautement relevés, la troupe se dirige vers la salle de spectacle attenante, pour une première prise de contact. On récite son texte. On écoute l’écho que renvoie l’architecture. On arpente la scène. On découvre les loges. La troupe en a connu des espaces en 31 pays de migration ! Grands espaces, haute technologie et luxe à Québec. Communisme asphyxiant à Cuba. Scène d’orage en Suisse. Tenues fesse-tives au Brésil… Chacun ayant marqué son territoire, pris ses repères et jauger un public qui n’est pas encore là, on se déporte vers l’hôtel.
Délice de kitsch, décor de roman d’Agatha Christie, avec un chat fier jouant les sourds, un jeune chiot, Hermine, qui pensait mes tresses comestibles, le Plantagenêt serait un cadre idéal pour un petit meurtre entre comédiens ! Mais l’heure est à un repos royalement mérité. Ou à quelques palabres bien senties sur cette condition d’artiste. Je n’aurai pas le temps de tendre l’oreille. Avec HSL, nous quittons la petite Angleterre pour acheter un billet de train à Vict Ngoma aka Horatio, qui remplacera au pied levé le comédien qui ne s’est pas présenté au départ de la Porte d’Italie. Un contentieux entre employeur et employé. Chut !
15H : De nombreuses ressources à mobiliser pour mener sa compagnie sur plusieurs continents
Réglages sons, conduite de lumières, impression du texte de la pièce pour les techniciens, liste des invités ; HSL est sur tous les fronts. Comment fait-il ? Est-ce d’avoir mangé beaucoup de manioc, de saka-saka ou de nkoko (quelques délices du Congo) ? Ses ressources, en plus d’une énergie folle, viennent aussi de ce que le théâtre, la vie d’artiste, n’ayant pas bonne presse dans le Congo de son époque, son père le laissait vivre cette distraction, à condition d’être toujours parmi les deux premiers au classement scolaire. Cette rigueur pour pouvoir s’adonner à sa passion, l’ont conduit à une licence en économie au Congo, un Master en économie en France puis un autre à la Conception et la Mise en œuvre de projets culturels.
 De plus, le champ des possibles artistiques étant restreint pour les Noirs en France, il a renoncé à la bataille des petits rôles et des silhouettes pour entrer de plain-pied dans la guerre du rôle sur mesure. Un parcours semé d’embuches mais aussi de victoires au goût de paradis. Parcours qui m’a rappelée celui du cinéaste béninois Sylvestre Amoussou, pour jouer quelqu’un d’autre qu’un voyou ou un marabout. Vous savez, ces figures familières dans l’inconscient du téléspectateur lambda. Côté finances ? En France, les ressources viennent en premier lieu des subventions publiques. La DRAC est à cette enseigne un des interlocuteurs dédiés pour les faiseurs de spectacle. Malheureusement, cette dépendance face aux subsides de l’Etat a tué plus d’une compagnie : délais importants dans le traitement des dossiers, orientations culturelles, etc. HSL a donc préféré s’en libérer au maximum. Dans une logique entrepreneuriale, il finance bon nombre de ses projets sur fonds propres ou en report de budget. Investir aujourd’hui pour gagner demain. Financer une pièce avec les entrées de la précédente. Le but étant la visibilité : un produit doit être connu pour être demandé sur le marché ; il n’hésite pas à prendre des risques (thèmes, formats, etc.) pour faire connaître sa vision. Il faut certes penser au public potentiel, mais l’artiste est avant tout un agitateur et même, un avant-gardiste !
De plus, le champ des possibles artistiques étant restreint pour les Noirs en France, il a renoncé à la bataille des petits rôles et des silhouettes pour entrer de plain-pied dans la guerre du rôle sur mesure. Un parcours semé d’embuches mais aussi de victoires au goût de paradis. Parcours qui m’a rappelée celui du cinéaste béninois Sylvestre Amoussou, pour jouer quelqu’un d’autre qu’un voyou ou un marabout. Vous savez, ces figures familières dans l’inconscient du téléspectateur lambda. Côté finances ? En France, les ressources viennent en premier lieu des subventions publiques. La DRAC est à cette enseigne un des interlocuteurs dédiés pour les faiseurs de spectacle. Malheureusement, cette dépendance face aux subsides de l’Etat a tué plus d’une compagnie : délais importants dans le traitement des dossiers, orientations culturelles, etc. HSL a donc préféré s’en libérer au maximum. Dans une logique entrepreneuriale, il finance bon nombre de ses projets sur fonds propres ou en report de budget. Investir aujourd’hui pour gagner demain. Financer une pièce avec les entrées de la précédente. Le but étant la visibilité : un produit doit être connu pour être demandé sur le marché ; il n’hésite pas à prendre des risques (thèmes, formats, etc.) pour faire connaître sa vision. Il faut certes penser au public potentiel, mais l’artiste est avant tout un agitateur et même, un avant-gardiste !
Côté humain ? Il faut avoir les nerfs solides et faire appel à tous ses talents de manager. Régler un problème de paie avec un comédien avec lequel on passera quelques minutes après sur scène impose sang-froid, savoir-vivre, professionnalisme, tant dans ses obligations d’employeur que de metteur en scène. Le spectateur se déplace en effet pour apprécier une œuvre. Pour le reste ? Un téléphone, internet, la palabre. Rien ne tombe tout seul dans le bec. Même la Bible encourage à l’action. Message à ceux qui attendent les mains croisées, sous prétexte de prier.
16H : Ne pas confondre culture et divertissement
En imperméable beige et écharpe rouge, un homme peste sur le désordre du présentoir à l’entrée de l’Espace Rabelais. Je l’aide à ramasser tracts et flyers éparpillés dans un mouvement d’impatience alors qu’il les rangeait. Il s’agit de Dominique Marchès, le directeur artistique du Service culturel de Chinon. Passionné d’art contemporain, entre autres faits d’armes, il vient prendre la température de l’organisation.
HSL demande des modifications, la distribution ayant changé, mais également, le nom de sa compagnie. Me voilà transportée dans les locaux du service culturel de Chinon pour suivre les modifications et réimpressions de supports. Surréaliste ? Non ! Je suis du Zaïre, où l’article 15 de la constitution de la Province du Sud Kasaï assenait à ses citoyens : débrouillez-vous ! Ainsi donc, je me débrouille comme je peux pour mener ma petite enquête et profiter du lieu pour prendre la température du patient Culture. Le patient pour l’instant, ne se porte pas trop mal économiquement, même si en ces temps de crise, les budgets publics sont revus à la baisse, les urgences étant ailleurs. Mais philosophiquement, la culture ne veut plus dire grand-chose. Le public consomme sans analyse, sans enjeu, sans questionnement. Symptomatique d’une époque où l’on a l’impression d’avoir mené toutes les batailles ? La distribution est mise à jour avec les noms des comédiens qui représenteront Hamlet le lendemain. En savant perroquet, j’explique à Chloé que Bosangani, le nouveau nom de la compagnie, qui signifie rassemblement en lingala, est plus porteur que Boyokani qui signifie entente. En effet, le rassemblement implique l’adhésion de tous, dans l’acceptation de toutes les diversités : âges, pays, cultures, religions, sexes, idéaux.
 18h30 : Afrique-Europe, deux continents, deux visions du jeu
18h30 : Afrique-Europe, deux continents, deux visions du jeu
Habitué de la scène sur les deux continents, HSL nous le confirme, il y a une différence entre l’Afrique et l’Europe sur le rapport au théâtre et aux arts en général. Le public africain ne fait pas dans la circonvolution. Très dur, les artistes ne sont pas à l’abri de Remboursez ! sonores et repris en chœur par la foule, lorsque la prestation n’a pas été convaincante. Tandis qu’en Europe, une distance entre le travail de l’artiste et l’accueil du public sera mise en exergue. C’est donc avec une certaine délectation masochiste qu’HSL aime éprouver ses pièces en terres africaines.
De son côté, Franck Betermin aka le spectre, aka Guildenstern, aka un Comédien, aka 2ème fossoyeur m’apprendra, citant Peter Brook, qu’il y a en Europe, un jeu qui va du sommet du crâne au menton. Quid du reste du corps ? J’imagine que pendant que les voix portaient haut le verbe, les corps élevaient les sculpteurs au sommet de leur art. Si la scène africaine ne manque pas de vitalité, elle souffre par contre de son manque d’ambitions, de son manque de moyens. Le théâtre africain est un théâtre fonctionnel qui parle aux gens des gens. Maboke ou Masolo aux deux Congo, Koteba au Mali, Hira gasy à Madagascar, etc. Et nous les avons déserté, ces théâtres, pour séduire un public occidental, plus à même de payer pour la culture. L’argent appelle l’argent…dit la chanson.
La culture, qui est un élément de base dans chaque évènement, dans chaque manifestation, est notre quotidien en Afrique. Mais nous avons tendance à oublier nos fondamentaux, à apprendre l’autre avant de se connaître soi, à oublier d’où l’on vient. Et ce, au point de ne plus savoir décrypter nos propres codes. Et ce, jusqu’à pousser l’automutilation en nous soustrayant de la communauté humaine qui crée des universaux culturels, des universaux qui sont le lieu commun de cette même humanité. Ainsi par exemple au théâtre, le boulevard n’est pas une spécificité française, c’est un style qui se décline, dans diverses cultures. Et HSL est fier d’avoir pu brandir l’étendard congolais, dans des contrées reculées du Chili par exemple, où Noir, comme Congolais, étaient autant de nouveautés.
Et pendant ce temps-là à Chinon, les comédiens font un filage allégé. Les uns, les autres connaissent la pièce. C’est pour Vict Ngoma aka Horatio et la Française Marie Do Freval aka Gertrude qu’une répétition un peu plus poussée sera nécessaire. Pour Vict Ngoma, vous avez lu la raison plus haut. Pour Marie Do Freval qui a fait partie de la distribution en 2006, il s’agit de remplacer la comédienne congolaise qui, n’ayant pas obtenu de visa, n’a pu faire le déplacement.
20H : De Bacchus…
Avec Abdoulaye Seydi et la reine Marie Do Freval, nous sommes de la suite de notre prince Hamlet, aka HSL, pour ripailler chez la famille Brazey, les marionnettistes de la Compagnie du Petit Monde. La chanteuse Manue est également de la partie. Vie d’artiste, famille, condition animale, OGM, culture, voyages, nous trinquons au chinon mais pour tout l’Indre-et-Loire : pas de rivalité entre communes à table. Exception pour Abdoulaye Seydi, car le chinon n’est pas encore halal ! Rires et embrassades, nous retournons au Plantagenêt.
01H : …A Morphée !
Après chaque jour, vient une nuit. Et je dis merci. La journée a été passionnante et longue !
Gaylord Lukanga Feza
A suivre sur Terangaweb – l'Afrique des idées : le jour II du journal de bord
 A force de rencontre, de mariages, de divorces, et de métissage, la culture africaine a essaimé donnant naissance à de nombreux styles de danse ou encore de musique… Aujourd’hui plus que jamais la culture africaine s’exporte et traverse les âges, elle vit hors du continent grâce à la diaspora et à ses amis.
A force de rencontre, de mariages, de divorces, et de métissage, la culture africaine a essaimé donnant naissance à de nombreux styles de danse ou encore de musique… Aujourd’hui plus que jamais la culture africaine s’exporte et traverse les âges, elle vit hors du continent grâce à la diaspora et à ses amis.