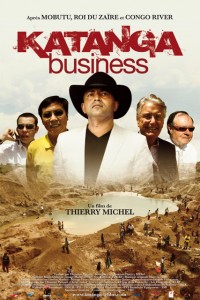« Le poète comme boxeur », Kateb Yacine mis en scène par Kheireddine Lardjam, avec Larbi Bestam et Azzedine Benamara
« Le poète comme boxeur », Kateb Yacine mis en scène par Kheireddine Lardjam, avec Larbi Bestam et Azzedine Benamara
Entretien avec Kheireddine Lardjam, le metteur en scène de la pièce.
Votre pièce est intitulée « le poète comme boxeur » en référence à cette citation de Kateb Yacine « Il y a en Algérie cette impulsion qui vient du plus profond des masses, cette aspiration vers la lumière qui fait qu’on vous porte à bout de bras ; on aide un poète comme on aide un boxeur ». Y a-t-il toujours en Algérie ce même engouement populaire pour la culture en général et le théâtre en particulier ?
Ce qui m’a intéressé dans ce recueil d’entretiens que j’ai mis en scène, c’est la parole de Kateb Yacine, pas lui. Elle m’interroge sur n’importe quel poète, le poète universel. Quelle est la place du poète dans nos sociétés de consommation par exemple ? Le poète est, je cite Kateb Yacine, « au sein de la perturbation, l’éternel perturbateur… Le poète, c’est la révolution à l’état nu, le mouvement même de la vie dans une incessante explosion».
Ces quelques lignes, ces paroles, je les recommande à tous les artistes et le spectateur qui viennent voir ce spectacle, je le prends à contrepied : il n’est pas là, juste pour recevoir, il porte véritablement les artistes. En 1997, j’ai effectué une tournée dans le triangle de la mort de l’époque (Alger, Medea, Relizane). Cela a été une année sanglante où les artistes ont été pris pour cibles, notamment à Oran. Beaucoup sont morts assassinés comme Alloua, Ferhdeheb… Je ne faisais pas, à l’époque, cette tournée par engagement, mais parce que le mois du ramadan est un mois culturel. Nous avons joué alors dans un village appelé Theniet El Had qui signifie et cela est très poétique « le pli de l’horizon ». A la fin de la représentation, l’équipe d’organisation nous a laissé à la rue. Aucun hébergement, ni repas n’avait été prévu. Et c’est donc à 22h que le public, apprenant cela, s’est mobilisé pour nous héberger dans la plus belle de leurs demeures et se sont cotisés pour nous offrir le repas. Naturellement, j’ai été très surpris de l’ampleur de la mobilisation et quand j’en ai parlé avec un vieux du public, il m’a alors dit « ce que vous faites est dangereux et très important pour notre société ». Depuis ce jour-là, j’ai décidé de faire du théâtre mon métier.
En Algérie, il semble que le théâtre reste tout de même plus populaire que le cinéma.
Vous savez quelle a été la première « entreprise » nationalisée au lendemain de l’Indépendance, avant même le pétrole ? Le théâtre, en 1963. Le pouvoir connaissait sa force et le théâtre a conservé une grande place pendant très longtemps. Ce que je fais comme théâtre, c’est un théâtre de l’urgence. A un événement correspond toujours une pièce de théâtre.
Votre théâtre est, me semble-t-il, très lié au journalisme. Vous avez été vous-même journaliste. Vous collaborez avec, entre autres, Mustapha Benfodil qui est auteur de théâtre, mais aussi journaliste. Et cette pièce, vous l’avez mise en scène, à partir d’un recueil d’entretiens de Kateb Yacine avec des journalistes.
Je ne fais pas un théâtre documentaire, ni un théâtre d’informations. Vous n’êtes pas la première à me le dire, mais si vous voyez ce lien entre théâtre et journalisme, il n’est sûrement pas conscient de ma part. Je fais un théâtre engagé et pour moi, le vrai théâtre en Algérie, ce théâtre engagé, n’est pas du tout soutenu. Ma compagnie va bientôt être la plus vieille compagnie d’Algérie. Elle a 15 ans et elle est complètement indépendante.
Existe-t-il en Algérie une politique de soutien du théâtre ?
Absolument pas. D’ailleurs, si vous allez sur le site du Ministère de la culturelle sur l’onglet « politique culturelle », vous trouverez le message « page en construction ». Pour l’homme de théâtre que je suis, c’est vraiment tout un symbole.
Kateb Yacine a une relation forte avec l’Afrique…
Kateb Yacine est le premier intellectuel algérien à avoir revendiqué l’africanité. Moi aussi, je suis africain avant d’être algérien. Je suis allé à Dakar, Bamako… et là-bas, j’ai retrouvé plus de trucs de chez moi qu’en allant au Liban ou en Syrie. Je me sens plus africain qu’arabe. Ecoutez la musique de Larbi Bestam, musicien dans notre pièce, c’est une musique africaine avant d’être algérienne. Comme algérien, je me sens africain, berbère, arabe. Pour citer Kateb Yacine « l’Algérie arabe n’existe pas ». L’histoire algérienne telle qu’elle est officiellement enseignée ne débute qu’avec l’histoire musulmane de l’Algérie qu’on nous fait croire pacifiée. « Aslim taslim ». N’oublions pas que c’était avant tout une conquête. Mais ne passons pas aussi dans l’autre extrême, l’algérianité doit passer aussi avant la berbérité.
 Vous avez joué cette pièce d’abord en Algérie. L’avez-vous joué en français ?
Vous avez joué cette pièce d’abord en Algérie. L’avez-vous joué en français ?
Oui, j’ai joué la pièce en français en Algérie car la pièce est écrite en français par Kateb Yacine et je fais confiance à l’intelligence du public. Le public algérien est au moins bilingue. Il n’y a pas de traduction dans la décision de mettre en scène. Ils regardent bien Batman piraté et en français ! Pourquoi pas cette pièce ? Quant à la langue française en Algérie, la situation est désormais différente de celle qu’a connue Kateb Yacine. Il est allé à l’école française et il y en a peu qui ont pu alors. Aujourd’hui, malgré la politique d’arabisation qui a été faite en Algérie, la langue française est la première langue obligatoire enseignée dès l’âge de 8 ans, ne serait-ce que pour comprendre ceux de leur famille qui vivent en France. Personnellement, la langue française me permet de créer une distance, elle est devenue en Algérie une langue de contestation. Allez répéter ce qu’a pu écrire Kateb Yacine en français, que Dieu est mort par exemple… en français, cela choque moins. Le grand père de Kateb Yacine lui avait conseillé d’apprendre le français pour dire en français aux français qu’il n’était pas français. Quand moi, je parle français, c’est pour dire l’urgence. Je n’ai pas ce complexe du colonisé.
Voyez-vous le théâtre comme « un lieu d’éducation populaire » comme le voulait Kateb Yacine ?
Je vais vous dire et cela va vous choquer, le théâtre de Kateb Yacine ne me touche pas car c’est avant tout un théâtre d’information. A l’époque, il n’y avait pas de télé ou d’internet pour pouvoir s’informer comme aujourd’hui. Pour informer les gens de la guerre au Vietnam, Kateb Yacine a écrit une pièce. Son théâtre est très lié à cette époque là, aux moyens qui existaient alors.
Et surtout, le théâtre comme « lieu d’éducation populaire ». Qui suis-je pour éduquer ? Je ne fais pas un théâtre pour éduquer. Je fais un théâtre qui pose des questions. Je n’ai aucun mal à me séparer ici de mes pères spirituels dont Kateb Yacine fait partie. C’est parce qu’il parlait de théâtre comme « lieu d’éducation populaire » entre autres qu’on en a fait un Père de la Nation. Il faut déboulonner les statues.
Jouez-vous vos pièces dans d’autres pays d’Afrique ?
Une pièce comme celle-ci, je la vois très bien en Tunisie par exemple, ne serait-ce que parce qu’elle dit aussi qu’une « révolution n’atteint jamais qu’une partie de ces objectifs » et pour d’autres paroles encore fortes qui résonneront certainement chez les tunisiens. J’ai également un projet avec Massamba Guèye, professeur et conteur écrivain qui a créé à Dakar la Maison du Conte. D’ailleurs, les africains me reconnaissent très facilement comme africain et cela va contre cette image fausse qui fait plus des Algériens des arabes. J’ai joué en 2006/2007 « Les Justes » de Camus au Festival des Réalités à Bamako. Mais il est vrai que c’est très difficile de tourner en Afrique. Il y a beaucoup d’aides pour traverser la Méditerranée et on regarde tous vers l’Europe, mais tourner en Afrique, aller dans les pays voisins, c’est presque impossible ; c’est un vrai problème africain. D’ailleurs, la plupart, pour ne pas dire tous les artistes africains ne se rencontrent qu’en Europe. Finalement ce sont les artistes qui sont curieux de la France et pas forcément la France qui est curieuse.
D’ailleurs, quelle est la réception de votre pièce en France ?
Il y a un public en France pour nos pièces. Mais la France « officielle » ne veut pas entendre l’Algérie d’aujourd’hui. Elle reste dans les clichés. Pour que cette France « officielle » nous entende, c’est à peine si je ne devrais pas faire un spectacle en proposant au public français de se fouetter lui-même pour éprouver sa culpabilité. Non. L’Algérie d’aujourd’hui, ce n’est pas cela qu’elle dit. Ni repentance, ni oubli. Cette pièce, si vous entendez bien, elle parle de l’Algérie d’aujourd’hui, une Algérie où la religion peut être critiquée, où il existe une pensée laïque. Encore faut-il l’entendre…
http://www.elajouad.com
entretien réalisé pour Terangaweb – l'Afrique des idées par Linda Zitouni
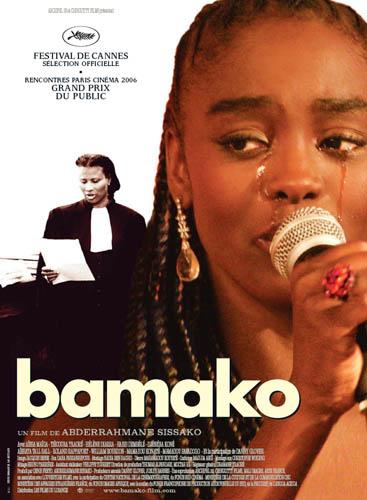 Le « Bamako » de Sissako, c’est l’histoire d’un procès, celui que mène la société civile contre les institutions financières qui écrasent le pays, FMI et Banque mondiale. C’est l’hypothèse de la quasi-impunité de ces institutions que le film conteste. Abderahmane Sissako installe la cour de justice dans la cour de maisons que se partagent des familles. Cette superbe trouvaille donne à ce film des résonances toutes particulières.
Le « Bamako » de Sissako, c’est l’histoire d’un procès, celui que mène la société civile contre les institutions financières qui écrasent le pays, FMI et Banque mondiale. C’est l’hypothèse de la quasi-impunité de ces institutions que le film conteste. Abderahmane Sissako installe la cour de justice dans la cour de maisons que se partagent des familles. Cette superbe trouvaille donne à ce film des résonances toutes particulières.