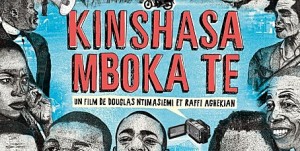 Kin’sasa Mboka te ! Cette phrase que tous les kinois ont fait leur, a été signée par le plus fin et le plus grand des sociologues que la ville ait porté, en la personne de Franco Lwambo Makiadi. Nul autre n’a su mieux que lui, traduire dans ses chansons l’ambiance cacophonique et tonitruante de Kin, la-belle. Dans Kinshasa Makambo, le Grand-Maître montrait déjà comment dans cette ville le faux était terriblement vrai ; l’éphémère avait ce caractère pérenne et persistant et devant lui, tout se faisait et se défaisait, porté par une inextinguible rumeur, qui monstrueusement, se nourrissait d’elle-même et vivait de sa mort.
Kin’sasa Mboka te ! Cette phrase que tous les kinois ont fait leur, a été signée par le plus fin et le plus grand des sociologues que la ville ait porté, en la personne de Franco Lwambo Makiadi. Nul autre n’a su mieux que lui, traduire dans ses chansons l’ambiance cacophonique et tonitruante de Kin, la-belle. Dans Kinshasa Makambo, le Grand-Maître montrait déjà comment dans cette ville le faux était terriblement vrai ; l’éphémère avait ce caractère pérenne et persistant et devant lui, tout se faisait et se défaisait, porté par une inextinguible rumeur, qui monstrueusement, se nourrissait d’elle-même et vivait de sa mort.
Dans la pure tradition du président de l’OK Jazz, l’orchestre Wenge BCBG, par l’entremise de J.B. Mpiana renoue avec la description urbaine. Sur l’album T.H., le morceau intitulé Kinshasa raconte la désillusion d’un villageois arrivé dans la Capitale, par défi, pour dit-il, « voir Kinshasa et puis mourir. » Mais sa déception n’a d’égal que ses espérances, rien ne correspond aux descriptions, rien ne vient flatter ses fantasmes. Il a pitié de lui-même car c’est un monde tout en contradiction qui s’ouvre à lui ; les évènements se chevauchent et se télescopent. Pendant que la police arrête des voleurs, d’autres larcins se commettent sur le même périmètre ; alors que les uns sont affligés par un deuil, les autres font entendre les fastes des réjouissances festives ; les marchés jouxtent les poubelles… Nous sommes bien dans la ville de tous les extrêmes qui ne peut mieux se désigner que la formule, « la ville qui n’en était pas une », une traduction approximative de Kinshasa Mboka te. Mais peut-être faut-il préférer cette autre traduction tout aussi hasardeuse, « Kinshasa est une fiction. » Le caractère à la fois réel et irréel de la fiction, cette sorte de présence absence se rapproche un peu plus de la phrase en lingala qui sert de titre au documentaire sorti en 2013 cosigné par Douglas Ntimasiemi et Raffi Aghekian.
Kinshasa Mboka te est une plongée profonde dans la ville. Le film, à l’instar du titre, ne nous épargne aucun paradoxe et semble même en faire une force. Mais lorsqu’on aborde cette cité monstrueuse, quelque soit le média, on se demande comment faire pour raconter une ville aussi multiple ; comment procéder pour faire tenir en 52 minutes, la métropole de plus de douze millions d’habitants. Douglas et Raffi choisissent avec une efficacité certaine, d’effectuer de multiples entrées. La première a lieu grâce à la chaine Molière TV, un média spécialisé dans l’information de proximité et qui traque, avec la complicité des kinois, les faits divers dans toutes les communes de la ville. Deuxièmement, les deux réalisateurs suivent le sculpteur Freddy Tsimba dans ses pérégrinations urbaines. L’artiste court de décharge en décharge à la recherche de « sa matière première » tout en discourant sur les opportunités et les potentialités insoupçonnées de la ville. Les paroles d’artistes traversent tout le film : celle du plasticien, certes, mais également celle du slameur, Fier-d’être, ou celle du dessinateur Mfum’Eto, adepte du mysticisme et se présentant, le plus béatement du monde, comme un intermédiaire entre le monde visible et le « monde parallèle. ». Il faut ajouter aussi des membres de la société civile, les travailleurs sociaux intervenant auprès des enfants en rupture familiale ; les autorités communales, les représentants de la police et quelques personnages atypiques comme le chef coutumier gardien du cimetière ou le prophète Atoli complètent le tableau. Ce dernier mène une croisade contre les enseignements des missionnaires blancs tout en se confectionnant un flamboyant pédigrée. Il se présente en effet comme successeur, voir descendant de Kimpa Vita et Simon Kimbangu. Ses fidèles chantent, dans une réelle ferveur, la délivrance et la révélation que leur apporte le prophète. Ce sont tous ces foyers à partir desquels on projette les lumières sur Kinshasa.
Le constat premier : nous sommes bien loin des impressions du jeune Victor Augagneur Houang. Kinshasa n’a plus rien de la ville fantôme que regardait, enfant, le personnage d’Henri Lopès. Dans Le lys et le flamboyant, le narrateur se souvient que :
« sur la rive d’en face, on discernait les grues et les hautes tours de Léopoldville. La capitale du Congo belge ressemblait à une cité déserte, un monde de béton sans âme qui vive, une vaste nécropole assoupie dans le silence et l’immobilité. » (p. 138).
Le désert imposé par l’administration coloniale a fait place une immense foule qui se rue dans les artères de Kin dès les premières lueurs du jour. Les kinois aiment s’amasser; ils s’agglutinent autour de la moindre curiosité, commentent avec assurance, contestent avec fracas, se laissent persuader, se remettent à douter, invoquent le ciel, crient à la magie, conspuent et admirent, le tout en même temps. Les images de la ville montrent toutes un grouillement permanent, un flux ininterrompu de kinois au corps à corps avec leur ville.
Mais peu à peu les protagonistes se rejoignent tous autour d’une préoccupation commune. Une menace insidieuse pèse sur la ville. Elle tourmente aussi bien l’artiste que l’enfant abandonné ; les autorités civiles et la police nationale en font leur priorité et toute la rédaction de Molière Tv se mobilise pour contrecarrer les activités des Kuluna. C’est ainsi que l’on appelle à Kinshasa les bandes de délinquants qui sévissent dans les quartiers populaires. Le témoignage d’un ancien chef de gang est particulièrement édifiant en ce sens qu’il donne à voir l’inquiétante évolution du phénomène. Ce qui n’était qu’une guéguerre de quartier dans laquelle les rivaux s’intimidaient plus que ne s’affrontaient véritablement, s’est transformé en réseau de criminalité. Les nouveaux Kuluna usent de leur machette pour causer des blessures susceptibles d’entrainer la mort. Mais, comme d’habitude, en pareilles circonstances, ceux qui paient le plus fort tribut dans cette banalisation de la violence sont les plus fragiles, les enfants des rues qui portent en eux le traumatisme d’un coup de machette. Selon les éducateurs du centre Lokombe, ces enfants ont tout perdu et il n’est pas difficile de s’en apercevoir lorsqu’on rencontre les figures de shégué qui ont même oublié leur propre nom. Parmi ceux qui fréquent l’ONG, le jeune homme baptisé chinois koko, base électrique : la première partie du nom se traduirait par « vieux chinois », ce qui, pour un gamin d’à peine une dizaine d’année est d’un pur cynisme. Lui comme les autres enfants tentent de résister à la délinquance en se débarrassant des images de violence. Il leur faut un nouvel imaginaire, une nouvelle façon d’appréhender ce réel oppressif. Et c’est à niveau que le travail de l’artiste intervient.
Par sa sculpture, Freddy Tsimba essaie de susciter des interrogations au sein de la population tout en détournant l’arme des kuluna de son image négative et menaçante. Déplaçant sont atelier dans la rue, travaillant de jour comme de nuit, sous le regard intrigué des habitants qui participent par leur présence, à l’élaboration de l’œuvre. Il se crée, dans la spontanéité et la familiarité kinoises, une dynamique de parole autour du geste artistique qui, se faisant, anéantit la violence des objets incriminés. Les machettes soudées se transforment en toiles, en nattes, en brique ; la froide agression se métamorphose en chaleur d’un foyer ; à l’insécurité d’avant succède le confort ; au trouble, l’apaisement. Le tour de force de l’artiste est d’instaurer une nouvelle négociation là où les mots d’un bourgmestre ne cherchaient qu’à s’attirer les faveurs de sa hiérarchie. Alors que les victimes parlent de téléphone volé, de petite délinquance, voilà que le zélé fonctionnaire fait état de grand complot contre le pouvoir et exhibe en trophées quelques adolescents sous l’emprise de la drogue et se félicite de les envoyer très vite en prison pendant que la justice populaire s’en remet aux vieilles recettes. Interrogée par les reporter de Molière, une jeune femme voit dans la prison un processus trop long et pas assez radical, elle demande donc l’émasculation pure et simple.
Mais pendant que Freddy soude dans la nuit, engageant une franche discussion avec les curieux, quelques notes au piano suivies de quelques accords de violon, transperçant les nuages, la voix d’une speakerine commente les images de la vingt cinquième commune de Kinshasa. Une maquette futuriste des plus kitchs lance la promesse d’un quartier haut de gamme sur une ile de la ville. Un premier pavillon à l’esthétique douteux sert de d’échantillon à l’ensemble à la grande satisfaction de l’ingénieur. Pendant que la première locataire s’échine sur son archet, on peut encore voir des pirogues taillées dans les troncs d’arbres glisser sur le fleuve. Et comme dans un rêve, on s’échappe par les nuages pour revenir dans les rues de Kinshasa, porté par la musique du Tout Puissant Ok Jazz. Par ce montage, plus que jamais la « cité du fleuve » apparaît comme une parenthèse, un intermède qui ne fera pratiquement jamais partie de Kinshasa, trop plate, trop molle, trop régulière, elle ne pourra qu’être ce que l’anthropologue Marc Augé appelle un « non-lieu », un espace sans identité. Kinshasa est faite d’anecdotes toujours à la limite du vraisemblable comme le poisson qui se transforme en femme au bout de l’hameçon d’un pêcheur, le faux magicien qui s’excuse auprès de l’État et qui reconnaît sa perdition mais aussi, la déconstruction de l’iconographique occidentale selon le Prophète Atoli. Son prêche s’appuie sur un « calendrier américain » racontant la victoire d’un christ blanc sur un diable noir dans une injustice totale : « les poings du premier pèsent deux mille kilos alors que ceux du second n’affichent sur la balance que deux maigres kilos. » Mais lui étant l’envoyé de Dieu, vient révéler toute la vérité sur les mensonges du christianisme.
Même sur le plan de la spiritualité Kinshasa reste en accord avec elle-même. Elle veut tout et son contraire. Mfum’Eto déclare vivre avec les esprits du monde parallèle et le chef coutumier, gardien du cimetière sait reconnaître le moment où les ancêtres sont en éveil. Mais c’est sans doute Freddy Tsimba qui résume le mieux, la dynamique contradictoire de Kinshasa : « si tu comprends trois pourcent de Kinshasa, ca te suffit pour vivre en paix. Ce n’est pas la peine d’essayer de le comprendre à cinquante pourcent car tu ne parviendras même pas aux cinq premiers. Même si tu te targues d’être kinois, le tout c’est de savoir à quelle échelle tu la maitrises. Seuls les trois pourcents te permettront de t’en sortir. Parce que Chaque jour, il y a une nouvelle ville qui nait. D’ici à demain, ce sera une nouvelle Kinshasa qu’il va falloir apprendre à connaître. »
Kinshasa Mboka té est incontestablement un des meilleurs films qui ait été fait sur l’esprit kinois.
Ramcy Kabuya
Kinshasa Mboka té
2013 – RD Congo – Belgique, Documentaire, 52 minutes
director: Douglas Ntimasiemi
scénario : Douglas Ntimasiemi – Raffi Aghekia
editing: Olivier Jourdain





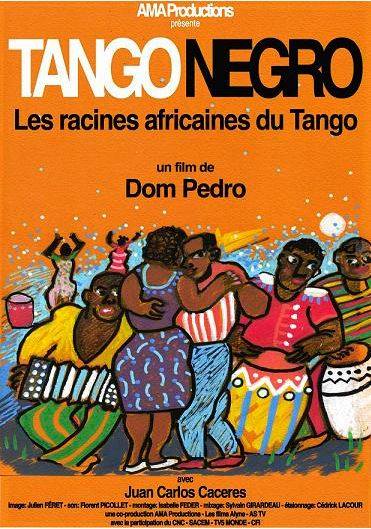
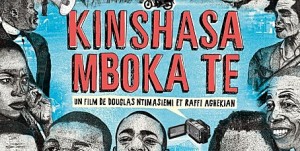 Kin’sasa Mboka te ! Cette phrase que tous les kinois ont fait leur, a été signée par le plus fin et le plus grand des sociologues que la ville ait porté, en la personne de Franco Lwambo Makiadi. Nul autre n’a su mieux que lui, traduire dans ses chansons l’ambiance cacophonique et tonitruante de Kin, la-belle. Dans Kinshasa Makambo, le Grand-Maître montrait déjà comment dans cette ville le faux était terriblement vrai ; l’éphémère avait ce caractère pérenne et persistant et devant lui, tout se faisait et se défaisait, porté par une inextinguible rumeur, qui monstrueusement, se nourrissait d’elle-même et vivait de sa mort.
Kin’sasa Mboka te ! Cette phrase que tous les kinois ont fait leur, a été signée par le plus fin et le plus grand des sociologues que la ville ait porté, en la personne de Franco Lwambo Makiadi. Nul autre n’a su mieux que lui, traduire dans ses chansons l’ambiance cacophonique et tonitruante de Kin, la-belle. Dans Kinshasa Makambo, le Grand-Maître montrait déjà comment dans cette ville le faux était terriblement vrai ; l’éphémère avait ce caractère pérenne et persistant et devant lui, tout se faisait et se défaisait, porté par une inextinguible rumeur, qui monstrueusement, se nourrissait d’elle-même et vivait de sa mort.