Le Festival International des Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) déballe ses valises dans les cinémas parisiens du 9 au 11 septembre, à l'occasion de la rentrée du cinéma. Nous vous invitons à l'édition 2016, qui, fidèle à la philosophie du festival, comprend cette année des perles de réalisation francophones et anglophones, où la profondeur et les relations humaines occupent le haut du pavé. Diarah Ndaw-Spech, organisatrice du festival, a bien voulu répondre à nos questions.
Selon vous, quel film nous transportera, cette année ?
Il y en aura plusieurs:
La première mondiale du documentaire de la réalisatrice Keria Maamei « Nos Plumes » qui explore le travail d’une "nouvelle vague" littéraire hétéroclite française issue des banlieues.
«Image» un thriller à propos des relations entre le monde des média et les quartiers populaires de Bruxelles. Le film a fait la une des salles en Belgique pendant plus de 10 semaines.
« Supremacy » un thriller avec Danny Glover basé sur une histoire vraie qui illustre vivement les tensions raciales constantes aux Etats Unis aujourd’hui.
« Héros Invisibles : Afro-Américains Dans La Guerre Civile Espagnole » une page de l’histoire de la solidarité entre les peuples devant un ennemi commun.
Pensez-vous que le cinéma est plus à même de faire passer certains messages mieux que d'autres médias comme le livre par exemple ?
Déjà, en 1960, celui qui est considéré par beaucoup comme le père de Cinéma Africain, Ousmane Sembène, a choisi de passer de l’écriture au cinéma pour mieux faire passer ses messages. Il avait compris, déjà à son époque, la force de l’image pour communiquer plus facilement et à plus large échelle. L’impact de l’image est plus important que jamais aujourd’hui. Pas juste en Afrique, dans le monde entier ! C’est pour ça que le cinéma a un grand potentiel pour aider à faire évoluer les idées et les sociétés.
Quels sont les grands thèmes abordés cette année ?
La grande turbulence dans nos sociétés contemporaines. Les tensions montent, l’intolérance s’installe, l’abus de pouvoir et la corruption abondent, et les gens se révoltent contre les injustices. Ces thèmes sont présents dans Image, Supremacy, Insoumise, Hogtown et Dzaomalaza Et Les Mille Soucis.
Les questions identitaires d’appartenance et d’acceptation sont abordées dans Nos Plumes, Ben & Ara, et la Belle Vie.
Diriez-vous que nous allons vers un cinéma plus international, plus porté vers l'innovation ?
Avec la globalisation, l’information circule plus que jamais. Cela peut avoir un effet de standardisation à travers les cultures. Beaucoup de jeunes réalisateurs partout dans le monde prennent comme modèle le cinéma fait à Hollywood. Cela peut limiter les initiatives novatrices. D’un autre côté, la technologie a démocratisé cette forme d’art. Cela permet à de nouvelles voix de s’exprimer sans dépendre d’un système qui a le pouvoir de la censure et de l'argent. Des films indépendants comme Nos Plumes, Hogtown ou Ben & Ara sont des films d’auteurs où sont abordés des thèmes qui les concernent les créateurs. Ces films n’auraient probablement pas pu exister sans les nouvelles technologies. Un cinéma plus international ? Certainement. Plus porté vers l’innovation ? C’est encore à débattre.
Rendez-vous aux Cinémas La Clef (Paris 5ème, 34 rue Daubenton, métro Censier-Daubenton), et Etoile Lilas (Paris 20ème, Place du Maquis du Vercors, métro Porte des Lilas).
Pour aller plus loin : Rendez-vous sur le site du FIFDA (www.fifda.org).

 Dans un article du Nouvel Obs, Souleymane Bachir Diagne s’imaginait expliquant à son enfant les fondements du soufisme. Tantôt définie comme la branche mystique de l’Islam, tantôt vue comme une démarche purement spirituel et indépendante du dogme, le soufisme est aujourd’hui plus que jamais d’actualité : Eric Geoffroy en parlant de la spiritualité musulmane, la désignait comme la seule solution pour la pérennité de l'Islam.
Dans un article du Nouvel Obs, Souleymane Bachir Diagne s’imaginait expliquant à son enfant les fondements du soufisme. Tantôt définie comme la branche mystique de l’Islam, tantôt vue comme une démarche purement spirituel et indépendante du dogme, le soufisme est aujourd’hui plus que jamais d’actualité : Eric Geoffroy en parlant de la spiritualité musulmane, la désignait comme la seule solution pour la pérennité de l'Islam.

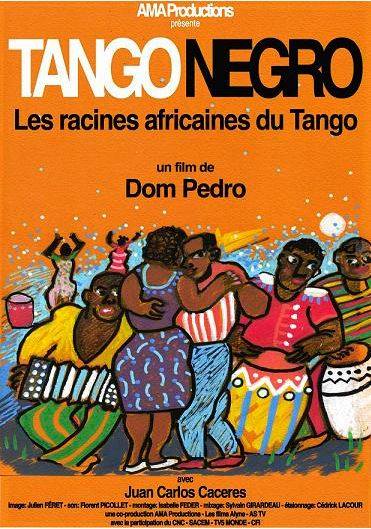
 Lorsqu’on parle du Green Business en Afrique, la première idée qui émerge est celle de l’énergie solaire pour pallier l’accès difficile à l’électricité. A eux seuls, l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne comptent 80% des 1,5 milliard d’habitants lésés par une alimentation électrique défaillante, faute de moyens techniques et financiers.
Lorsqu’on parle du Green Business en Afrique, la première idée qui émerge est celle de l’énergie solaire pour pallier l’accès difficile à l’électricité. A eux seuls, l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne comptent 80% des 1,5 milliard d’habitants lésés par une alimentation électrique défaillante, faute de moyens techniques et financiers.