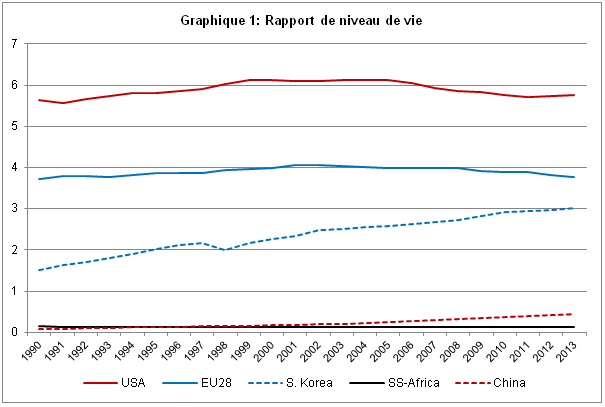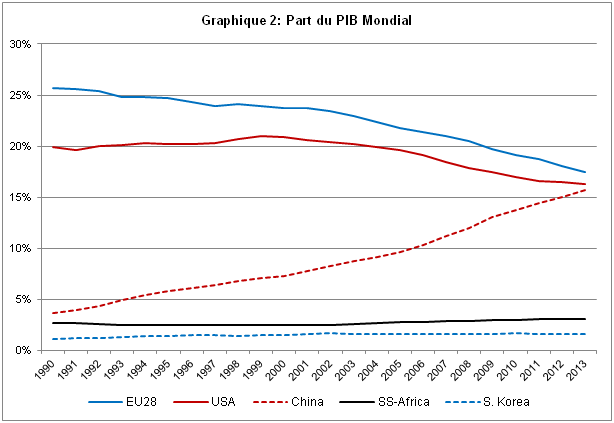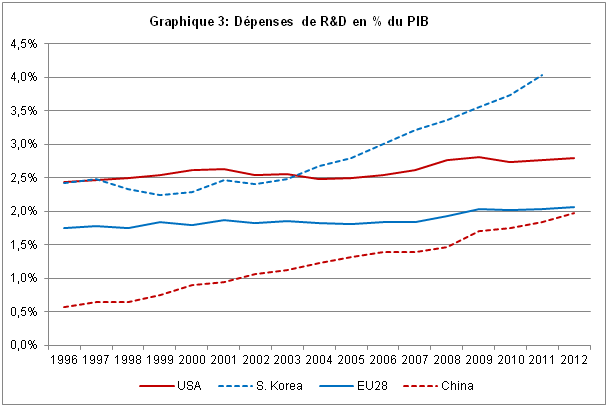La plasticienne Kara Walker est une artiste afro-américaine qui, depuis les années 90 s’est faite une réputation dans le monde des arts Etats-Uniens et même mondiaux. Sa position est pour le moins complexe, car étant noire, elle ferait plutôt partie des artistes de la marge, mais il faut cependant avouer qu’elle n’est pas à proprement parler une artiste de la périphérie. Elle a dans le champ artistique contemporain une place disons le ambiguë. Ses œuvres sont plus plébiscitées par un public blanc et décriées par ses pairs noirs, ou afro-américains. Cet entre-deux(1) ou ce jeu d’équilibre en fait une artiste particulièrement intéressante qui nous fait nous questionner sur les raisons d’un tel positionnement. Face aux critiques l’artiste n’en démord pas et paraît même se plaire dans cet espace jumelé. Bien que critiquée par certains noirs américains, Kara Walker n’en est pas moins reconnue comme une artiste à part entière. L’équilibre apparaît nettement dans le fait que de Noire, elle produit un art qui s’appuie sur une réappropriation blanche. L’artiste réutilise, réadapte. Rien n’est inventé par Kara Walker, mais la subversion qu’elle emploie la singularise quelque peu.
La plasticienne Kara Walker est une artiste afro-américaine qui, depuis les années 90 s’est faite une réputation dans le monde des arts Etats-Uniens et même mondiaux. Sa position est pour le moins complexe, car étant noire, elle ferait plutôt partie des artistes de la marge, mais il faut cependant avouer qu’elle n’est pas à proprement parler une artiste de la périphérie. Elle a dans le champ artistique contemporain une place disons le ambiguë. Ses œuvres sont plus plébiscitées par un public blanc et décriées par ses pairs noirs, ou afro-américains. Cet entre-deux(1) ou ce jeu d’équilibre en fait une artiste particulièrement intéressante qui nous fait nous questionner sur les raisons d’un tel positionnement. Face aux critiques l’artiste n’en démord pas et paraît même se plaire dans cet espace jumelé. Bien que critiquée par certains noirs américains, Kara Walker n’en est pas moins reconnue comme une artiste à part entière. L’équilibre apparaît nettement dans le fait que de Noire, elle produit un art qui s’appuie sur une réappropriation blanche. L’artiste réutilise, réadapte. Rien n’est inventé par Kara Walker, mais la subversion qu’elle emploie la singularise quelque peu.
Kara Walker est diplômée de l'Université d'art d'Atlanta (BFA, 1991) et de l’École de design de Rhode Island (MFA, 1994). C’est très jeune qu’elle a connu le succès, avec sa première fresque ‘Gone : An Historical Romance of Civil War As It Occured between the Dusky Thighs of One Young Negress and Her Heart (1994)/ ' Gone: Une Romance Historique de la Guerre Civile Comme elle a eu lieu entre les Sombres Cuisses d'une Jeune Négresse et Son Cœur.
Sur fond de provocation, Kara Walker réécrit une histoire sur l’esclavage à sa façon. Elle est réputée pour pratiquer le découpage de silhouettes noires sur mur blanc. Elle pratique aussi le découpage d’images d’imprimerie, (comme du scrapbooking). Elle s’inspire, dans le cas des silhouettes, d’une pratique très pratiquée aux XVIIIè siècle et au XIX è siècle, dans les salons, pour faire des portraits. La silhouette était faite en jouant de la lumière portée sur un personnage, auquel on ne gardait que l’ombre portée. Cette manière de faire est également connue pour avoir été celle d’un Matisse. Cette réadaptation d’un art occidental par une noire, invite à se questionner sur les phénomènes raciaux. Le blanc dominant de ses toiles, et le noir représentant les silhouettes reflètent les métaphores obsédantes de l’artiste : dire un esclavage par les blancs, dont les noirs ont été les victimes ( ?).
Son travail a été exposé au SFMoMA de San Francisco, au Guggenheim, au musée Whitney d’art Américain ainsi qu’au MoMA de New York. En 1998, Kara Walker est lauréate du prix de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur. En 2002, elle représente les États-Unis à la Biennale de São Paulo. Le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris lui consacre en 2007 une grande exposition personnelle. (2)
Autant dire que la renommée de la jeune femme n’est plus à faire.
Au-delà de ces questions raciales, ce qui intéresse chez Kara Walker c’est la présence d’une esthétique noire. L’art de Kara Walker est un art que l’on peut considérer comme étant un ‘art noir’. Cet art intègre un univers qui se rapporte à des sentiments, des réactions ‘noires’. Que l’on évoque l’humour chez l’artiste, qui use de mini discours en guise de titres (longilignes) de ses fresques. L’artiste interpelle, joue avec l’imagination des visiteurs afin de détendre l’atmosphère, de simplifier par le discours écrit, celui pictural qui est plus lourd. Simplification ou vulgarisation, c’est à chacun de choisir. Car les mini discours de l’artiste (que l’on se réfère à celui de ‘Gone’) sont provocants. La notion de réhabilitation historique aussi, ou de détournement interpelle. L’artiste aime à être une sorte de griot du pinceau, qui donne sa version des faits historiques, tout de même.
L’art noir est visible par cette jonction des objets et des formes (patchwork), par cette multiplicité des personnages négroïdes, par les clairs de lunes, comme invoquant le lieu initiatique, par les longues séries de violences, des répétitions de vies, des contes de fantômes ou de damnés. Il ne s’agit pas de citer une esthétique scientifique d’un art noir, se rapportant à une école, tant que d’évoquer ici une ‘âme noire’ dans la manière de montrer. L’art noir est visible par la forme de franchise dans le ‘montrer’. Chez Kara Walker, comme chez certains clips de rap afro-américains, on est face à des images indicibles quasi inmontrables ou choquantes, qu’il nous faut cependant regarder, voir. Rien n’est tabou. Ce sont des scènes de viols, des défécations, etc., autant de scènes de vie interraciales qui finalement n’informent pas mais montrent, ordonnent. C’est une sorte de sauvagerie longtemps affiliée justement aux noirs. Kara Walker semble réutilisée ici le mythe du Noir sans limite (aux mœurs débridées). Comme une forme de réadaptation de thèses aujourd’hui considérées comme dépassées. Cet art noir donc chez l’artiste est plutôt, disons le franchement un art noir décidé comme tel, du point de vue du blanc. Cet art de Kara Walker qui connait un franc succès connait aussi des critiques.
Elle a eu à essuyer de virulentes critiques d’afro-américains qui trouvaient que son œuvre jouait de stéréotypes. La plus connue de ces anti-Walker est Bety Saar, une artiste afro-américaine, qui écrivit dans PBS series:
I’ll Make Me a World, en 1999 : « I think the work of Kara Walker was sort of revolting and negative and a form of betrayal to the slaves, particularly women and children; that it was basically for the amusement and the investment of the white art establishment.”/Je pense que le travail de Kara Walker [est] révoltant et négatif et une trahison envers les esclaves, et particulièrement vis-à-vis des femmes et des enfants ; ceci est en fait pour l’amusement et la satisfaction de l’establishment blanc.
D’autres critiques lui ont rendu la pareille, comme Howardena Pindell, et Jerry Saltz. (3)
Howardena Pindell a fait la critique suivante :
“What is troubling and complicates the matter is that Walker’s words in published interviews mock African-Africans and Africans…She has said things such as ‘All Black people in America want to be slave a little bit’…Walker consciously or unconsciously seems to be catering in the bestial fantasies about blacks created by white supremacy and racism.”/ (4)
Ce qui est troublant et compliqué dans l’affaire c’est que les mots émis par Kara Walker dans les journaux se moquent des Afro-américains… Elle a dit des choses comme “Tous les Noirs en Amérique veulent être un peu esclaves par moment…” Walker consciemment ou non semblent être prises dans les fantaisies bestiales sur les noirs, créées par la suprématie (mentalité) et le racisme blancs.
Ici, on voit la critique souvent faite par des artistes afro-américains à Kara Walker. On lui reproche très souvent de se soumettre à l’idéologie occidentale, de se réapproprier les images véhiculées trop longtemps sur les Noirs, comme l’hypersexualité, le corps-objet, la violence, etc.
Cette critique a été réitérée alors qu’elle a réalisé la femme-sphinx (5), intitulée ‘Kara Walker : A Subtlety or the Marvelous Sugar Baby, an Homage to the unpaid an overworked Artisans who have refined our Sweet Tastes from the cane fields to the Kitchens of New World on the Occasion of the demolition of the Domino Sugar Refining Plant’./Kara Walker: Une Subtilité ou la Merveilleuse Femme Sucre (familier), un Hommage aux artisans/travailleurs surmenés qui ont raffiné notre Goût des plantations de canne à sucre aux cuisines du Nouveau Monde à l’Occasion de la démolition de la Raffinerie de Sucre, Domino.
On remarque encore ici le mini discours qui accompagne la fresque. On peut y lire l’aphorisme. Tout détermine le but, mais aussi la familiarité discursive Sugar Baby dans cet art pur. La femme-Sphinx est une femme posée comme un sphinx, faisant 20 mètres de long et 10 mètres de haut, enduite de sucre, près de quarante tonnes de sucre utilisée pour la femme-Sphinx (la Domino Factory avait mis à la disposition de Kara Walker 80 tonnes de sucre), et le reste utilisée pour les petits hommes grandeur nature disposées autour de la statue immense. La sculpture fait partie de la tradition de l’« ephemeral art », ces œuvres « éphémères » appelées à être démolies, qui englobent les subtilités (pâtisserie), les œuvres comme l’Urinoir de Duchamp, ou certains plateaux de réalisation… (6)
La Domino Sugar Factory a été fondée en 1856 par la famille Havemeyer et est devenue à la fin de la guerre de Sécession la plus grosse usine de raffinement au monde. (7)
Le sphinx est un autoportrait de l’artiste, et cette dernière l’a représentée avec des traits négroïdes exacerbées, avec un fichu sur la tête, comme les mamas afro-américaines. La femme-Sphinx offre tous les attributs de la sexualité et de la fécondité : seins et fesses énormes, vulve apparente. Kara Walker n’a pas échappé à la critique de certaines personnes qui se sont demandées A qui plairait le plus cette œuvre ?
On perçoit ici la récurrente critique que Kara Walker serait instrumentalisée, elle offrirait un art pro-blancs. Certains visiteurs du Domino n’ont pas hésité à réagir vivement via les réseaux sociaux et les blogs (8). Mais avec cette œuvre, elle produit certes sa première sculpture, mais réalise aussi un tour de force, en créant un véritable intérêt. Ce sont des blogs et des blogs qui font circuler les images de la femme-Sphinx. Les réactions encensent l’artiste, et reconnaissent un travail abouti. On reconnaît que l’usage du sucre comme matière pour sculpter est ingénieuse. Elle n’est d’ailleurs pas la première à en avoir l’idée, le Sutlety Art se pratiquant au XVIè siècle, notamment en Italie (dont les plus grands confiseurs sont à Venise) (9). Il s’agit là encore d’une ré-interprétation ou réadaptation d’un art occidental ancien. On admire l’artiste qui utilise un art afin de dénoncer. La femme-Sphinx dénonce apparemment (mais le fait-elle vraiment ?).
La sculpture est imposante et nous regarde. Elle montre des formes à la Vénus Hottentote, et au lieu de répondre à toute question sur la fermeture ou non de l’usine (10), elle semble plutôt réagir à d’autres questions. Kara Walker ne semble jamais prendre parti dans le débat de manière consciente. Ses œuvres sont rebelles tout comme elle. Elles nous subjuguent mais ne nous répondent pas. A la question de savoir ce qui nous plaît dans les œuvres de Kara Walker, nous craignons de dire : nos propres vices, et fantasmes.
Car son art est violent, sexuel, et exècre l’interdit. Kara Walker revendique par son art un droit au blasphème, à tout ce que la société juge interdit. C’est sans doute cette liberté qui fait qu’elle est tant appréciée par l’establishment.
On ne peut pas dire que l’œuvre de Kara Walker est née ex nihilo. Elle fait suite à une réaction certes artistique, et esthétique, mais aussi à un trauma qui dénote semble-t-il des questionnements des Noirs en général. Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs, avait été le premier clinicien noir à jeter le pavé dans la marre en disant que le Noir est malade. Malade d’un discours qui lui est imposé par le Blanc, et qu’il ne peut lui-même rejeter. Nous parlons ici en termes de Blanc et de Noir de manière descriptive et non dans le but de juger, d’inférioriser.
Le Noir qui est en Afrique ou ayant été déporté semble avoir gardé des stéréotypes enfouis parfois même inconsciemment. L’art de Kara Walker questionne la dualité d’un être binaire. Le Noir est ce qu’il est mais il est aussi face au blanc, ce que ce dernier dit qu’il est (Marcus Garvey parle d’une expérience similaire dans Les Ames du peuple noir). Alors que certains accèdent à cette indépendance identitaire, d’autres encore y succombent. L’art de Kara Walker est soit un jeu de l’artiste avec le public, soit un réel questionnement des conséquences de la blessure de l’esclavage et même coloniale. Il dénote des affres de l’aliénation identitaire.
Pénélope Zang Mba
Notes
1 Etant noire, elle intéresse particulièrement les spectateurs et les collectionneurs blancs.
2 Tiré de Printemps de septembre
Kara Walker was born in Stockton, California. She received an MFA from the Rhode Island School of Design in 1994. In 1997, she received the MacArthur Foundation Achievement Award. Her work has been exhibited at the Museum of Modern Art, the San Francisco Museum of Modern Art, the Solomon Guggenheim Museum, and the Whitney. She is currently on the faculty of the MFA program at Columbia University.
3 http://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/provocations/kara/2.html
4 A l’occasion de la Biennale de Johannesburg, en Octobre 2007.
5 Ce n’est pas à proprement le nom désigné, mais l’allusion faite, au vue de la position de la statue. On peut également percevoir la pratique de réappropriation du fait ancien occidental et blanc, qui est pour ainsi dire détourné. Le Sphinx de Gizeh est ici le la Femme-Sphinx, à la manière d’une entité féminine noire, immense, sexuée et presque vulgaire ; mais impressionnante.
7 Voir sur le site www.Artistikrezo.com.
8 http://rhrealitycheck.org/article/2014/07/21/kara-walkers-sugar-baby-showed-us/ Some spectators of the installation have been criticized for taking sexually suggestive photos with the body parts of the exposed sugar sphinx. The backlash from people who felt these photos were insensitive was swift and prompted questions about the ways in which Black art is valued, and howpublic displays of resistance can help improve how Black art is treated and viewed by spectators.
9 http://ericbirlouez.fr/conferences_a1.html