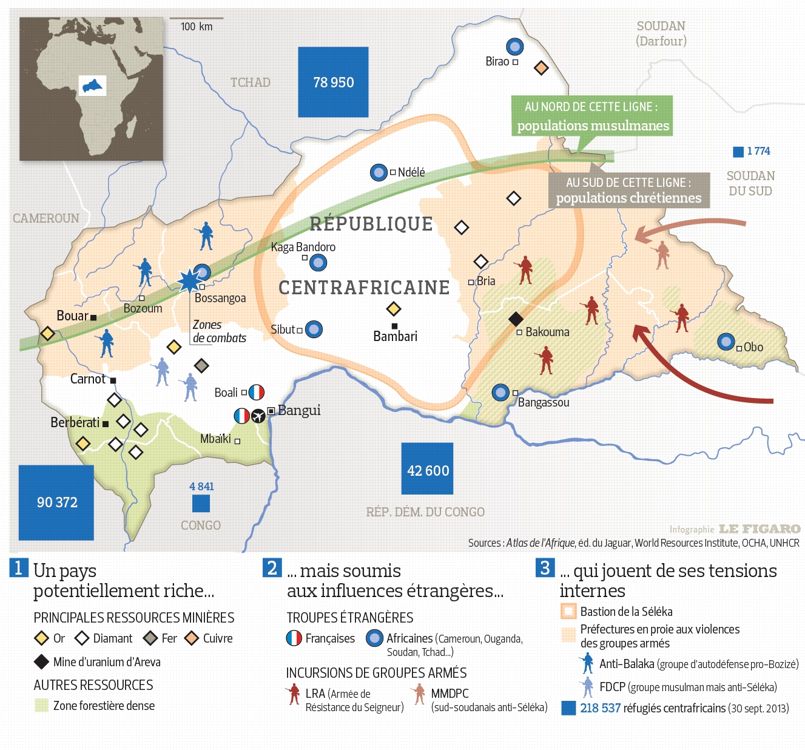Cette « cour pénale africaine », qui est voulue comme une réponse au biais de la CPI en Afrique, souffre des mêmes manquements et restera comme celle-ci sous l’influence des intérêts politiques des États. Le Sommet de l’Union africaine à Malabo (juillet 2014) a entériné la mise en place d’une Cour africaine de justice et des droits de l’homme. La création de cette Cour termine un processus enclenché par le Protocole sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté en juin 1998 à Ouagadougou et entré en vigueur en 2004. Mais elle intervient dans le cadre d’une opposition de plus en plus vive entre certains dirigeants politiques africains, l’UA et la Cour pénale internationale (CPI).
L’idée que la CPI ne s’intéresse qu’aux Africains se retrouve dans plusieurs discours. Depuis sa mise en œuvre en 2002, la CPI a inculpé une trentaine de personnes, toutes africaines. A cet égard, elle est régulièrement accusée d’être un instrument néocolonial, ayant un biais envers l’Afrique et les leaders politiques africains. Ce sentiment aurait pu être considéré comme marginal et relevant de la partisannerie politique si l’UA et nombre de leaders politiques n’avaient tenu des propos illustrant cette perspective. En 2013,l’inculpation du président kenyan Uhuru Kenyatta et de son vice-président William Ruto pour crimes contre l’humanité à cause de leur appui financier aux violences postélectorales de 2007-2008 semble avoir ravivé les tensions latentes entre l’UA et la CPI. En effet, l’organisation panafricaine avait déjà déclaré qu’elle ne collaborerait pas avec la CPI suite à l’inculpation du président soudanais, Omar el-Bechir en 2009. Le sommet d’Addis-Abeba d’octobre 2013 a constitué un épisode de plus dans le divorce entre les deux institutions puisque l’ordre du jour était marqué par un éventuel retrait collectif des États africains de la CPI. Même si un retrait massif n’a finalement pas eu lieu, la mise en œuvre de la nouvelle Cour de justice, qui sera compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression, vient couper l’herbe sous le pied de la CPI.
Il est vrai que le poids des pays occidentaux sur le financement de l’organisation (60% du budget provient de l’Union européenne) et sur la nomination des juges peut leur donner une influence plus que raisonnable sur ses activités. C’est l’opinion du professeur ougandais Mahmood Mamdani qui considère que la CPI est trop sous influence de l’Occident et qu’on assiste à du « déjà-vu » avec la place qu’occupe le continent noir dans les travaux de ladite cour, au vu des relations historiques entre l’Europe et l’Afrique. Toutefois, cette vision négative ne résiste pas à une analyse plus poussée. Il est vrai que la CPI est défaillante sur plusieurs points. Le Conseil de sécurité de l’ONU peut lui demander de se pencher sur les activités qui peuvent être qualifiées de « crimes de guerre, contre l’humanité et d’agression » alors que trois de ses cinq membres permanents n’ont pas signé ou ratifié son traité fondateur, le Statut de Rome. Ainsi, les États-Unis, la Chine et la Russie influencent ou entravent, selon leurs intérêts politiques, l’activité de la CPI, sans pour autant la reconnaître légalement. Les récentes joutes au sein de ce Conseil a propos de l’implication de la CPI dans le conflit syrien montrent assez bien la dimension politique que l’institution a acquise en étant un instrument passif de ces États.
Mais dans le contexte africain, les critiques oublient souvent que la CPI ne s’est autosaisie que dans le cas du Kenya. L’ancien procureur, Luis Moreno Ocampo, avait décidé d’enquêter sur l’implication d’Uhuru Kenyatta et de William Ruto dans les violences postélectorales de son propre chef. Il est vrai que Kenyatta et Ruto ne sont pas les seuls hommes politiques au monde sur qui pèsent des soupçons d’incitations à des violences de masse. Dans la grande majorité des autres procès contre des citoyens africains, ce sont les États du continent qui ont eux-mêmes référé ces individus au tribunal de la Haye parce que leurs juridictions nationales sont incompétentes pour juger les crimes en question. Laurent Gbagbo a été inculpé par la CPI parce que le gouvernement ivoirien a transmis son dossier d’accusation à cette cour. Il en est de même pour la multitude de chefs rebelles congolais traduits dans cette instance. Sans une collaboration des États africains et de ces mêmes leaders qui vilipendent la CPI, cela n’aurait pas été possible.
Le maintien des charges contre Kenyatta et Ruto est problématique étant donné qu’ils constituent les deux plus hautes autorités étatiques du Kenya. Où s’arrête la souveraineté nationale et où commence le droit à la justice ? Comme dans le cas de Laurent Gbagbo, les procès de ces deux hommes d’État sont fortement politisés et divisent bien souvent les citoyens de leurs pays respectifs. Ces trois personnalités sont ainsi bien différentes de celles dont la CPI avait jusqu’ici l’habitude : les premières personnes inculpées avaient rarement le même capital politique pour combattre une instance de justice internationale, plus axée sur les principes que sur le monopole de la violence, trop dépendante de la volonté des États et de leurs intérêts stratégiques pour rendre une justice véritablement impartiale.
La Cour africaine pour la justice et les droits de l’homme nouvellement créée semble répondre à ce contexte de tensions entre les chefs d’État africains et la CPI. Cette cour pénale ne devrait être opérationnelle que dans quelques années, mais le fait qu’elle ait été votée presque à l’unanimité (seul le Botswana a voté contre) est un signal assez fort envers la CPI. Le principe de subsidiarité fait de la CPI une cour de dernière instance qui ne s’occupe que des crimes pour lesquelles les justices nationales sont incompétentes. L’UA coupe ainsi l’herbe sous le pied de la CPI ; mais d’ores et déjà, on peut douter de l’engagement des États d’Afrique envers une justice continentale transparente et vraiment juste. Une clause de ce nouveau Protocole accorde l’immunité aux chefs d’État durant leur mandat et aux « hauts fonctionnaires » en exercice. Uhuru Kenyatta, William Ruto et Omar el-Bechir ne seraient pas poursuivis par cette Cour, en dépit des sérieuses accusations de crimes contre l’humanité qui pèsent sur leurs têtes.
De plus, vu la propension des chefs d’État du continent à ne céder le pouvoir que lorsqu’on leur force la main, il est à craindre que cette clause ne soit une incitation à s’accrocher encore plus au pouvoir. Cette clause et cette cour constitueraient ainsi des obstacles à la consolidation démocratique que l’Afrique connaît depuis le début des années 1990. De plus, les États africains ne se sont pas distingués par leur engouement pour une justice africaine internationale. Le Protocole sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a été signé en 1998, mais n’a été ratifié que par 15 pays sur les 53 membres de l’UA.
Toute cette controverse nous renvoie au débat sur la possibilité d’une vraie justice internationale. Tiraillée entre les considérations juridiques et la morale, elle dépend au final de la bonne volonté politique des États et de leur puissance pour sa mise en œuvre. La Cour africaine de justice et des droits de l’homme sera confrontée aux mêmes problèmes et aux mêmes critiques que la CPI, à laquelle elle semble se substituer en ce qui concerne l’Afrique. Le poids politique des États et des leaders déterminera toujours leur position face à cette cour. Au final, les États africains vont reproduire les mêmes attitudes que celles qu’ils reprochaient à la CPI. Apres tout, la partialité est inhérente à tout mécanisme qui se base sur des considérations politiques et sur des intérêts nationaux.
Ousmane Aly Diallo



 « Je n'ose imaginer ce que le monde aurait dit de lui si ce héros avait été blanc », Mark Doyle, journaliste de la BBC à propos de Mbaye D
« Je n'ose imaginer ce que le monde aurait dit de lui si ce héros avait été blanc », Mark Doyle, journaliste de la BBC à propos de Mbaye D