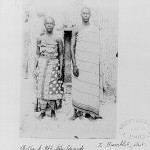Moufida est là co-fondatrice de CocoMoon Beauty, première marque bio-cosmétique aux Comores à valoriser le Coco dans une gamme de soin 100% naturelle inspirée des secrets de beautés traditionnelles. Entre tradition et modernité, cette marque a su redonnée toutes ces lettres de noblesse à ce produit emblématique dans un packaging frais et authentique. Celle-ci fait non seulement le bonheur des Nappies mais également des touristes en quête de produits représentatifs du pays, CocoMoon Beauty a su s’imposée dans le marché local et la région grâce à un concept simple, innovant et durable tout en valorisant la beauté noire au naturel.
Moufida est là co-fondatrice de CocoMoon Beauty, première marque bio-cosmétique aux Comores à valoriser le Coco dans une gamme de soin 100% naturelle inspirée des secrets de beautés traditionnelles. Entre tradition et modernité, cette marque a su redonnée toutes ces lettres de noblesse à ce produit emblématique dans un packaging frais et authentique. Celle-ci fait non seulement le bonheur des Nappies mais également des touristes en quête de produits représentatifs du pays, CocoMoon Beauty a su s’imposée dans le marché local et la région grâce à un concept simple, innovant et durable tout en valorisant la beauté noire au naturel.
Sélectionnée par la prestigieuse fondation africaine Tony ELUMELU en 2017, elle s’est par la suite imposée à La Réunion en raflant 2 prix lors de la rencontre internationale du développement durable organisée par le Club Export : celui du meilleur porteur de projet au concours ambition jeune Océan indien et celui du meilleur pitch élévator décerner par le public.
Son engagement pour la promotion et la valorisation des Comores lui a valu d’être parmi les 10 personnalités de l’année 2018 qui ont marqué le paysage comorien. Autant de distinctions qui prédisent un avenir florissant pour cette jeune femme dynamique et passionnée originaire des « Iles de la Lune » qui a tenté l’aventure de l’entrepreneuriat il y a 2 ans.
ADI : Est-ce que vous pouvez nous dire qui est donc Moufida Mohamed?
Je m’appelle Moufida. J’ai 35 ans. Je suis mariée et maman de 3 garçons. J’ai vécu une grande partie de ma jeunesse en France où j’ai passé un diplôme d’Etat en soins infirmiers orienté en santé mentale. Je me suis installée aux Comores, il y a bientôt 10 ans lorsque j’ai rencontré mon mari qui est chef d’entreprise d’une agence de communication. Arrivée là-bas après une période d’inactivité, j’ai intégré une des entreprises familiales où j’ai pu développer des compétences en gestion d’entreprise et management. Hyper active de nature, je me suis immédiatement investi dans des associations et institutions œuvrant pour développement socio-économique du pays tel qu’EFOICOM ou la Synergie Jeunes. J’ai participé avec des jeunes et des femmes à la création d’activités génératrices de revenu, dans la formation professionnelle et le leadership. Bien que j’ai moins de temps aujourd’hui je continue à le faire notamment à travers des initiatives telles que la 1re Édition de « 24 H pour entreprendre Comores » organisé par OIA group dans lequel j’ai participé en tant que coach. Je suis quelqu’un qui aime les rencontres enrichissantes et voir autant de jeune avec un si grand potentiel m’a réconforté. Je réalise que les Comores aussi se réveille et se révèle à l’image du continent africain.
ADI : Pouvez-vous nous parler de votre concept et comment est née votre entreprise ?
Je voulais avant tout créer un projet qui me ressemble, ou je pouvais allier ma passion et ma créativité dans quelque chose qui aurait du sens.
Avec CocoMoon nous proposons des soins de beautés naturelles pour les femmes noires et Afro, à la fois respectueux du corps, car nos produits sont sans agents chimiques ni parfum de synthèse et qui préserve l’environnement, car nous valorisons également les déchets issus de la production en faisant du combustible pour la coque ou même de la provende avec le tourteau, nous sensibilisons également sur la nécessité de s’assumer tel que nous sommes et ne pas se laisser enfermer dans des codes imposés poussant certaines à se mettre en danger en se dépigmentant ou en faisant l’usage excessif de produits nocif tel que le défrisage. Notre slogan est « Osez le Nature » et « Révélez votre Beauté ».
Dans la diversité que propose le terroir comorien, j’ai été particulièrement inspirée par le coco, arbre de vie par excellence, du fait de sa multiple opportunité de création et d’innovation qu’il offre pour répondre de façon durable au défi d’aujourd’hui et de demain. En cosmétique, c’est un produit exceptionnel car peut être décliner en gammes de soins capillaires et corporels selon les inspirations de chacun.
J’étais aussi cet enthousiasme par le potentiel évolutif et durable du projet car il faut savoir que tout s’utilise dans le coco du déchet a la coque, des feuilles au tronc etc. Et cela cadre bien avec mon mode fonctionnement actuel, car j’ai eu une réelle prise de conscience sur le mode de consommation que nous avions. Je suis très attentive aux produits que je consomme qui sont le plus possible locaux et bio que ce soit pour l’alimentation ou les soins de beauté en tant que grande adepte de la cosméfood et de low-cosmetique.
Le choix a été également motive bien sûr pour sa valeur culturelle car l’huile de coco fait partie des secrets de beauté ancestrale de la femme comorienne qui malheureusement été délaissé au profit de produits beaucoup plus nocifs mais qui jouissent de la réputation du « Made in Ailleurs ».
Je voulais montrer au Comorien qu’on pouvait utiliser des produits fabriqués au Comores dans des standards de qualités égaux aux produits exportés tout en participant à l’économie du pays.
Aujourd’hui, je suis vraiment heureuse de voir qu’il y a une prise de conscience et une participation active dans ce sens en termes de consommation locale.
ADI: comment un projet aussi innovant qu’ambitieux a-t-il été accueilli par la communauté comorienne ?
Je pense clairement qu’il y a un avant et après CocoMoon, car nous avons su redonner toute sa valeur à ce produit simple et multi-fonctionnel qui jusqu’ici était associe aux personnes démodées, âgées.
Personnellement, j’ai réalisé son efficacité grâce à internet quand j’ai arrêté le defrisage. Je chercherai le moyen de « dompter » ma crinière et j’ai vu à travers le mouvement Naturalista que l’huile de coco avait beaucoup de succès, car très efficace et adapte aux cheveux afro. Du coup, je me suis réconcilié avec cette huile si précieuse qui jusque-là ne faisait pas partie de mes produits favoris, car comme beaucoup d’autres, j’avais cette image péjorative du coco. Cette (re)découverte m’a donné envie d’aller plus loin.
Au début, je fabriquais mes produits pour le fun et par souci économique et j’ai commencé à le faire partager autour de moi et ça a plu. J’ai eu envie de partager ma passion à plus grande échelle et le projet a été tout de suite bien accueilli par le public. Je pense qu’au-delà de la qualité du produit ce qui a plu, c’est l’image positive et moderne que nous avons su véhiculer à travers la marque.
Beaucoup de jeunes femmes se sont reconnues dedans et surtout cela a permis de valoriser l’image de la femme comorienne au-delà des frontières, car nous avons eu la possibilité à d’exposés nos produits lors de salon à l’étranger. Pour moi ça été un grand soulagement de voir que les gens ont compris la démarche et ne sont pas restes bloquer sur les représentations négatives du coco. Et c’est un hommage au savoir-faire de nos « Koko » (aînée / grand-mère) qui avait compris les vertus de la nature.
ADI : après un accueil chaleureux de la communauté et une reconnaissance qui dépasse les frontières de l’archipel grâce à vos distinctions quelles sont vos perspectives pour CocoMoon ?
Nous envisageons de passer à la vitesse supérieure afin de répondre à la demande croissante. Pour cela, nous devons mécaniser notre production, car actuellement, tout est réalisé de façon artisanale. En exportant la marque CocoMoon profitant ainsi de l’opportunité inouïe que nous offre l’ère du digitale.
Nous travaillons sur les déclinaisons de la gamme qui pour l’instant a été très bien accueillie par nos clientes dans l’archipel et de la diaspora, car très efficace pour les cheveux afro qui ont besoin d’une attention particulière.
Mais le plus gros du travail reste dans la sensibilisation des communes sur le reboisement des cocoteraies qui vieillissent. Notre mission est de sécuriser notre production tout en faisant en sorte qu’elle s’approprie ce patrimoine agricole afin qu’il soit un atout économique au regard des multiples secteurs concernés. (alimentation, artisanat, textile, énergie, etc.)
ADI : c’est un projet très ambitieux, comment faites-vous pour assurer la réalisation de vos projets et votre vie personnelle ?
Je pense que cela repose en trois mots : Organisation, Priorisation et Collaboration ! Et c’est autant valable dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle.
Je ne travaille pas seule dans ce projet. J’ai une associée qui est ma cousine et sœur de cœur. Et j’ai la chance d’être entouré d’entrepreneurs dans ma famille donc ils comprennent ma démarche et m’accompagnent grâce à leurs conseils et leur soutien dans le processus de réalisation de ce projet. D’ailleurs, je ne le considère pas vraiment comme un travail ou une activité dans le sens traditionnel, c’est devenu un mode de vie dans lequel je m’épanouis dans ce que j’aime faire et aime partager. Mes enfants aussi sont très impliqués et inspirés. Ils aiment beaucoup observer le processus de fabrication, il leur arrive même de cueillir et collecter des plantes ou des graines pour que j’en fasse des « ingrédients ».
ADI : quel conseil donneriez-vous à ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans l’entrepreneuriat ?
Qu’il faut oser se lancer. Suivre son intuition, sortir des sentiers battus et de sa zone de confort car c’est de la que naissent les plus beaux projets et les plus belles innovations. Choisir un projet en adéquation avec leur passion leur compétence. Faire les choses avec enthousiasme et conviction. Je leur dirais également de toujours se former, s’informer et être à l’écoute des besoins des autres pour mieux les servir, car c’est comme ça qu’on arrive à donner de la valeur à ce que l’on fait. En tout, je pense que c’est la clé de la réussite.
Pour plus d’info :
Emil : moufida.mohamed@cocomoon-beauty.com
https://web.facebook.com/Cocomoon-1884782145143362

 Dans un article du Nouvel Obs, Souleymane Bachir Diagne s’imaginait expliquant à son enfant les fondements du soufisme. Tantôt définie comme la branche mystique de l’Islam, tantôt vue comme une démarche purement spirituel et indépendante du dogme, le soufisme est aujourd’hui plus que jamais d’actualité : Eric Geoffroy en parlant de la spiritualité musulmane, la désignait comme la seule solution pour la pérennité de l'Islam.
Dans un article du Nouvel Obs, Souleymane Bachir Diagne s’imaginait expliquant à son enfant les fondements du soufisme. Tantôt définie comme la branche mystique de l’Islam, tantôt vue comme une démarche purement spirituel et indépendante du dogme, le soufisme est aujourd’hui plus que jamais d’actualité : Eric Geoffroy en parlant de la spiritualité musulmane, la désignait comme la seule solution pour la pérennité de l'Islam.