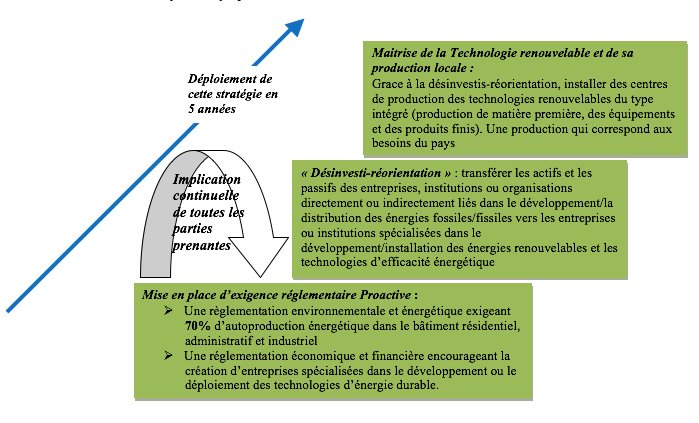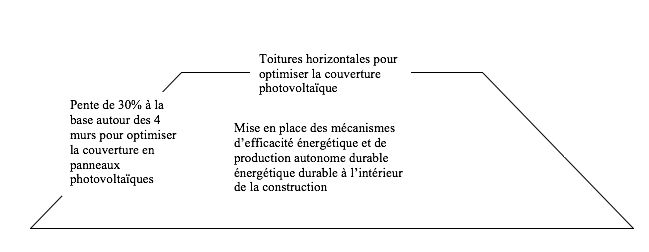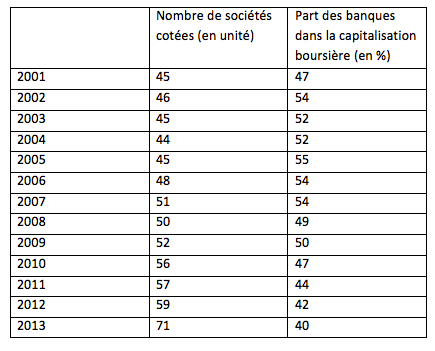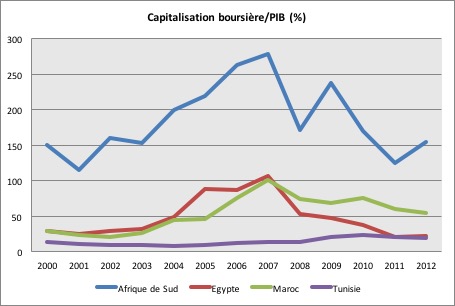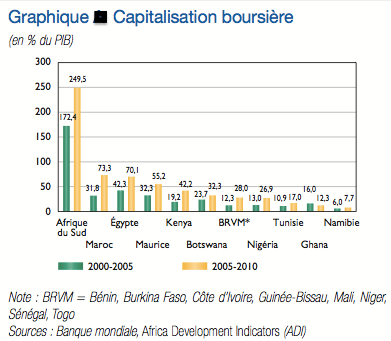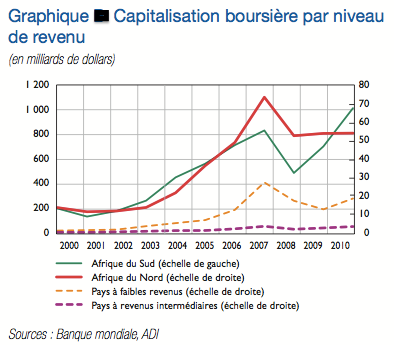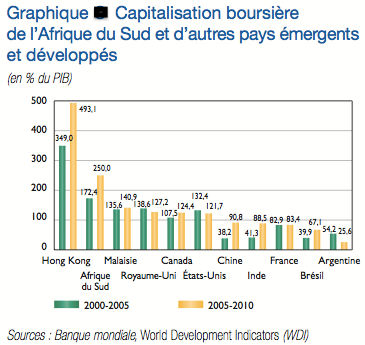Du troisième trimestre de l’an 2007 au deuxième trimestre de l’an 2009, le monde était frappé par une des plus sévères crises économiques de son histoire, après la crise de production de 1929. Cette crise a mis à jour plusieurs défaillances dans la gestion des liquidités des banques[1]. Ainsi, afin de renforcer et assurer un système financier sain, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a établi en 2010, dans le cadre des accords de Bâle III, deux standards de liquidité à savoir : le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR). Ces ratios sont entrés en vigueur graduellement depuis 2015 et seront entièrement appliqués en 2018 pour le ratio structurel de liquidité, et en 2019 pour le ratio de liquidité à court terme. En revanche, la plupart des pays africains n’ont pas encore adopté ces normes de liquidité. Par exemple, selon un rapport de l’agence Finafrique réalisé en 2015, les pays de l’UEMOA et de la CEMAC sont encore en migration vers le Bâle II pendant que le Nigeria est aux normes du Bâle II. Ces pays aspirent néanmoins à l’application du Bâle III. Quel pourra être l’impact de ces normes de liquidité sur les économies des pays africains ?
Le ratio de liquidité à court terme (LCR)
Le ratio de liquidité à court terme a pour but de permettre aux banques de posséder des actifs liquides de haute qualité pour résister à une crise de liquidité idiosyncratique ou systémique[2] sur un mois. Pour le calculer, le stock d’actifs liquides de haute qualité est divisé par les sorties nettes au cours des 30 prochains jours calendaires. Les actifs hautement liquides correspondent aux actifs de niveau 1 (cash, réserves au niveau de la banque centrale…) et de niveau 2 (les obligations sécurisées notées AA- ou plus et les actifs avec 20% de pondération au risque).
Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)
Le ratio structurel de liquidité à long terme est un ratio permettant aux banques de faire face au risque de liquidité sur le long terme. Il est calculé en divisant le montant du financement stable disponible par le montant du financement stable exigé. Il peut alors être défini comme la proportion d’actifs à long terme[3] financés par un financement à long terme ou stable[4]. Le financement stable disponible concerne la part du capital et du passif dont l’échéance est supérieure à un an. Le financement stable requis correspond aux différents actifs détenus par la banque concernée, y compris ceux de son exposition hors bilan[5]. Par conséquent, avec le ratio structurel de liquidité à long terme, les régulateurs veulent inciter les banques à maintenir un profil de financement stable par rapport à la composition de leurs actifs et de leurs activités hors bilan. Le ratio structurel de liquidité à long terme oblige ainsi les banques à utiliser des sources de financement stables dans l’optique de réduire la probabilité de perturbation des sources de liquidités régulières de la banque, ce qui est censé réduire la probabilité de faillite.
Il vise également à réduire le recours excessif au financement de gros à court terme[6]. Les banques peuvent en effet être incitées à élargir leurs bilans très rapidement. Pour cela, elles peuvent s’appuyer sur un financement de gros à court terme bon marché. Et pourtant, une augmentation rapide de la taille du bilan peut affaiblir leur capacité à répondre aux chocs de liquidité.
Les limites de la règlementation de la liquidité du Bâle III
Même si les nouvelles réglementations du cadre de Bâle III semblent permettre d’éliminer une bonne partie du risque de liquidité bancaire et constituent un progrès considérable dans la gestion du risque de liquidité, leur application peut générer de nouveaux problèmes. En effet, le ratio de liquidité à court terme accorde de l’importance aux actifs non risqués comme les obligations d’État. Ainsi afin de satisfaire cette exigence règlementaire, les banques pourraient préférer prêter aux gouvernements et être moins incitées à prêter aux investisseurs. Cela réduira l’investissement privé. Cette baisse de l’investissement privé peut engendrer le ralentissement de l’activité économique si elle n’est pas compensée par l’accroissement de l’investissement public effectué grâce aux prêts bancaires. En outre, nous avons tous été témoins de la crise de la dette souveraine en 2011 dans la zone euro. Cette crise a montré que le risque de défaut d’un État peut exister et donc les obligations d’État peuvent être risquées et illiquides.
Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) présente également ses failles. La principale limite de ce ratio est en effet, qu’il va à l’encontre d’une des principales fonctions intrinsèques aux banques : la transformation de maturité. Les banques transforment les fonds à court terme tels que les dépôts d’épargne en emprunts à long terme comme les hypothèques. Ainsi, dans un objectif de réduire l’asymétrie de maturité tout en exigeant des banques qu’elles financent une bonne partie des actifs à long terme avec des fonds stables, le ratio structurel de liquidité à long terme pourrait pousser les banques à offrir moins de crédit et à une allocation des ressources non optimale. D’une part, une allocation de ressources peu efficiente impactera négativement la performance des banques et d’autre part le rétrécissement de l’activité de crédit entrainerait le ralentissement de l’activité économique.
Règlementation du risque de liquidité du Bâle III : danger ou solution pour l’Afrique ?
Les banques sont aussi connues pour être le poumon des économies. Elles financent les économies essentiellement par leurs prêts qu’elles octroient aux agents économiques. Elles rationnent les prêts et fixent la rémunération de ces prêts (taux d’intérêt débiteur) selon le profil de risque des potentiels emprunteurs. La rémunération des prêts constitue la prime du risque pris par la banque. Ainsi, plus le risque est important, plus le taux d’intérêt sera élevé. Les banques octroient également les crédits en fonction de l’environnement économique. Elles seront plus incitées à produire des prêts à des taux relativement faibles lorsqu’elles ont confiance en l’environnement économique.
De façon générale en Afrique, les banques font face à des potentiels emprunteurs assez risqués du fait de l’opacité de ceux-ci. Cette opacité est soutenue par le poids non-négligeable de secteur informel (25 % à 65 % du PIB selon le FMI). Le manque d’information sur les demandeurs de prêts constitue un élément essentiel qui réduit l’activité de prêts des banques et surtout qui exige des taux d’intérêt élevés. En plus, il n’existe pas d’importantes structures pouvant augmenter l’incitation des banques à prêter. Dans les pays développés par exemple, il existe des structures qui accompagnent les chômeurs (tel que pôle emploi en France). Ces structures garantissent une entrée de revenus pour les travailleurs en cas de perte d’emploi réduisant ainsi le risque de défaut lorsque ces travailleurs souhaitent avoir un prêt. L’absence de telles structures dans la quasi-totalité de l’Afrique, ne facilite pas la mise en place des crédits de la part des banques.
Certes, on pourrait atténuer ce problème avec la mise en place d’une assurance mais la prime d’assurance viendrait rendre le cout total des prêts plus importants. De plus, pour la plupart des prêts accordés, la banque exige une assurance vie qui garantira le remboursement du prêt en cas de décès de l’emprunteur. En Afrique l’espérance de vie est en moyenne 60 ans alors qu’en France, elle est de 82 ans selon la radio publique d’information française France info. Dans un communiqué de presse de l’OMS paru en 2016, vingt-deux pays de l’Afrique subsaharienne ont une espérance de vie de moins de 60 ans. On se retrouve alors avec des primes d’assurance beaucoup plus élevées en Afrique d’où des couts de prêts assez significatifs à supporter par le potentiel emprunteur. L’importance de ces coûts impactent évidemment de manière négative la demande de prêt. Le taux de bancarisation est également assez faible en Afrique. Il est de 10% en Afrique subsaharienne, se situe entre 7,4 et 8% dans la zone UEMOA et avoisine les 40% au Maroc contre 99% en France selon la chaine d’information Africa24. Par conséquent, les banques collectent moins de dépôt en raison de la thésaurisation des ménages. Et pourtant pour effectuer les prêts, la banque utilise essentiellement ses dépôts. Ainsi la faible collecte de dépôts décourage la mise en place de prêts et incite davantage à rationner les crédits. Enfin, l’aléa de l’instabilité politique de certains pays ne favorise pas également la mise en place prêts car cela détériore la confiance des banquiers.
En raison de ces aspects, les banques africaines limitent leurs activités de prêts et exigent des taux d’intérêts élevés.
Comme énuméré plus haut, les nouvelles exigences de liquidité dans le cadre du Bâle III pourraient inciter les banques à moins prêter. Ainsi leur application en Afrique, un continent qui souffre déjà du manque de financement, pourrait être néfaste pour la performance des banques africaines et surtout pour les économies africaines. Il serait du coup intéressant de songer à une règlementation selon le niveau de développement des pays.
Sources
Basel Committee on Banking Supervision, 2010, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.
Idrissa Coulibaly, 2015, L’impact des réglementations internationales BÂLE I, II & III sur le système bancaire africain, FinAfrique
[1] Le terme liquidité est vaste. Nous pouvons néanmoins distinguer trois définitions de base : (i) la liquidité d’un titre financier définie comme la facilité de le vendre sans perdre de la valeur ; (ii) la liquidité du marché définie comme étant la possibilité d’échanger sur ce marché une grande quantité de titres sans influencer leurs prix ; (iii) la liquidité de financement que l’on peut définir comme la capacité d’honorer ses obligations dans le temps. On peut ainsi associer le risque de liquidité à chaque aspect. Le risque de liquidité d’un actif est le risque qu’on ne puisse pas le vendre sans perde de la valeur. Le risque de liquidité du marché est le risque qu’on ne puisse effectuer plusieurs transactions sur le marché sans impacter les prix et le risque de liquidité de financement d’une firme est le risque que cette firme ne parvienne pas à satisfaire ses obligations sur un horizon donné.
[2] Une crise de liquidité idiosyncratique d’une banque est une crise de liquidité qui touche que cette banque tandis qu’une crise de liquidité systémique est une crise de liquidité qui touche de façon simultanée plusieurs banques.
[3] Il s’agit des actifs ne pouvant pas être liquides ou utilisés avant au moins un an.
[4] Les sources de financement à long terme sont des ressources étalées sur plus d’un an (capital, dettes de long terme…).
[5] Les activités hors bilan d’une banque sont l’ensemble de ces activités qui ne sont pas inscrites dans son bilan. Il s’agit par exemple des engagements de crédits.
[6] En plus de la source de financement traditionnelle qu’utilisent les banques (dépôts à vue), elles utilisent aussi Le financement de gros. Cette source de financement correspond essentiellement pour les banques américaines, aux federal funds (fonds fédéraux), foreign deposits (dépôts étrangers) et brokered deposits (dépôts effectués par un courtier). Ces types de financement sont le plus souvent de court terme. Du coup, une banque fortement dépendante de ces types de financement peut facilement faire face à un problème de liquidité si elle est perçue comme risqué ou peu capitalisée.