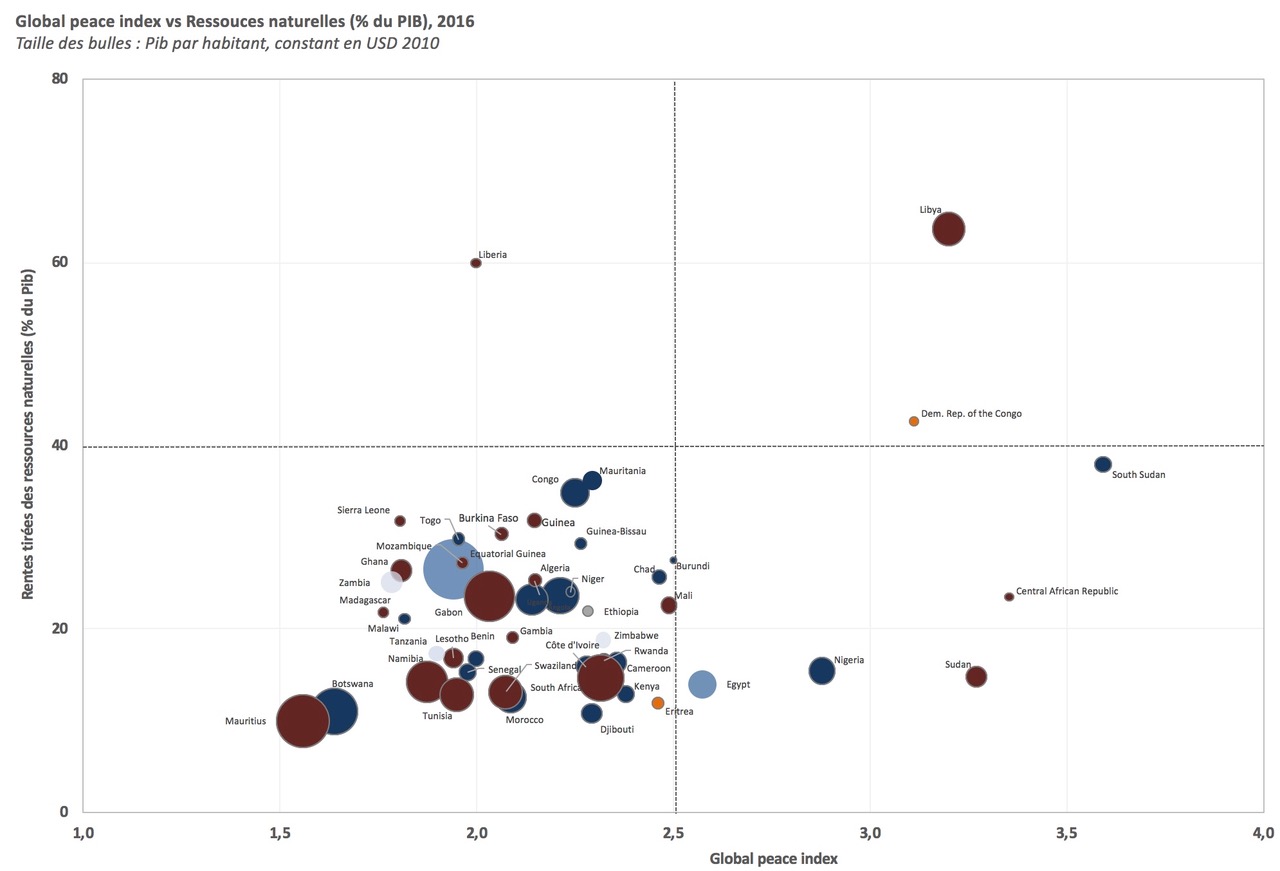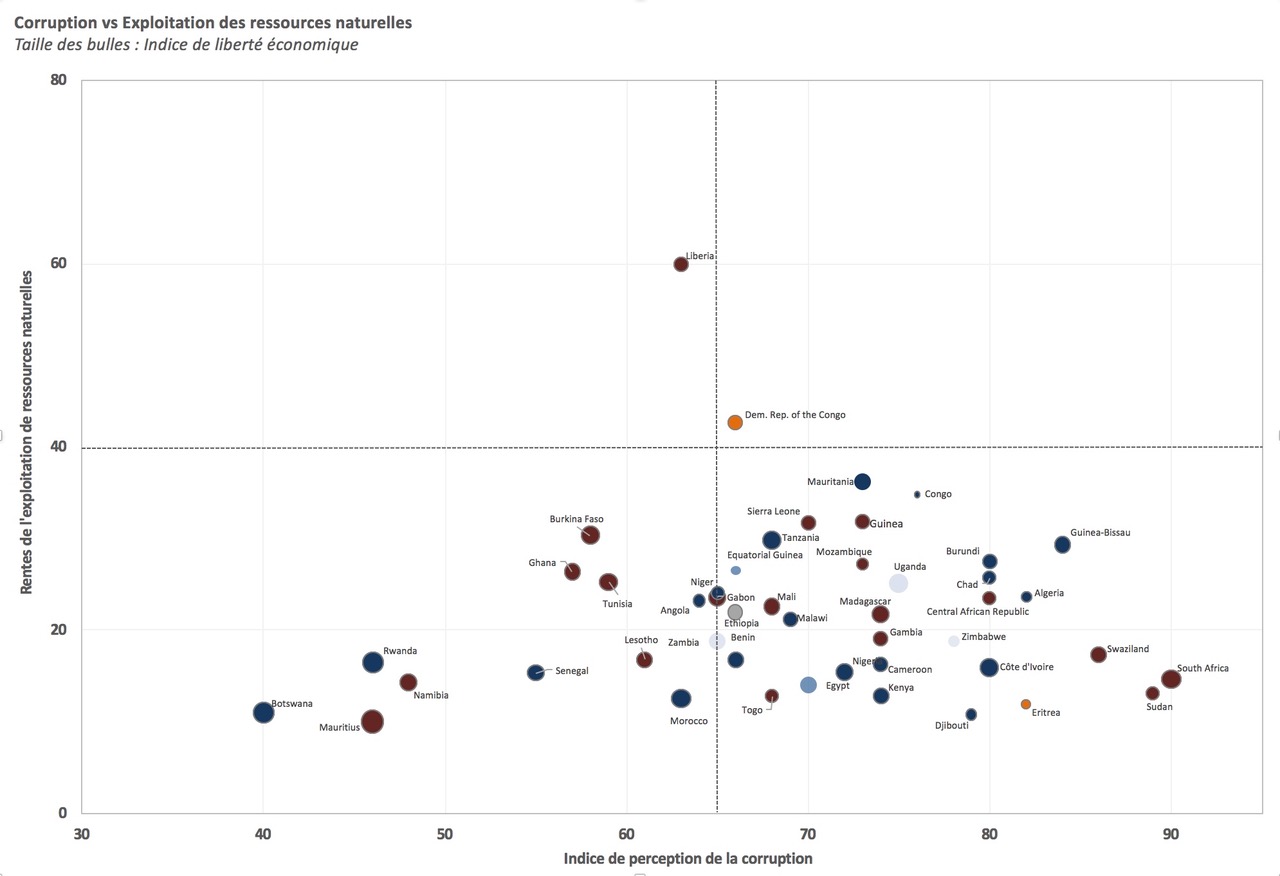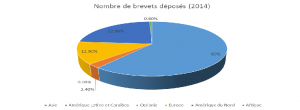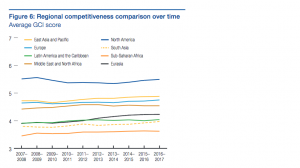Étiquette : développement
La Chine en Afrique : un loup dans la bergerie ?
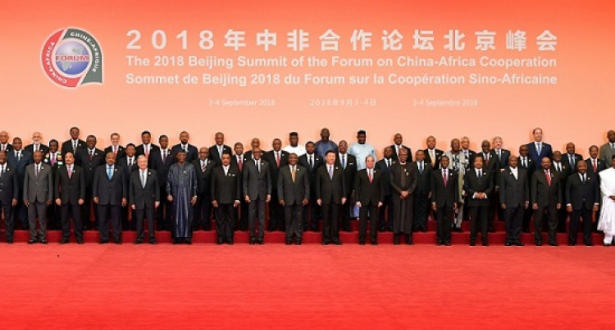 Le 03 septembre, le président chinois, Xi Jinping, annonçait au profit de l’Afrique une enveloppe de 60 Mds USD (15 en dons ou prêts sans intérêt ou concessionnels, 20 en crédits, 10 pour l’aide au développement et 5 pour supporter les importations chinoises en provenance d’Afrique ; le reste devrait être porté par le secteur privé) pour les trois prochaines années. Pour les occidentaux, c’est un cadeau empoisonné[1] alors que les autorités africaines voient en la Chine, ce partenaire qui va les aider à atteindre « l’émergence », tant souhaité.
Le 03 septembre, le président chinois, Xi Jinping, annonçait au profit de l’Afrique une enveloppe de 60 Mds USD (15 en dons ou prêts sans intérêt ou concessionnels, 20 en crédits, 10 pour l’aide au développement et 5 pour supporter les importations chinoises en provenance d’Afrique ; le reste devrait être porté par le secteur privé) pour les trois prochaines années. Pour les occidentaux, c’est un cadeau empoisonné[1] alors que les autorités africaines voient en la Chine, ce partenaire qui va les aider à atteindre « l’émergence », tant souhaité.
La Chine est prédatrice ; ce n’est pas nouveau ! Depuis 2013, avec le lancement du projet de « nouvelles routes de la soie » (la Belt and Road Initiative – BRI), les intentions des autorités chinoises sont plutôt claires. Le pays veut s’imposer comme la première puissance économique mondiale. La BRI n’est qu’une déclinaison de cette volonté. Et l’Afrique n’est pas le seul continent au cœur de cette stratégie. Se positionnant comme l’usine du monde, la démarche chinoise apparait évidente : acheter les matières premières en Afrique (et aussi en Amérique Latine), les transformer chez elle et inonder le marché occidental. Pour atteindre cet objectif, la Chine use de toutes les armes dont elle dispose. Et en Afrique, c’est la puissance financière qui est de rigueur. Elle offre aux autorités africaines une alternative réelle par rapport aux partenaires traditionnels, dont les actions en Afrique n’ont pas permis « l’émergence » du continent, un demi-siècle après les indépendances.
Chine ou Occident, les intentions et les regards portés sur l’Afrique restent les mêmes : l’Afrique est un marché de matières premières et de consommation de produits finis ; alors chacun essaie de se tailler sa part. Les méthodes ne divergent pas non plus grandement. Tout passe par la puissance financière. Seulement, alors que l’Occident dont les moyens financiers sont limités usent de conditionnalités relatives aux conditions socio-politiques et économiques pour rationner ses aides ; la Chine se soucie peu ou pas de leur solvabilité[2] ou des conditions socio-politiques et ses actions en Afrique sont visibles. Elle apporte une réponse aux défis du continent en matière d’infrastructures[3]. Son influence s’accroît et dépasse même les aspects économiques. On va progressivement vers l’installation de bases militaires chinoises sur le continent ; une existe déjà à Djibouti. Aujourd’hui la plupart des pays africains, à l’exception du Swaziland, ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan pour s’attirer les faveurs de Pékin. Par extension, il serait difficile pour l’Occident aujourd’hui d’user de voix africaines pour faire voter des décisions contre la Chine à l’échelle internationale. En bref, la Chine ne fait pas pire, ni mieux que les occidentaux. Elle dispose seulement d’une assise financière plus robuste, évite de s’ingérer dans les questions politiques (ce que la jeunesse africaine reproche de plus en plus aux occidentaux) et faire preuve de pragmatisme en s’assurant de rendre très « concrète » son action en Afrique, de sorte à s’imposer sur les marchés que les occidentaux leur croyaient acquis. En fait, les accusations de néocolonialisme formulées à l’encontre de la Chine par les occidentaux s’apparentent aux pleurs du renard qui voit le loup entrer dans son garde-manger.
L’acharnement médiatique vis-à-vis de la Chine quant à ses actions financières en Afrique n’a pas lieu d’être. Certes les risques liés à la dette chinoise, et à l’évolution rapide de la dette des pays africains en général, nécessite d’être discutée, pour identifier les goulots d’étranglement et proposer des solutions, au lieu de rester dans une forme de dénonciation. La Chine adopte aujourd’hui une démarche qui permet de financer et de réaliser des projets, en s’affranchissant des multiples procédures et règles souvent de rigueurs avec les partenaires traditionnels des pays africains. Cette démarche est à parfaire pour inclure davantage l’expertise locale avec une stratégie d’endettement cohérente, afin de paver la voie pour une transformation structurelle des économies africaines.
Une chose est certaine, c’est que l’Afrique appartient aux africains et à ce titre, ils feront à travers leur dirigeants les choix qui leur conviennent le mieux pour atteindre leurs objectifs. Il convient pour ce faire de tirer les leçons d’un demi-siècle de partenariat avec l’Occident pour améliorer le cadre des partenariats avec le reste du monde et d’en minimiser les risques potentiels. « Tout est bon mais tout n’est pas utile ».
Mais au-delà de tous ces discours experts sur la relation sino-africaine, une question devrait retenir toute l’attention. Que pensent réellement les africains de la présence chinoise ? Ce partenariat change-t-il pour le mieux leurs conditions de vie ?
[1] Voir ces articles de Telegraph, de BBC ou du Monde.
[2] L’évolution de la dette des pays africain reste quand même un facteur d’inquiétudes. Les analyses de viabilité de la dette (AVD) réalisées par le FMI et la Banque Mondiale, montrent que le profil de risque d’endettement des pays africains a rapidement évolué entre 2012 et 2015. Sur les 39 pays bénéficiaires de l’IPPTE, ont déjà atteint un risque élevé d’endettement (contre 5 en 2012), 18 sont classés en risque modéré (13 en 2012) et 5 sont classés en risque faible (contre 11 en 2012). Les emprunts auprès de la Chine y contribue considérablement. En 2016, les prêts chinois aux gouvernements africains atteignaient 30 Mds USD.
[3] Même si les conditions d’octroi et d’exécution des projets restent fortement discutables. Ces financements créent sur le sol africain des marchés pour les entreprises chinoises, qui empêchent le développement d’une expertise locale. Aussi en ne s’intéressant pas aux conditions socio-politiques, la Chine favorise le maintien d’un environnement socio-politique délétère. Toutefois, la démarche occidentale n’a pas résolu la question ; elle pourrait même être à l’origine de cette situation. Les récentes discussions sur les activités de Bolloré en Afrique constituent une preuve en la matière.
La malédiction des matières premières en Afrique : fantasme ou réalité ?
 Dans son rapport sur les investissements dans le monde en 2018, la Commission des Nations Unies sur le Commerce et le développement (Cnuced) fait état d’un recul de 21% des investissements directs étrangers vers l’Afrique en 2017. Selon l’institution, la baisse généralisée du cours des matières premières serait la principale raison à ce recul d’intérêt pour les pays africains. Ce constat vient témoigner davantage de l’importante dépendance des pays africains à leurs ressources naturelles. Cette forte richesse des pays africains en ressources naturelles, qui détermine leur trajectoire économique, est souvent considérée comme une malédiction. Un terme trop souvent associé au continent parce qu’ailleurs dans le monde, les ressources naturelles ont servi de base pour le développement ou l’émergence de certains pays. C’est le cas de la Norvège et de plusieurs pays du Moyen-Orient. Le cas des pays africains est-il alors singulier ? La richesse en matières premières des pays africains constitue-t-elle une entrave au développement ?
Dans son rapport sur les investissements dans le monde en 2018, la Commission des Nations Unies sur le Commerce et le développement (Cnuced) fait état d’un recul de 21% des investissements directs étrangers vers l’Afrique en 2017. Selon l’institution, la baisse généralisée du cours des matières premières serait la principale raison à ce recul d’intérêt pour les pays africains. Ce constat vient témoigner davantage de l’importante dépendance des pays africains à leurs ressources naturelles. Cette forte richesse des pays africains en ressources naturelles, qui détermine leur trajectoire économique, est souvent considérée comme une malédiction. Un terme trop souvent associé au continent parce qu’ailleurs dans le monde, les ressources naturelles ont servi de base pour le développement ou l’émergence de certains pays. C’est le cas de la Norvège et de plusieurs pays du Moyen-Orient. Le cas des pays africains est-il alors singulier ? La richesse en matières premières des pays africains constitue-t-elle une entrave au développement ?
Nous proposons dans cet article de porter un regard sur la question, en analysant la relation entre abondance des ressources naturelles, niveau de revenu par habitant et profondeur de la paix dans les pays africains.
Selon Richard Auty (1994)[1], précurseur de cette théorie, les économies axées sur l’exploitation de matières premières se développent plus lentement que les autres et font face à de la corruption et des violences internes. Ainsi selon cette théorie, les pays africains dont l’économie est fortement dépendante de l’exploitation de matières premières devraient afficher des niveaux de développement relativement faible et un climat social délétère.
Pour mesurer cela, considérons le revenu par habitant pour mesurer le niveau de développement[2], l’indice de globale de paix proposé par l’Institute of Economics and Peace[3] et le poids des rentes tirées de l’exploitation des matières premières dans le Pib. Le graphique[4] suivant combine ces trois dimensions et apporte quelques éléments de réponses.
La lecture de ce graphique permet d’établir deux constats majeurs. D’une part, la quasi-totalité des pays se concentre dans le coin droit du rectangle de bas à gauche, indiquant que sur le continent, le degré de pacifisme est plutôt moyen – ce que souligne à juste titre l’Institute for Economics and Peace dans son rapport 2018. En outre, le graphique met en exergue que l’exploitation des matières premières n’auraient pas d’incidence majeure sur la qualité de la paix et sur la stabilité socio-politique. Toutefois, dans certains pays, l’indice de paix est plus dégradé et il reste difficile d’attribuer cela au seul fait de l’exploitation des matières premières, sans toutefois écarter leur contribution. Au Nigéria[5] comme en RDC[6], par exemple, la persistance des conflits est liée à l’exploitation des ressources naturelles.
D’autre, part, les pays dont l’économie dépend fortement de l’exploitation de leurs ressources ont des niveaux de revenus par habitant plus faibles que ceux dont l’économie est moins dépendante. Plus impressionnant encore, on constate que ces derniers pays sont les plus paisibles et compte parmi les pays avec les niveaux de revenu par habitant les plus élevés du continent. Plus généralement, pour « un même niveau de paix » donné, les économies peu dépendantes de leurs ressources ont des revenus par habitant relativement plus élevés que les autres, à quelques exceptions près.
Si les ressources naturelles semblent avoir un impact peu significatif sur la paix, il semble qu’elles pénalisent fortement tout progrès économique. Toutefois, ce constat ne suffit pas pour établir un lien de causalité entre abondance de ressources naturelles et situation socio-économique ; parler de malédiction serait ainsi abusif. L’expérience d’autres pays non africains montrent que plusieurs autres facteurs entrent en jeu comme potentiels catalyseurs. Le cas de la Norvège est particulièrement édifiant dans ce sens : l’environnement économique et politique – gouvernance, environnement des affaires, corruption, etc. – apparait déterminant dans le rôle des ressources naturelles sur les trajectoires nationales de développement.
Le graphe[7] ci-après présente le positionnement des pays par rapport au niveau de corruption et à l’importance de l’exploitation des ressources naturelles dans le PIB. La corruption est mesurée par l’indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International[8] et le niveau de maturité de l’environnement des affaires par l’indice de liberté économique élaboré par The Heritage Foundation.[9]
Le constat majeur est que les économies les plus dépendantes de l’exploitation des ressources naturelles comptent parmi les plus corrompus du continent avec un environnement des affaires peu attractif. C’est le cas de la RDC, du Congo, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée, de l’Algérie ou de la Mauritanie. Le cas du Libéria est assez singulier. Le pays sort d’une longue période de crise et l’exploitation des ressources naturelles constitue pour l’heure sa principale source de revenus d’une part et l’environnement des affaires reste à améliorer d’autre part. On note aussi que les pays les moins dépendants de leurs ressources naturelles (tels que le Rwanda, la Namibie et le Botswana) affichent un faible niveau de corruption et sont plus attractifs pour les affaires. Pour les autres pays, la situation est plutôt mitigée : certains pays relativement peu dépendants de leurs ressources naturelles affichent des niveaux de corruption élevés avec un environnement des affaires qui reste perfectible (cas du Togo, du Kenya, Djibouti, etc.) alors que d’autres dont l’économie repose sur l’exploitation de ressources naturelles apparaissent meilleurs en termes de corruption et plus attractifs (cas du Burkina et du Ghana, etc.). Et cela transparait dans le niveau des revenus par habitant.
L’abondance des ressources annuelles semble contribuer assez fortement à la corruption, sans néanmoins l’être de façon systématique. Le cas de plusieurs pays du continent permet de déjouer tout hypothétique lien de causalité entre exploitation de ressources et corruption. Toutefois, la première peut entretenir la seconde, si elle existait déjà et que l’environnement des affaires présente des défaillances. Des pays comme le Congo, la RDC, l’Ouganda ou encore la Guinée illustrent parfaitement ce triste phénomène.
Les pays africains ne sont pas maudits par leur richesse en ressources naturelles et les pays dépendants de leurs ressources ne se trouvent pas systématiquement dans des situations socio-économiques critiques. Ils souffrent surtout d’un environnement institutionnel défavorable, qui exacerbe les dérives que peut engendrer une grande richesse si elle n’est pas correctement gérée. La trajectoire du Ghana l’atteste : avant la découverte du pétrole – dont l’exploitation a démarré en 2010 – le pays avait un environnement des affaires et institutionnel meilleur que celui que du Nigéria, de l’Afrique du Sud ou encore de la Guinée Équatoriale. Il ne s’est donc pas embourbé dans les travers de corruption qu’ont connus par les pays précités. Il est ainsi bon d’espérer que le Sénégal, l’un des pays les moins corrompus du continent, avec un environnement des affaires plutôt favorable, ne connaisse pas de semblables travers avec l’exploitation de son gaz.
La découverte de gisement de minerais ou de combustibles tend malheureusement à s’instituer en sport continental pour financer les programmes de développement des pays. Pour en profiter au mieux, les pays devraient renforcer leur institution et améliorer leur environnement des affaires, afin d’assurer la diversification de leurs économies. Les Gouvernements doivent plutôt viser à considérer l’exploitation des ressources naturelles comme une activité économique parmi d’autres ou/et, user de façon plus efficiente les revenus générés par ces ressources pour financer l’expansion de leur économie.
[1] Richard Auty (1993). Industrial policy reform in six large newly industrializing countries: The resource curse thesis. World Development 22, 11-26.
[2] Cet indicateur peut souffrir d’un effet de base liée à la population et ne suffit pas à juger de façon pertinente du niveau de développement. Cependant, il permet d’appréhender au mieux la situation socio-économique d’un pays.
[3] Cet indicateur mesure le degré de pacifisme dans un pays. en s’appuyant sur la participation du pays à des conflits armés (internes ou externes), le niveau de sécurité interne (criminalité, terrorisme, instabilité politique, pression policière et/ou politique, population carcérale, etc.) et le niveau de militarisation . Plus le score est faible, plus le pays est considéré comme paisible. Plus de détails sur le site de l’IEP.
[4] Pour tenir compte de l’échelle, les données sur les rentes ont été augmentées de 10. Ainsi, pour Maurice par exemple les rentes tirées de l’exploitation des ressources naturelles sont nulles et ne représentent pas 10% du Pib. Pour chaque pays, la donnée réelle est donc celle présentée sur le graphe à laquelle il faut soustraire 10.
[5] Exploitation du pétrole et rébellions dans le delta du Niger
[6] Congo : la guerre des minerais, le récit d’un désastre
[7] Réduire de 10 les statistiques sur les rentes tirées de l’exploitation des ressources naturelles.
[8] Nous avons pour l’exercice, considéré le complément à 100 du score fourni par Transparency International, de sorte que les pays avec une corruption moindre se retrouveraient le plus à gauche du graphique.
[9] Cet indice mesure pour un pays donnée, la capacité à y mener des activités économiques sans contraintes légales majeures. Elle va plus loin que le Doing Business, à la mesure où elle tient compte du poids de la pression fiscale, de l’ouverture économique et de l’environnement légale pour les affaires.
Les ports, des ressources pour les économies africaines
 Les ports représentent de véritables leviers économiques pour les pays, générant d’importantes recettes fiscales. Les pays africains l’ont bien compris, et cherchent à développer ces infrastructures et les services s’y rattachant de diverses façons. Cet article propose de présenter certains enjeux économiques liés aux ports, avant de présenter les investissement et acteurs qui contribuent à faire des ports des infrastructures de poids.
Les ports représentent de véritables leviers économiques pour les pays, générant d’importantes recettes fiscales. Les pays africains l’ont bien compris, et cherchent à développer ces infrastructures et les services s’y rattachant de diverses façons. Cet article propose de présenter certains enjeux économiques liés aux ports, avant de présenter les investissement et acteurs qui contribuent à faire des ports des infrastructures de poids.
Le potentiel économique des ports
La tendance actuelle est de transporter le plus de marchandises possible dans des navires plus imposants pouvant transporter jusqu’à 19 000 EVP (Equivalent 20 pieds : unité de mesure mondiale). Cette tendance redessine le paysage maritime. Désormais les grands ports mondiaux tels que les ports de Shanghai ou celui de Singapour remplissent un rôle de hub (c’est à dire une plateforme de correspondance pour la marchandise, qui facilite l’acheminement de la marchandise vers un lieu différent), ce qui va déplacer les ports secondaires vers l’Afrique et Amérique du Sud : désormais l’Afrique du Sud prend en charge des navires de 10 000 EVP.
Sur le plan national, un port est un véritable levier stratégique et économique. En effet, plus le port sera attractif, plus il aura des chances de générer des recettes fiscales importantes pour l’Etat. Pour la plupart des pays africains, plus de 90% des importations et exportations passent par les ports. Ce lieu reste un moyen de contrôle de l’arrivé des marchandises avant de pénétrer le territoire. Divers acteurs contribuent au choix du port : les armateurs (structure proposant le transport de marchandises sur leurs navires), le chargeur (entreprises faisant appel aux armateurs) et enfin les transitaires qui mettent en relation ces deux acteurs.
Les pays enclavés comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, représentent des opportunités supplémentaires pour les pays côtiers : Par exemple, 60% des marchandises à destination du Mali passent par le port du Sénégal. Les pays côtiers sauront se différencier de par leur capacité à livrer les pays enclavés de l’hinterland rapidement et de manière efficace. Le critère de sélection des ports par les pays enclavés portera essentiellement sur les infrastructures environnant le port à savoir l’efficacité des réseaux routier et ferroviaire reliant le port. C’est pour ces raisons que les ports investissent également dans les liaisons multimodales. Deux grands projets vont dans cette direction. Le premier cas est celui de la boucle ferroviaire de 3 000 km reliant Cotonou (Benin) avec Parakou (Benin), Ouagadougou (Burkina Faso), Niamey (Niger) et Abidjan (Côte d’ivoire). Le deuxième cas est la ligne multimodal partant de Pointe Noir (République du Congo) et passant par Brazzaville (République du Congo) pour finir à Kinshasa (RDC).Cet axe est composé d’un réseau routier, ferroviaire et fluvial.
Investissements nécessaires
Pouvant s’étaler sur des surfaces jusqu’à 14 000 m² comme le port Richards Bay en Afrique du Sud, le deuxième plus grand port en conteneurs du continent Africain, les ports nécessitent des investissements lourds et permanents afin de maintenir leur attractivité et leurs performances.
L’investissement qui aura le plus d’impact reste le dragage, une technique qui permet d’enlever du sable, ou du gravier au fond de la mer. Cet investissement permet au port d’accueillir des navires avec des tirants d’eau (profondeur du bateau) plus important, qui peuvent par conséquent transporter plus de conteneurs. Le tirant d’eau conditionne toutes les activités sous-jacentes d’un port, ses équipements et ses infrastructures.
L’investissement le plus important en termes de coût est celui qui cible le matériel de manutention et les équipements. On retrouve dans cet investissement les équipements suivants :
- Portique de quai : Chargement et déchargement de porte-conteneurs
- Portique de parc (portique à l’intérieur du parc)
- Grue mobile
-
Elévateurs (Véhicule qui transporte conteneurs)
Les investissements portés sur les entrepôts comme l’agrandissement des lieux de stockage ou les machines assurant la logistique permettront d’améliorer la gestion et le suivi des stocks.
Le système informatique est aussi un investissement à ne pas négliger. L’on peut citer le port du Benin qui a décidé de consolider son réseau informatique, ce qui a permis de faciliter la collecte de la TVA et réduit la paperasserie et le délai d’attente des navires sur les quais.
Enfin, les investissements dans la desserte de l’hinterland permettront aux marchandises de pénétrer le marché intérieur dans les meilleurs délais et de meilleures conditions.
Ces efforts financiers ont pour principaux objectifs d’augmenter l’efficacité des ports, de réduire le temps d’attentes des navires et rendre disponibles les marchandises le plus rapidement possible.
Privatisations des concessions portuaires
Les investissements abordés peuvent représenter une grande partie du budget de l’Etat si le port est entièrement nationalisé.
Par conséquent, les Etats ont souvent recours à la gestion sous forme de concessions via des partenariats publics – privé. Ces partenariats consistent à céder une partie du port sous forme de concessions à des partenaires privés. Le Port Autonome de Dakar en est un exemple, avec DP World qui devrait investir plus de 500 millions d’euros sur 25 ans pour la construction et l’équipement du « port du futur ».
Parmi les principaux partenaires privés intervenant sur le continent, outre DP World, peuvent être citer Maersk qui gère le port de Monrovia au Libéria, et bien évidemment Bolloré avec plus de 15 ports à son actif sur le continent Africain.
Ce type de partenariat est à double tranchant pour la plupart des Etats faisant appel à des partenaires privés. Ce type de contrat a pour principal avantage de partager les risques et d’alléger les dépenses de la part des états. En effet, étant donné que les contrats de concessions ont généralement une durée moyenne de 15 ans, les entreprises sont plus enclines à effectuer des investissements de qualité, y compris en maintenance, puisqu’elles en tireront des revenus pendant cette période. Les inconvénients pour l’Etat sont d’une part la perte de contrôle des flux physiques des marchandises pénétrant sur le territoire. D’une autre part, les recettes fiscales liées au port peuvent être à la baisse car des exonérations fiscales sont parfois concédées.
A contrario, prenons par exemple le port de Radés en Tunisie dont la gestion n’est pas privatisée. Malgré le fait que ce port occupe la 9ème place du classement des ports africains, le port a des difficultés à répondre aux besoins d’une économie basée principalement sur l’import-export. Le délai d’attente est long pour charger et décharger les navires à cause des infrastructures qui présentent de problèmes d’efficience et de capacité et demandent à être rénovées. De plus, le port a initialement été conçu pour fonctionner avec le système Roll Off Roll On (RoRo) qui consiste à charger et décharger les marchandises en les faisant rouler sur une rampe et les transports de remorque. Cependant, face à la recrudescence des conteneurs dans le commerce maritime, le port a eu du mal à s’adapter. Les cris d’alarme sur le port ne sont pas tombés dans les oreilles d’un sourd puisque le gouvernement promet d’investir pour la création de deux nouveaux quais à conteneurs et une zone logistique de 47 hectares.
L’intervention de partenaires privés permet donc d’apporter un véritable soutien financier et technologique. En revanche, comme nous l’avons énoncé précédemment, le port est véritable levier économique et stratégique du pays. Il permet également aux partenaires privés de collecter des devises étrangères. Ces nombreux avantages peuvent inciter les partenaires privés à abuser de leurs positions, comme l’entreprise Bolloré qui a été soupçonnée à de nombreuses reprises de financer plusieurs campagnes présidentielles.
Le futur : quels seront les grands ports de demain ?
Grâce au développement du commerce entre la Chine et le Brésil avec l’Afrique, le commerce maritime s’est développé en parallèle pour supporter le volume échangé qui a été multiplié par 10 durant cette dernière décennie. Ces tendances ont permis de faire naître les futurs grands ports de demain.
En Afrique de l’Est, les ports de Mombassa et de Djibouti entrent en concurrence notamment pour accueillir les nombreux navires naviguant en direction du canal de Suez.
En Afrique de l’ouest, le classement place le port de Lagos en première position grâce à sa population et sa force économique. Ce dernier est suivi de loin par les ports d’Abidjan, Dakar et Douala.
En Afrique du Sud, le port de Richard Bay qui occupe la deuxième place du classement des ports Africains reste le maître incontesté de la zone.
En Afrique centrale, les zones de conflit détériorent les réseaux routiers environnants les ports de la zone, ce qui n’enlève en rien l’énorme potentiel que présente cette zone en matière de gestion maritime et de desserte de l’hinterland.
Enfin l’Afrique du Nord est largement dominée par le port Saïd en Egypte grâce à sa situation géographique avec le canal de Suez et sa proximité géographique avec la péninsule arabique. Le port de Tanger Med occupe la deuxième place et contrairement au port égyptien, il est principalement tourné vers l’Afrique mais aussi vers l’Europe. Il occupe également la troisième place des ports Africains.
La concurrence se joue autant au niveau continentale qu’au niveau mondial. Dans ce dernier, le critère de différentiation portera surtout sur le transbordement, puisque que celui qui aura le meilleur service de transbordement pourra concurrencer les ports de la mer Méditerranée. En Afrique, les ports pouvant apporter cette valeur ajoutée seraient le port de Dakar / Mombasa au Kenya mais aussi celui de Tanger Med au Maroc.
Enfin, le regroupement de plusieurs ports en GIE (exemple Haropa : regroupement des ports du Havre, Rouen et Paris) restera une option supplémentaire pour tirer son épingle du jeu et proposer des services communs et complémentaires comme le dédouanement ou le stationnement des conteneurs.
Issa Kanouté
Sources
Magazine African business (édition de Avril – Mai 2017)
KA, Seydou, Les ambitions contrariés du port de Dakar (African business), 2017
SAID ADEN, Samatar, La manutention portuaire au sein du terminal de Doraleh, 2010 :
http://www.memoireonline.com/09/11/4815/m_La-manutention-portuaire-au-sein-du-terminal-de-Doraleh9.html
LALEIX, Gaelle, L’empire Bolloré en Afrique: de la logistique aux médias, 2016
http://www.rfi.fr/afrique/20160413-france-empire-bollore-afrique-logistique-medias-ports-lome-conakry
ELION, Christian Brice, Transport : Bolloré opérationnalise le corridor Pointe-Noire/Brazzaville/Kinshasa, 2017a
http://www.adiac-congo.com/content/transport-bollore-operationnalise-le-corridor-pointe-noirebrazzavillekinshasa-63687
LA CONQUÊTE DE L’OUEST (DE L’AFRIQUE), 2016 – Ligne Cotonou – Abidjan
http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2015/09/03/la-conquete-de-l-ouest-de-l-afrique_4729018_3212.html#/
LEPIDI, Pierre, Comment l’Afrique de l’Ouest est devenue une cible pour les narcotrafiquants, 2016
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/26/comment-l-afrique-de-l-ouest-est-devenue-une-cible-pour-les-narcotrafiquants_4927153_3212.html
L’impact de la société civile sur le développement : l’exemple du Cameroun
 De nombreux pays africains ont eu des difficultés à atteindre leurs Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). L’amélioration de la gestion de l’aide internationale, passant par une participation accrue de la société civile, était alors au cœur des débats.
De nombreux pays africains ont eu des difficultés à atteindre leurs Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). L’amélioration de la gestion de l’aide internationale, passant par une participation accrue de la société civile, était alors au cœur des débats.
Alors que les gouvernements du monde entier se sont engagés à atteindre les nouveaux Objectifs du Développement Durable avant 2030, la société civile pourrait jouer un rôle décisif dans leur réussite. L’ampleur de ce rôle et ses conditions d’effectivité sont analysées dans cette étude qui aboutit sur des recommandations concrètes en matière de politiques publiques. Lisez l’intégralité de ce Policy Brief.
Les nouveaux défis de la santé en Afrique, quel rôle pour le numérique? – Livre blanc de la conférence annuelle 2017 de l’ADI
Dans un environnement d’extrême pauvreté, la maladie fait partie des principaux risques auxquels est confronté une part importante de la population africaine,[1] et ce, malgré des progrès significatifs enregistrés au cours des quinze dernières années. Selon les statistiques de l’OMS, l’espérance de vie à la naissance est ainsi passée de 44 ans en 2000 à 53 ans en 2015, soit une augmentation de 9 années.[2] Cependant, l’émergence économique de l’Afrique s’accompagne d’une augmentation de la prévalence des maladies chroniques[3] imputable aux nouveaux modes de vie et de consommation.[4] De même, l’explosion démographique, avec la concentration urbaine qui l’accompagne, augmente les risques d’épidémies, notamment de maladies infectieuses.[5]
Face à ces nouveaux facteurs de risque, l’Afrique accuse encore un retard en matière de politiques de santé, d’équipements, de personnels et de traitements. Par exemple, le nombre de médecins pour 1000 habitants a seulement cru de 0,1 point entre 1990 et 2011 en Afrique subsaharienne contre 0,9 point en zone Euro et 0,8 point dans l’OCDE.[6] Alors que les politiques publiques ont été principalement axées autour de la lutte contre le VIH-SIDA, n’est-il pas temps qu’elles intègrent les nouveaux défis en matière de santé auxquels les pays africains doivent se confronter ?
Pour répondre à cette question, L’Afrique des Idées organise sa 3ème Conférence Annuelle afin d’identifier les nouveaux défis en matière de santé en Afrique, de discuter des causes et de formuler des recommandations. Retrouvez les conclusions de ces échanges dans le livre blanc de la conférence.
[1] Selon les résultats de l’enquête Afrobaromètre de 2014/2015, la moitié des africains ont déjà renoncé à des soins de santé faute de moyens.
[2] Voir données OMS.
[3] Diabète, cancer, maladies cardio-vasculaires et respiratoires, etc.
[4] Le taux de prévalence des maladies chroniques non transmissibles est passé de 18,7% à 25% entre 1990 et 2000. BOUTAYEB A. “The Double Burden of Communicable and Non-Communicable Diseases in Developing Countries”. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 100, 2006, pp 191-199.
[5] Selon l’OMS, la plus longue et plus grave épidémie à virus Ebola a été enregistrée en Afrique de l’Ouest en 2014, avec plus de 150 cas recensés chaque semaine.
[6] Le nombre de médecins pour 1000 habitants est passé de 0,1 à 0,2 en Afrique subsaharienne entre 1990 et 2011 alors qu’il est passé de 3 à 3,9 en zone Euro et de 2 à 2,8 dans les pays de l’OCDE sur la même période. Données Banque Mondiale : http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS
Emmanuel, Dieu, est avec nous
 L’Afrique, il est vrai, vit une situation de traînée qui cadre mal avec son potentiel et surtout le contexte favorable à son renouveau économique. Ce qui est sûr, l’observation faite pour le continent, l’est aussi pour sa diaspora à l’échelle macroscopique tout aussi bien pour les membres de ses ensembles à l’échelle microscopique. Inutile d’investir dans un trop grand effort intellectuel de théorisation des paramètres et interactions du marasme économique, il suffit de s’observer pour comprendre. Comme disait le Mahatma Gandhi « sois le changement que tu veux pour le Monde ». Ainsi donc me vient l’idée de mettre en parallèle deux réalités et les pistes d’affirmation par l’Attitude censées entraîner un cercle plus vertueux voire susciter le déclic vers la réussite.
L’Afrique, il est vrai, vit une situation de traînée qui cadre mal avec son potentiel et surtout le contexte favorable à son renouveau économique. Ce qui est sûr, l’observation faite pour le continent, l’est aussi pour sa diaspora à l’échelle macroscopique tout aussi bien pour les membres de ses ensembles à l’échelle microscopique. Inutile d’investir dans un trop grand effort intellectuel de théorisation des paramètres et interactions du marasme économique, il suffit de s’observer pour comprendre. Comme disait le Mahatma Gandhi « sois le changement que tu veux pour le Monde ». Ainsi donc me vient l’idée de mettre en parallèle deux réalités et les pistes d’affirmation par l’Attitude censées entraîner un cercle plus vertueux voire susciter le déclic vers la réussite.
Les couches populaires africaines ou le manque de source de Paie
La confrontation avec la pauvreté suscite la débrouillardise et l’initiative personnelle pour palier le besoin à court terme de revenu. Le défaut d’éducation ou l’inadéquation avec le marché de l’emploi où la demande limitée issue des classes moyennes, tirant l’économie par leur pouvoir d’achat, cantonne les jeunes au chômage et au secteur informel (quand ce n’est pas la facilité de la délinquance lorsque le groupe a perdu son influence sur l’individu). La pauvreté est le regard habituel qui est porté sur l’individu et auquel celui-ci peut adhérer pour diverses raisons sans reconnaître la richesse inexploitée de cette ressource inactive. Le quotidien informel est donc fait de Providence et d’espoir que le Futur apportera une solution en lien avec la destinée de l’individu. Le comportement adopté est l’abnégation.
Compte tenu du manque d’opportunités disponibles et du statut de cuve de récupération de jeunes actifs par le secteur informel, ouvrir le champ des possibles par le regroupement d’une main d’œuvre polyvalente (en GIE?) puis la création de ponts stratégiques avec des acteurs économiques de la diaspora (en mode consultation) sous forme de consortium ou d’autres structures de travail. Le recours à Internet est un préalable où l’informel pourrait être vu comme une « industrie de la main d’œuvre » et faire Sa révolution.
La diaspora africaine ou le manque de source de Paix
L’importance de l’énergie dépensée dans le combat pour trouver un statut stable après une immigration économique fait souvent perdre de vue la vision initiale sinon le rêve qui a suscité toute l’entreprise. Malmené administrativement et pressé de retrouver un confort social preuve vivante du succès pour ceux qui sont restés, le recours au consensus sur son potentiel vs l’essentiel conduit au choix de l’édulcoration de la compétence (qui deviendra vite désuète voire obsolète) pour l’urgence de l’intégration économique. Il appelle parfois au recours facile au filet social qui endort dans la sainte précarité. Le vivre-ensemble ne se fait plus tant au niveau de l’enrichissement interculturel mais plus dans l’enlisement intellectuel. Le quotidien ethnique est fait de l’usure du Temps et de manque de confiance qui ne peut donner lieu à une attitude de courage et d’indépendance financière : Le comportement adopté est le déni de la réalité.
Compte tenu de la fréquente qualité des profils, dits choisis et non subits, ne plus hésiter à se confronter au marché local par l’expertise des activités d’entrepreneuriat extra professionnelles qui permettent de poursuivre une carrière valorisante en marge d’une autre guidée par la nécessité financière.
Toujours est-il que, de façon générale, L’Africain semble refuser la confrontation avec la souffrance non pas celle qui vit au quotidien dans sa condition de pauvreté ou de précarité et pour lesquels le baume religieux sert de justifiant, mais bien celle de la peur du passage à l’acte d’effort de construction sans le confort d’une manne gracieuse et bienfaisante disponible à souhait sans aucun mérite. En effet, après des périodes troubles de domination extérieure dues à la défaite militaire (à une époque où le pouvoir du Monde s’exerçait par ce medium), nos attentes de réhabilitation dans le concert contemporain des nations, marqué par l’économie, se situe à un niveau d’égalité avec des nations qui ont longtemps eu l’ascendant sans jamais avoir vraiment été chahuté dans leur position (excepté Haïti et l’Éthiopie pour citer ces deux exemples marquants). Du coup, il semble illusoire que le retour à un pied d’égalité voire de domination se fasse par le simple fait du rôle de victime réclamant assistance pour le retard pris de façon induite dans son développement.
Les autres tiers ne doivent leur avènement qu’à leur intention profonde de se reconstruire qui a nourrit leur volonté quotidienne. La solution de l’aide au développement, pas toujours transparente et souvent source d’ingérence, est une solution de dépendance quasi narcotique qui donne lieu à une pléthore de projets « d’entertainment » mais rarement d’ouverture à la grande prise de conscience : si l’on veut reconstruire le continent, il faut accepter de revêtir de façon crue notre condition actuelle pour susciter la révolte nécessaire au désir de changement durable. Fuir la réalité n’a pas été le choix du Rwanda qui a vécu un électro choc douloureux mais qui a dû aider au sevrage nécessaire avec le système entre les anciens colons et les indépendants de facette. C’est pour la mémoire de ceux tombés pour cet idéal de souveraineté qu’on se doit de finaliser la vision panafricaine qui, à défaut d’unifier, peut fédérer contre le même type de menace.
A l’heure où les rumeurs les plus folles courent sur les économies de la zone francophone de l’Afrique qui, force est de le constater, n’ont pas le même dynamisme que leur homologues anglophones, cette exhortation à la confiance est plus que nécessaire alors que couve une révolte mâle de la jeunesse déjà durement éprouvée. Les croyants naturels de cette planète ne doivent pas baisser les bras mais retrousser les manches pour sortir une fois pour toute d’une logique où le quotidien des peuples dits souverains se décident dans une autre région aux cinq frontières du mépris. Dieu est avec nous. A bon entendeur…
Arnaud Segla
Mise en ligne le 15.07.17
Comment les TIC peuvent-elles permettre à l’Afrique d’atteindre ses objectifs de développement ?
 Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont passé la barre des 18 mois de vie. L’heure du bilan inaugural passée, les compteurs sont remis en marche. Il ne faut point s’arrêter, il faut accélérer, tant la route apparaît longue et laborieuse. Mais la pauvreté n’est pas une fatalité et ensemble les Hommes pourront rendre à l’humanité entière, le droit à la dignité, le droit à une vie décente. Car, comme l’avait compris Nelson Mandela, « La pauvreté n’est pas naturelle, ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent, et ce sont les hommes qui la vaincront. Vaincre la pauvreté n’est pas un acte de charité, c’est un acte de justice. ». La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des armes non négligeables à disposition, des outils des temps modernes qui peuvent s’appeler : TIC, les Technologies de l’Information et de la Communication.
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont passé la barre des 18 mois de vie. L’heure du bilan inaugural passée, les compteurs sont remis en marche. Il ne faut point s’arrêter, il faut accélérer, tant la route apparaît longue et laborieuse. Mais la pauvreté n’est pas une fatalité et ensemble les Hommes pourront rendre à l’humanité entière, le droit à la dignité, le droit à une vie décente. Car, comme l’avait compris Nelson Mandela, « La pauvreté n’est pas naturelle, ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent, et ce sont les hommes qui la vaincront. Vaincre la pauvreté n’est pas un acte de charité, c’est un acte de justice. ». La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des armes non négligeables à disposition, des outils des temps modernes qui peuvent s’appeler : TIC, les Technologies de l’Information et de la Communication.
Comment les TIC, telles que nous les côtoyons de nos jours, peuvent-elles favoriser l’atteinte des ODD, en Afrique en particulier ? Telle est la problématique à laquelle le présent article se propose d’apporter des éléments de réponses pragmatiques.
Par choix, nous nous pencherons d’abord sur l’éducation et l’entrepreneuriat orientés TIC. Ensuite nous analyserons la corrélation entre les TIC, la femme et les ODD. Nous nous intéresserons enfin, à l’Intelligence Artificielle et son rapport au développement durable. Mais avant toute chose, nous présenterons un panorama rapide des ODD, un an après leur adoption.Sur la question des données, un article précédemment publié par L’Afrique des Idées mettait en exergue la nécessité de données fiables pour les ODD.
Les données sources du bilan inaugural sont issues du Rapport sur les objectifs de développement durable 2016
- Education technologique, start-up et ODD : une triangulaire qui marche !
L’apprentissage et l’appropriation du langage et des outils des nouvelles technologies, notamment par la gente féminine peuvent se révéler aussi nécessaires que porteurs. En effet, éduquer la jeunesse, celle féminine, en particulier dans un contexte africain, peut favoriser aussi bien l’objectif de l’éducation pour tous que celui de la réduction des inégalités entre les sexes : ODD 4 et 5. Cela peut également propulser l’entrepreneuriat féminine, l’emploi des femmes en général et la croissance (ODD 8).
Des initiatives naissent sur le continent africain, dans ce sens. C’est le cas notamment du mouvement #iamtheCODE et du programme WHISPA.
- Le mouvement #iamtheCODE
Le mouvement #iamtheCODE créé par Marième Jamme, a pour but de mettre en œuvre des actions visant à l’atteinte des ODD, par le biais de la science, la technologie, l'ingénierie, les arts, la mathématique et le design (STEAMD). Pour ce faire, il mise sur l’investissement dans les jeunes femmes à travers la formation technologique. L’objectif est d’initier à l’horizon 2030, 1 millions de filles et femmes au codage. Fort d’une méthodologie éprouvée, ce mouvement reconnu par ONU Femmes, travaille avec les gouvernements, les entreprises et les investisseurs pour faire des jeunes femmes, des leaders numériques. Une première édition de « SDGs Hackathon » co-organisé par #iamtheCODE et ONU Femmes en Novembre 2016 au Sénégal, a réuni une cinquantaine de filles formées aux techniques de codage.
« A movement has been launched, as we get girls interested in new technologies. The pilot that we organised in partnership iamtheCODE meet our desire and our commitment to helping women and girls, and especially it will allow us to achieve the Sustainable development Goals with inclusivity.»[1] – Oulimata Sarr, ONU Femmes
Brenda Katwesigye qui a bénéficié du programme de « mentorship » de #iamtheCODE, témoigne des avantages que les filles et femmes peuvent en tirer :
« I greatly benefitted from the iamtheCODE mentorship. On top of getting the drive and resources to learn how to code, I got a mentor who has held my hand through good times, tough times and periods of uncertainty. When you have some one that has walked your path before by your side, its almost like walking on a paved way. Tough things always get easier and entrepreneurship ceases to be a blind journey »[2]
Brenda Katwesigye – PDG de Wazi Vision
-
Le programme WHISPA
WHISPA (Women High Impact Startup Preparation Academy) est une initiative conjointe de TEKXL et de l’ONG EtriLabs qui s’est donnée pour mission : « La promotion des Technologies de l'Information et de la Communication dans l’éducation et pour le développement humain, économique et social en Afrique. ». Chaque année, une promotion de jeunes filles volontaires, est gratuitement formée aux rouages du numérique, dans le domaine de la programmation web, du marketing digital et du web design. Les plus endurantes et les plus méritantes des filles finissent l’aventure avec un bagage conséquent, un parchemin reconnu et des armes solides pour se lancer dans l’entrepreneuriat technologique.
Pour Senam Beheton, Directeur exécutif à Etrilabs : « Préparer adéquatement un petit nombre de femmes chaque année pour les startups en Afrique peut avoir un effet catalyseur sur l’ensemble de l’écosystème. A la fin de la première année, une cohorte de 25 jeunes femmes fera plus que doubler le nombre de talents actuellement disponibles dans la plupart des pays. En 3 ans, toutes choses considérées, le nombre de femmes peut égaler celui des hommes ayant des compétences similaires. Après cinq ans de formation, les femmes pourraient facilement dépasser les hommes pour ce qui est des programmeurs hautement qualifiés, des spécialistes du design, du marketing et d’autres compétences avancées nécessaires pour bâtir des startups réussies.
Une Afrique où la parité est facilement réalisée dans les équipes de startups, mieux, où les startups exclusivement féminines existent et prospèrent est possible. »[3]
Une « WHISPA » s’exprime : « Sans WHISPA, j’en serais pas arrivée là, je ne me serais jamais intéressée à la programmation, ni au design et encore moins au marketing. C’est grâce à WHISPA que j’ai pu travailler sur Save et que j’ai rencontré Aziz qui m’a permis de vivre cette merveilleuse aventure que fut le: MTN App Challenge 2015. (…) Avant WHISPA je ne savais même pas écrire une ligne de code malgré ma licence en informatique. Je pourrais même dire que la programmation ne m’intéressait pas. Mais en suivant la formation WHISPA j’ai trouvé un réel intérêt à la programmation et en plus de la programmation, WHISPA m’apprend le marketing et le design. Travailler sur Save était un exercice pour mettre en pratique mes acquis en programmation, marketing et design. »[4] – Hadjara IDRISS, Promotion WHISPA 2015, Co-fondatrice de Save – Co-fondatrice de mentorat.club
2- Le digital, la Femme et les ODD : une combinaison gagnante dans le monde de la Fintech
De la femme africaine qui épargne via son téléphone, sur le compte bancaire qu’elle a ouvert en quelques clics…
Diamond Bank et le Women’s World Banking ont compris une chose à laquelle ils travaillent ensemble depuis quelques années : Pour espérer atteindre le plein potentiel financier des zones émergentes et celles les moins avancées, il faut miser sur ceux qui sont en dehors du système financier formel. Il faut surtout aller à la rencontre des femmes qui, en 2012 n’avaient pas pour 74% d’entre elles au Nigéria, de comptes bancaires. Pourtant, ce sont elles qui animent les places de marché.
En 2012, ces deux institutions ont lancé le « BETA Savings Account », un produit d’épargne relavant du segment de la clientèle à faible revenu et, visant la population active sans comptes bancaires, surtout les femmes nigérianes, à la base. Le BETA way est simple : ouverture d’un compte bancaire en moins de 5 min sur téléphone portable, avec zéro dépôt initial. Des ambassadeurs de la banque vont rencontrer les femmes où elles sont, pour les initier à l’outil.
Le BETA Savings Account a eu du succès, très vite, auprès des femmes. En seulement 6 mois, il a enregistré 35000 ouvertures de comptes dont 40% par des femmes[5]. Elles ont voulu plus, par exemple épargner pour des causes précises comme une naissance, la scolarisation de leurs enfants. Le « BETA Target Savers Account » a été conçu pour répondre à ces attentes.
…à la femme 100% solvable qui obtient, par clics, un prêt pour développer ses affaires
Il faut noter que les femmes utilisatrices du BETA sont actives, souvent auto-employeurs dans l’informel ou non. Ce sont des opératrices qui ont besoin de ressources financières pour développer leurs activités; ressources auxquelles elles ont rarement et difficilement accès dans l’environnement bancaire traditionnel. Elles sont pénalisées par une distance physique, un déficit de confiance, l’illettrisme et l’absence de garanties solides. Là où la magie BETA va opérer, c’est bien au niveau du contournement assez spectaculaire de toutes[A1] ces barrières. La demande de prêt est tout aussi simple qu’un envoi de SMS. Aucune garantie n’est requise car la solvabilité est présumée sur la base de l’historique de dépôts du client. La réponse à la demande se reçoit sans délais par SMS et les fonds sont immédiatement disponibles sur le mobile. Testé en mode « projet » par Diamond Bank et le Women’s World Banking, il avait été très concluant avec un taux de remboursement de 100%[6].
Au final, que prouve le BETA ?
- que les femmes les moins « lettrées » peuvent rapidement s’approprier un service digital ;
- que les femmes peuvent faire d’un outil technologique, numérique ou digital, un usage à très forte valeur ajoutée pour elles (ex : santé, soins de maternité) et pour leurs proches (ex : scolarisation des enfants, survenances aux besoins vitaux), réduisant ainsi toutes les formes d’inégalité: ODDs 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6
- qu’on peut faire confiance aux femmes, même celles sans garanties financières, en matière de prêt parce qu’elles battent beaucoup de records de solvabilité, contribuant ainsi au dynamisme de l’économie réelle et à la croissance économique : ODD 8 et 10
3- L’Intelligence Artificielle : De la pure fiction ? Du délire ? Un facilitateur de développement durable ?
L’intelligence Artificielle (IA) au cœur des débats et de l’actualité
L’IA fait l’objet de beaucoup de thèses relevant tant de la fiction que de la philosophie voire de la réalité proche. Il y a, entre autres, ceux qui n’excluent pas des scénarios à la « Matrix » ou à la « Terminator », ceux qui ont peur de la machine remplaçant l’homme notamment dans le monde professionnel et, ceux qui défendent « dur comme fer » les nombreux atouts de l’IA. Mais notre but ici, n’est pas d’arguer en faveur d’une théorie ou d’une autre mais plutôt de recourir à l’actualité récente, pour essayer de situer l’IA par rapport aux avancées pouvant impacter les ODD dans le bon sens. Ce qu’on peut dire est que l’IA se fait de plus en plus présente dans notre quotidien de manière perceptible ou moins visible dans certains cas. Les voitures autonomes, par exemple, en sont l’œuvre. En Août 2016, l’IA d’IBM, Watson a diagnostiqué chez une patiente japonaise, une forme de Leucémie rare que les médecins n’avaient pas pu détecter.
Les grands groupes technologiques investissent beaucoup dans l’IA auquel ils semblent fermement croire. Nombreux sont-ils à se lancer dans la lutte contre le cancer, au moyen d’IA.
Un « partenariat pour l’intelligence artificielle au bénéfice des citoyens et de la société » par les géants des TIC !
Le 28 septembre 2016, Amazon, Facebook, Google, IBM et Microsoft ont lancé le « Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society » qui vise à soutenir les bonnes pratiques en matière d’IA, à œuvrer pour une meilleure compréhension de l’IA et à offrir une plate-forme d’échanges et d’expression d’engagement.
Ce partenariat repose sur huit (08) principes qui portent la promesse de l’IA, d’accroitre la qualité de vie des hommes et d’aider l’humanité à faire face à ses grands défis mondiaux comme le changement climatique, la faim, les inégalités, la santé et l’éducation (pouvant impacter plusieurs objectifs comme ODD 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 10 et 13).
Les dirigeants du monde parlent peu de l’IA mais récemment, la maison blanche d’Obama a marqué un grand pas en sortant un rapport sur l’IA.
L’administration OBAMA sur la question de l’IA
Dans une longue interview accordée au MIT et diffusée en Octobre 2016 par WIRE, le 45ème Président des Etats Unis s’était prononcé sur l’IA en exposant sa vision des avantages et des enjeux qu’il peut porter. Pour Barack OBAMA, il importe de faire la différence entre l’IA générale et l’IA spécialisée. Cette dernière utilisant des algorithmes et des ordinateurs pour réaliser des taches extrêmement complexes. Rappelant la présence remarquable de l’IA dans notre quotidien, touchant par exemple aux domaine de la médecine, des transports et de l’énergie, il a souligné que l’IA peut ouvrir la voie à beaucoup d’opportunités et favoriser la prospérité, mais qu’il peut également faire place à d’autres préoccupations :
« We’ve been seeing specialized AI in every aspect of our lives, from medicine and transportation to how electricity is distributed, and it promises to create a vastly more productive and efficient economy. If properly harnessed, it can generate enormous prosperity and opportunity. But it also has some downsides that we’re gonna have to figure out in terms of not eliminating jobs. It could increase inequality. It could suppress wages. » – Barack OBAMA, Ancien Président des Etats- Unis
Il est indéniable que l’IA soulève une grande question d’éthique et de responsabilité qu’il faut pouvoir reconnaitre et encadrer. Dans ce cadre, la Maison Blanche a publié le 12 Octobre 2016 un rapport sur l’IA portant 23 recommandations générales.La question de l’IA ne paraît pas encore d’actualité en Afrique mais il peut être intéressant de s’y pencher.
Delphine Anglo
[4] Becoming Nigeria’s “bank for everyone,” starting with women – By: Women’s World Banking on November 7th 2016
[5] Becoming Nigeria’s “bank for everyone,” starting with women – By: Women’s World Banking on November 7th 2016
Quels mécanismes de financement pour accompagner la politique urbaine des villes africaines ?
 Le continent africain connaît une urbanisation galopante et contraignante. En effet, selon la Banque Mondiale (février 2017), les agglomérations urbaines y abritent environ 472 millions d’habitants, un chiffre voué à doubler au cours des vingt-cinq prochaines années. Les grandes villes situées sur les littoraux du continent connaissent le phénomène de saturation urbaine et ne peuvent donc plus accueillir les flux de population. En outre, l’urbanisation est contraignante, car elle n’évolue pas dans les même proportions que la croissance économique. Par conséquent, les populations — notamment les plus pauvres et vulnérables — sont livrées à elles-mêmes ; ainsi, les villes africaines connaissent une informalité grandissante expliquée par une absence de réglementation de l’occupation du sol. Cette informalité est un problème alarmant auquel il faut trouver une solution ; mais qui doit s’en charger ? Les Etats ou les villes (les collectivités locales) ? En Afrique, si les États disposent des moyens plus importants pour mener des politiques d’envergure, la plupart des pays, sont régis par un contexte de décentralisation. Toutefois cette décentralisation est incomplète en raison des faibles ressources financières dont disposent les collectivités locales pour le financement de politiques locales. Comment financer le financement des villes africaines pour leur permettre d’accompagner de façon efficiente la forte urbanisation ? Nous allons, dans un premier temps, nous interroger sur les différents enjeux liés à l’occupation foncière, en exposant les relations de cause à effet entre l’urbanisation, la saturation urbaine et l’informalité. Ensuite, nous montrerons en quoi « la formalisation de l’informel » influe sur la morphologie des villes africaines. Enfin, nous exposerons en perspective différents mécanismes de réglementation qui permettraient aux villes africaines d’avoir des recettes financières plus solides pour financer leurs différentes politiques locales.
Le continent africain connaît une urbanisation galopante et contraignante. En effet, selon la Banque Mondiale (février 2017), les agglomérations urbaines y abritent environ 472 millions d’habitants, un chiffre voué à doubler au cours des vingt-cinq prochaines années. Les grandes villes situées sur les littoraux du continent connaissent le phénomène de saturation urbaine et ne peuvent donc plus accueillir les flux de population. En outre, l’urbanisation est contraignante, car elle n’évolue pas dans les même proportions que la croissance économique. Par conséquent, les populations — notamment les plus pauvres et vulnérables — sont livrées à elles-mêmes ; ainsi, les villes africaines connaissent une informalité grandissante expliquée par une absence de réglementation de l’occupation du sol. Cette informalité est un problème alarmant auquel il faut trouver une solution ; mais qui doit s’en charger ? Les Etats ou les villes (les collectivités locales) ? En Afrique, si les États disposent des moyens plus importants pour mener des politiques d’envergure, la plupart des pays, sont régis par un contexte de décentralisation. Toutefois cette décentralisation est incomplète en raison des faibles ressources financières dont disposent les collectivités locales pour le financement de politiques locales. Comment financer le financement des villes africaines pour leur permettre d’accompagner de façon efficiente la forte urbanisation ? Nous allons, dans un premier temps, nous interroger sur les différents enjeux liés à l’occupation foncière, en exposant les relations de cause à effet entre l’urbanisation, la saturation urbaine et l’informalité. Ensuite, nous montrerons en quoi « la formalisation de l’informel » influe sur la morphologie des villes africaines. Enfin, nous exposerons en perspective différents mécanismes de réglementation qui permettraient aux villes africaines d’avoir des recettes financières plus solides pour financer leurs différentes politiques locales.
L’occupation foncière dans les villes africaines pose trois enjeux fondamentaux
D’abord, l’informalité se manifeste par une occupation irrégulière, spontanée de l’espace, précisément du foncier urbain. En effet, généralement touchées par l’étalement urbain, conséquence d’une saturation urbaine, les grandes villes africaines ne disposent plus de suffisamment d’espace pour accueillir tous les candidats à l’exode rural. Ainsi, les populations, notamment les plus démunies, sont souvent obligées de s’installer sur le long des parties périurbaines en formant des bidonvilles, donc des habitats non lôtissés, avec une absence de système d’adressage et cadastral.
Ensuite, l’occupation foncière est la problématique la plus préoccupante et complexe dans les villes africaines. Une bonne partie du foncier urbain échappe à la fiscalité aussi bien le foncier réglementé (refus volontaire ou involontaire de payer la taxe d’acquisition d’une parcelle et la taxe foncière annuelle) que le foncier non réglementé (illégitimité administrative : occupation irrégulière, pas de permis de construire ni de permis d’aménager). Donc, si la mise en place d’équipements et d’infrastructures locales relève de la compétence des collectivités locales dans le cadre de la décentralisation, l’absence d’une taxe foncière solide condamne les villes à la pauvreté et rend la finance locale défaillante.
Enfin, les activités économiques informelles, notamment les petites exploitations commerciales (des marchands ambulants et des petits commerces de proximité), échappent généralement au contrôle de la fiscalité. Plus les activités économiques et commerciales sont importantes, plus les collectivités souffrent d’un « manque à gagner » financier. Elles doivent donc être programmées dans les politiques locales, avec la réservation d’espaces réglementés, accessibles et favorables pour les investisseurs et les petits commerçants locaux. Mais cela nécessite des ressources financières solides.
Le principal défi posé par ces trois enjeux est de réfléchir sur des mécanismes de réglementation qui permettraient d’avoir des finances locales plus solides à travers des recettes fiscales non seulement sur le foncier (taxe sur la propriété et l’occupation du sol), mais aussi sur les petites et moyennes activités commerciales informelles (taxes sur les activités, quelles qu’elles soient. Il s’agit donc de réfléchir sur des moyens de financement des collectivités locales pour qu’elles puissent améliorer le niveau de vie des populations. Ces solutions sont entre autres des politiques d’investissement solides pour améliorer l’offre de services existante pour les populations ; « la formalisation de l’informel » à travers une profonde réforme foncière qui passe la réorganisation du système cadastral et d’adressage.
Dans les collectivités locales africaines, une part des ressources provient de l’État dans le cadre de la décentralisation — même si ces ressources sont généralement insuffisantes pour financer toutes les politiques locales, du fait de la distribution clientéliste : « le parti politique avant la patrie » —, les recettes fiscales locales faibles, les subventions des bailleurs de fonds et les dons des associations à but non lucratif. Ces différentes sources de revenus n’étant pas suffisantes pour assurer toutes les dépenses publiques locales, le recours à l’investissement s’avère important. En quoi l’investissement consiste-t-il ? Selon J. Chenal (2013), l’investissement consiste d’une part à répondre à la forte demande d’équipements et d’infrastructures de la part des populations locales et d’autre part la fourniture de l’offre de services (équipements, infrastructures, etc.) qui s’inscrit dans une logique d’anticipation des besoins des populations. L’investissement est donc un mécanisme important pour relever le défi de la finance dans les collectivités locales africaines et il doit être centré sur la fourniture d’infrastructures pour accompagner la forte urbanisation et favoriser l’attractivité pour l’implantation d’entreprises.
La politique urbaine repose sur un assouplissement des rigidités administratives
Ensuite, « la formalisation de l’informel » passe inévitablement par une réforme structurelle des marchés fonciers. En effet, face à l’augmentation accrue de la population, le défi est de parvenir à loger le plus grand nombre. Il s’agit de mener une politique d’habitat et foncière solide, en assouplissant les démarches administratives pour accéder à la propriété foncière et de renforcer la réglementation de l’occupation en mettant en place des documents d’urbanisme adaptables et adaptés aux contextes locaux.
Ces documents d’urbanisme, une fois adaptés aux contextes sociologiques des villes africaines, devraient également préconiser des règles pour la régulation du prix du foncier (pour éviter les spéculations qui condamnent les plus pauvres, et favorisent par conséquent, le développement des bidonvilles), des prescriptions sur des zones constructibles et les zones non constructibles ; les périmètres aménageables et les périmètres non aménageables. Ces politiques de réglementation foncière doivent s’appuyer, en somme, sur deux systèmes : l’adressage et le cadastre.
L’adressage et le cadastrage : les leviers de la rationalisation de l’espace en Afrique
D’une part, l’adressage est un système d’identification et de localisation géographique qui permet de se positionner, de se situer dans un espace, dans une ville. Autrement dit, « adresser » une ville, revient à faire une nomenclature des entités spatiales, de l’échelle la plus petite (parcelle, rue), à l’échelle la plus grande (avenue, boulevard, quartier). Mettre en place un bon système d’adressage permettrait donc d’avoir des informations sur les différentes échelles spatiales de la ville, mais également les coordonnées géographiques exactes de chaque entité spatiale pour la conception d’une base de données efficace pour la détermination des taxes foncières, donc pour l’amélioration des ressources financières locales.
D’autre part, un système cadastral solide permet de répertorier les différentes parcelles disponibles et occupées, suite à un bon adressage : c’est le cadastre fiscal. Le cadastre permet d’avoir des informations claires sur les caractéristiques d’une parcelle, d’une rue, d’une entité spatiale. Autrement, il permet d’avoir une lecture précise sur le foncier : sa propriété, sa situation, son périmètre pour la sécurisation foncière : c’est le cadastre juridique. Enfin, le cadre permet d’avoir une lecture d’ensemble sur la ville pour la planification urbaine : on parle de cadastre technique. En somme, un bon système cadastral doit, cependant, être réactualisé continuellement, sans quoi, il ne donne pas des informations efficaces pour la taxe foncière.
En définitive, la croissance démographique est une illustration de la thèse anti-populationniste de Malthus dans les villes africaines. En effet, lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’un encadrement et d’une politique d’aménagement du territoire, elle dégrade le cadre de vie, dérégule l’occupation foncière, augmente l’informalité, etc. Donc, aujourd’hui, le défi du développement économique et du financement des villes africaines est la maîtrise de la démographie et donc de l’urbanisation. Il faudrait donc faire en sorte que la croissance démographique évolue en même temps que la croissance économique ; et cela doit passer par une bonne gouvernance urbaine, car selon la Banque Mondiale (février 2017) : « grâce à une meilleure gestion urbaine, les pays africains pourraient s’appuyer sur les villes pour accélérer leur croissance et s’ouvrir aux marchés mondiaux. »
Sources
Chenal J., La ville ouest-africaine : modèles de planification de l’espace urbain, février 2013, Metispress.
Afrique : des villes productives et vivables, la clé pour s’ouvrir au monde, WASHINGTON, 9 février 2017
http://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/africa-cities-opening-doors-world
The private sector: A strong vector for Morocco’s economic integration in Africa
 During the 27th African Union summit in Kigali of 18th July 2016,King Mohammed VI declared that ‘’Morocco is already the second investor in Africa but aims to become the Continent’s foremost investor very soon”. Indeed, between 2003 and 2013, more than 1.5 billion dollars have been invested by Moroccan companies in West and Central Africa. This only represents half of the direct foreign investments launched by Morocco, in the last few years.
During the 27th African Union summit in Kigali of 18th July 2016,King Mohammed VI declared that ‘’Morocco is already the second investor in Africa but aims to become the Continent’s foremost investor very soon”. Indeed, between 2003 and 2013, more than 1.5 billion dollars have been invested by Moroccan companies in West and Central Africa. This only represents half of the direct foreign investments launched by Morocco, in the last few years.
In the early 2000’s, many Moroccan companies of the private sector started businesses in Africa in a wide range of sectors. For example, bank branches of BCP (Banque Centrale Populaire), BMCE Bank of Africa and Attijariwafa Bank have been opened in about fifteen African countries. More so, the insurance company Saham has also been planted in about twenty countries since the takeover of the Nigerian company Continental Reinsurance in 2015. In the telecommunications sector, Maroc Telecom increased its influence on the continent through the takeover of 6 African branches from their Emirati shareholder Etisalat.
Moreover, many holdings such as Ynna Holding and the National Investment Company through its mining branch Managem, have operations in the African continent. In the property business, the company named Alliances Développement Immobilier, has signed partnership agreements with the Cameroonian and Ivorian governments in order to build thousands of council housing. The company, Palmeraie Développement, has launched building projects in Gabon, Ivory coast and recently in Rwanda. Attracted by the important investments in infrastructure (highways, bridges, ports, council housings, universities, etc.), the Addoha group pitched its tent on the continent too via two of its companies: Addoha and CIMAF (Ciments de l’Afrique). They have been recently joined by LMHA (LafargeHolcim Maroc Afrique), a company held jointly by LafargeHolcim and the national investment company which is a Royal Holding.
So, the private sector plays a key role in the economic integration process of the continent. The mobilization of private investments is essential to economic integration as it helps to create jobs, improve productivity and increase exports. The economic integration between Morocco and other African countries put in place by the King Mohammed VI invites the companies of the Kingdom to share their expertise and to strengthen their partnership relations with the African countries.
The Moroccan private sector will now play an important role in skill transfer, while enhancing its production capacity. It will then improve its competitiveness on an international level. Concerning inter-regional trade, it will boost the commercial exchanges, which are still weak and reduce the structural deficit of the Moroccan trade balance. The economic potential is huge. The Economic Community Of West African States (ECOWAS) and The Economic Community of Central African States (ECCAS) have altogether more than 300 million consumers, that is to say a market which is nine times the size of the Moroccan population.
The Role of Economic-stimulus Groups in the Reinforcement of Economic bilateral relations
Whenever King Mohammed VI makes an official visit to a Sub-Saharan country, his country Morocco makes advantageous agreements that includes customs facilities and tax concessions. The aim is to promote commercial exchanges and to develop intra-African investments. Recently, economic relations between the Moroccan Kingdom and other African countries are ruled by a legal frame of more than 500 cooperative agreements. This is so important to the Moroccan Kingdom that the King Mohammed VI called a meeting of his government, during the first ambassador conference that took place in August 2013, to work with the different economic operators from the public and the private sectors in order to grab investment opportunities in countries having strong economic potentialities. Thus, the last trips of King Mohammed VI allowed mainly to create economic-stimulus groups on the between Morocco-Senegal and Ivory Coast. These groups, co-chaired by the foreign ministers and the presidents of employers of each country, aim to promote partnerships between the private sectors and to boost commercial trade and investments [1].
With a total population of 22 million inhabitants, Ivory Coast is the first economy in the West African Economic and Monetary Union (UEMOA) area and is also the second economic power in the ECOWAS area. Also, the investment options are numerous: industry, infrastructure, construction industry, mines, energy, and so on. Senegal is also not left behind. There are so many reasons that encourage investment in the country. These include political stability, economic opportunities and new infrastructures. A guarantee is also given to the Moroccan investors through notably mutual protection and promotion agreements of investments and non-dual taxation agreements. The Memorandum of Understanding concerning the creation of a joint venture between the Moroccan group, La Voie Express and the Senegalese company Tex Courrier signed on 9th November 2015 at the ceremony to present the work of the Moroccan-Senegalese EIG – chaired by King Mohammed VI and President Macky Sall, is a good example of the instrument's driving role in boosting private-private partnership[2].
Exchanges between the Moroccan kingdom and the African continent have increased clearly during the last decade. Between 2004 and 2014, global exchanges have quadrupled, going from 1 billion dollars to 4.4 billion dollars. The study '' Structure of trade between Morocco and Africa: An analysis of trade specialization '' produced by OCP Policy Center in July 2016 shows that West Africa remains the first destination of Moroccan exports[3]. This region has indeed welcomed around 50.08% of exportations in 2014, the equivalent of 1.04 billion dollars[4]. However, an analysis of the export structure reveals that Moroccan exports to the other African countries are dominated by intensive goods in raw materials and natural resources[5]. A strong potential is to be developed to boost more Moroccan exports. The Directorate of Studies and Financial Forecasts (DEPF), attached to the Moroccan Ministry of Economy and Finance, stressed in its study "Morocco-Africa Relations: the ambition of a new border" that "Moroccan companies targeting the African market should focus on a penetration strategy based on cost considerations from targeted sectorial choices, in the light of the current and, above all, future needs of African populations. Demographic growth, the rise of the middle class and the rampant urbanization of the continent are all factors to be taken into consideration, in order to anticipate the rising configuration of these emerging economies ".
In this sense, Moroccan exporter companies had better anticipate the dynamics of economic, social and cultural transformations that are on the horizon in Sub-Saharan Africa by setting up adaptation strategies in order to capture a higher market share and catch up their delay in this fast-growing region.
Economic Action at the Heart of Morocco's Integration Strategy in Africa
Economic integration is important for both Morocco and the African continent. The recent trips of King Mohammed VI to Rwanda, Tanzania, Senegal, Ethiopia, Madagascar and Nigeria is designed to reinforce this notion. The Eastern part of Africa is the fastest growing region in Africa. Added to that, its economic potential is still unexploited. If Morocco wants to reinforce its influence on the African continent, a number of options have to be investigated. First, the internationalization of Moroccan companies and their investment in African countries have to be encouraged by putting at their disposal a real database on the specificities and the potential of each economy. Second, export flows to African countries have to be fostered. Both public and private actors are involved in the promotion of Moroccan products. The new Moroccan agency for the development of Investment and Export, as well as the ASMEX (Moroccan Association of Exporters), will have to conduct trade missions to various African deposits and offer national companies the necessary support to develop their exports and / or carry out their development project in the continent. Finally, strengthening trade integration with the various African countries is important. The consumer market is growing with the emergence of a middle class more interested in manufactured goods with a high added value. The negotiation of advanced partnerships with ECOWAS and CEMAC, including the creation of free trade areas, is in turn an ideal gateway to this large market of more than 300 million people.
In the era of globalization and fierce international competition, the growing interest of emerging countries towards the African continent is marked by rivalries: China, India, France, Japan or Germany have all unveiled their African ambitions. Facing this international context, Moroccan diplomacy is more ambitious and aggressive. King Mohammed VI declared at the opening of the Moroccan-Ivorian Forum the 24th of February 2014: "Diplomatic relations are at the heart of our interactions. But, thanks to the profound changes that the world is undergoing, their mechanisms, their scope and even their place in the architecture of international relations are forced to adapt to new realities.”
In the wake of this , Morocco would win by organizing a Moroccan-African business summit. The latter would be a continuation of the Africa Action Summit and would focus on the economic development potential of the continent. The Summit would bring together governments, businesses, the public and private sectors, around the economic, social and human development of Africa. The challenge is to reaffirm the strategy of influence of Morocco on the continent.
Translated by:
Pape Djibril Diagne
[1] Economic impetus groups include 10 sectors identified as priorities: banking-finance-insurance, agri-business-fisheries, property-infrastructure, tourism, renewable energy-energy, transport- Logistics, industry-distribution, digital economy, social and solidarity-craft economy, human capital-training and entrepreneurship
[2] Christophe Sidiguitiebe, Four new agreements signed between Morocco and Senegal, Telquel.ma, 10.11.2016: www.telquel.ma/2016/11/10/quatre-nouveaux-accords-signes-maroc-senegal_1523082
[3] Four of Africa's top five trading partners (Algeria, Mauritania, Senegal, Côte d'Ivoire and Nigeria) are part of West Africa.
[4] With regard to imports, the weight of North Africa accounted for nearly all Moroccan imports, with a share of 82% in 2014 compared with 53% in 2004, mainly by importing natural gas, manufactured gas, petroleum and related products.
[5] Moroccan exports consist mainly of food and living animals (25%), machinery and transport equipment (18.5%), chemicals and related products (18.1%), manufactured goods 15.9%) and mineral fuels, lubricants and related products (11.7%).
L’économie de la connaissance en Afrique: quel cadre théorique et quelles évolutions ?
 En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.
En 2000, le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, avec la Déclaration de Lisbonne, proclame sa volonté de « faire de l’UE, l’économie de la connaissance, la plus compétitive et la plus dynamique du monde », montrant ainsi l’importance donnée par les pays occidentaux à cette économie. En effet, à notre époque, caractérisée par les technologies et la diffusion de l’information qu’elles permettent, ainsi que par l’importance des services dans les économies, le capital immatériel apparaît comme un élément incontournable de la croissance économique.
Ce nouveau paradigme de l’économie de la connaissance s’accompagne inévitablement de son adoption par les institutions internationales, qui considèrent que l’économie de la connaissance serait un moyen pour les pays en développement de rattraper leur retard économique.
Cet article vise à donner une compréhension de base de l’économie de la connaissance, sans chercher à discuter de la pertinence des définitions ou des indicateurs. Il définira l’économie de la connaissance dans une première partie, avant d’identifier les indicateurs traditionnellement utilisés pour la mesurer. Il conclura en donnant un aperçu de l’économie de la connaissance en Afrique.
I – Economie de la connaissance ou économie de l’information ?
Alors que les 19ème et 20ème siècles se sont caractérisés par la révolution industrielle et la production de biens physiques en découlant, notre époque valorise de plus en plus une production immatérielle de connaissance, d’information, de savoir. Les progrès scientifiques et les innovations qui en ont découlé, qu’elles soient sociétales ou technologiques, ont entrainé des mutations profondes de nos sociétés. Cependant, il est difficile de décorréler l’importance croissante de la connaissance, de technologies comme Internet ou la téléphonie portable. Celles-ci y contribuent directement, puisqu’elles permettent une diffusion plus rapide et plus large des informations et des savoirs, réduisent les distances et permettent aux entreprises d’augmenter leur productivité. L’économie de la connaissance, la technologie et l’innovation sont donc intimement liées : les technologies et leurs usages, issus de l’économie de la connaissance, font naitre des innovations techniques et sociétales, comme les paiements sans contacts ou les bots, qui entrainent des nouveaux modes de consommation. Mais ces innovations contribuent elles-mêmes à l’économie de la connaissance – en favorisant la dématérialisation de certaines activités, avec l’exemple traditionnel des paiements mobiles qui permettent aux usagers d’éviter de se déplacer en agence. Enfin, la diffusion de la connaissance contribue au développement de nouvelles technologies, les savoirs étant plus rapidement exploités.
Ainsi, l’économie de la connaissance se définit en général comme une économie dans laquelle le poids du capital intangible est important ; ce capital étant en général compris comme la connaissance et la part importante des technologies.
Le terme d’économie de l’information est parfois utilisé de manière interchangeable avec celui d’économie de la connaissance. Pourtant, les économistes soulignent des divergences entre les deux notions. L’information représente uniquement les données et faits purs, et leur accumulation ; tandis que la connaissance est le phénomène qui permet justement de lier ces données, de les interpréter et de les analyser. Alors que l’information ne peut jamais être plus qu’une donnée ou un fait, la connaissance relève d’une capacité cognitive, qui permet à l’individu d’interpréter les faits, plus difficile à mesurer.
Ainsi, on peut considérer que l’économie de l’information s’intéresse surtout à la diffusion de l’information, notamment par les TICs, alors que celle de la connaissance s’intéresse davantage à la gestion de cette information par les sociétés.
Cette distinction entre information et connaissance est intéressante à souligner dans le cas des pays en développement, où le manque de statistiques fiables limite la compréhension de certains phénomènes – du moins pour des observateurs extérieurs. Le fait que de nombreuses langues locales ne soient pas formalisées à l’écrit démontre par exemple un manque d’informations sur les langues, alors qu’il existe une connaissance tacite des langues, maitrisées par les populations. L’importance du secteur informel dans les pays africains montre également que les travailleurs informels, qu’ils soient réparateurs ou cuisiniers, possèdent un réel savoir-faire, même s’il n’est pas basé sur une formation théorique, ni reconnu officiellement dans les statistiques.
II – La connaissance – un bien immatériel difficile à mesurer
- Indicateurs généraux
La mesure de l’économie de la connaissance s’appuie en général sur une volonté de mesurer les efforts faits en recherche et développement, puisque cette dernière activité est productrice de connaissances. Cependant, la mesure porte plutôt sur les dépenses en développement de la connaissance, que sur la connaissance elle-même.
Les indicateurs utilisés sont donc :
- La R&D en pourcentage du PIB, qui peut être mesurée par les dépenses engagées par les entreprises dans le domaine de la R&D (en pourcentage des investissements de leur entreprise, ou en pourcentage de la valeur de la production) et le personnel en R&D ;
- Le nombre de brevets déposés (en général, par pays) ;
- Le nombre d’articles parus dans des journaux scientifiques.
La mesure porte également sur des indicateurs de base comme l’éducation et la formation :
- Taux d’alphabétisation ;
- Pourcentage de la population qui a atteint un certain niveau d’éducation – cela peut être le brevet, le bac, ou d’autres diplômes, ou encore le nombre d’inscrits dans l’enseignement secondaire ou supérieur.
- Cadre d’analyse de la Banque Mondiale
Un indicateur particulièrement intéressant pour les pays en développement est le Knowledge Economy Index (KEI – Indice de l’Economie de la connaissance) mis en place par la Banque Mondiale[1]. Le KEI doit permettre d’évaluer dans quelle mesure les Etats sont disposent d’une « économie de la connaissance », en fonction de leurs résultats dans chacun des quatre piliers identifiés :
|
PILIER 1 Système économique et institutionnel |
PILIER 2 Education et ressources humaines |
PILIER 3 Infrastructures d’information et de communication |
PILIER 4 Système d’innovation
|
|
Barrières tarifaires et non tarifaires
Qualité de la régulation
Etat de droit |
Taux d’alphabétisme des adultes
Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire
Taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur |
Nombre de téléphones pour 1000 habitants
Nombre d’ordinateurs pour 1000 habitants
Utilisateurs d’internet pour 1000 habitants |
Paiements de redevances, $US par personne
Nombre d’articles de journaux scientifiques par million de personnes
Brevets accordés à des nationaux par le US Patent and Trademark Office par million de personnes |
Pour un concept aussi vaste que l’économie de la connaissance, il peut difficilement exister un consensus sur la définition et la mesure exactes d’une telle économie. Cependant, on remarque une concordance sur l’importance de l’éducation, et celui de la recherche scientifique.
III – Etat des lieux en Afrique
Utiliser les indicateurs présentés précédemment peut permettre de situer les pays dans un classement d’économie de la connaissance. Cependant, dans le cas des pays en développement, et notamment ceux d’Afrique, le manque de données représente encore une fois un obstacle à une vue d’ensemble claire.
- Indicateurs généraux
Concernant les dépenses en R&D, elles représentaient 0,5% du PIB en Afrique en 2007 (dernières données accessibles), bien en dessous de la moyenne mondiale d’1,9%, mais aussi de la moyenne des pays sud asiatiques (0,7%), d’Asie de l’Est (2,4%), et d’Amérique Latine et des Caraibes (0,7%). En comparaison, les dépenses en R&D représentaient 2,5% du PIB en Amérique du Nord et 1,7% au sein de l’Union Européenne[2].
Difficile également de trouver un chiffre sur le nombre de brevets déposés en Afrique. La Banque Mondiale ne dispose de statistiques, en Afrique, que sur l’Afrique du Sud, et sur certaines années, du Nigeria, du Kenya, du Rwanda et de Madagascar. Cependant, d’après l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, l’Afrique fait également figure de parent pauvre : sur 2,6 millions de brevets déposés en 2014, seuls 0,6% venaient d’Afrique subsaharienne [3].
En matière d’articles scientifiques, on constate une croissance constante de leur publication dans toutes les régions depuis les années 1980, avec un pallier important pour toutes les régions en 2000. En 2013, l’Asie de l’Est et Pacifique affiche une parution de plus de 699 000 articles, l’UE 605 000 et l’Amérique du Nord 470 000.
Loin derrière, l’Asie du Sud a publié 100 000 d’articles en 2013, l’Amérique Latine 85 000, l’Afrique du Nord et Moyen Orient 60 000 et l’Afrique subsaharienne…20 000. Bien entendu, ces chiffres en valeur absolue ne permettent pas une comparaison proportionnelle en fonction de la population par région, mais ils permettent de voir quelles régions se démarquent des autres en publication scientifique[4].
Au niveau de l’éducation, l’Afrique souffre également de son taux d’alphabétisation des adultes (plus de 15 ans) qui est de 60% en 2010, contre 80% dans le monde, ou, pour le comparer à des régions similaires en termes de développement, 66% en Asie du Sud, 80% en Afrique du Nord et Moyen Orient, 92% en Amérique Latine, et 95% en Asie de l’Est et Pacifique.
Enfin, en terme de formation, la Banque Mondiale fournit des données sur le pourcentage de la population inscrite dans l’enseignement supérieur : il est de 34% au niveau mondial en 2014, contre seulement 8,5% en Afrique subsaharienne, alors qu’il est de 20% pour l’Asie du Sud, 39% pour l’Asie de l’Est et du Pacifique et 44% pour l’Amérique Latine.
- Cadre analytique de la Banque Mondiale
Peu de travaux ont été publiés dans les dernières années, y compris par la Banque Mondiale, sur le KEI, et sa mise à jour. Néanmoins, il est aisé de regrouper d’autres indicateurs pour essayer d’utiliser la logique des quatre piliers (Système économique et institutionnel ; éducation et formation ; TIC ; Innovation) et évaluer où se situe l’Afrique subsaharienne dans l’économie de la connaissance.
Ainsi, les indices tels que le Global Competitiveness Index ou Doing Business permettent de situer les économies dans le domaine du pilier 1. Il existe suffisamment d’articles traitant de ces indicateurs pour ne pas revenir dessus longuement : l’Afrique reste un continent avec des taux de croissance intéressants, bien que fortement ralentis dans les dernières années par la crise des matières premières, avec des environnements des affaires inégaux, souffrant de faiblesses mais sur lesquels des efforts sont faits. Néanmoins, les économies africaines souffrent de faiblesses liées au manque d’infrastructures, d’un déficit de systèmes éducatif et de santé fiables, qui peuvent compromettre une croissance inclusive sur le long terme.
Source : Global Competitiveness Report 2015 – 2016
Dans la précédente partie, nous avons déjà vu les chiffres liés aux piliers 2 et 4.
Pour étudier le 3ème pilier, lié aux TICs, plusieurs organismes ont récemment développé des indicateurs pour évaluer la maturité numérique ou technologique des économies. Néanmoins, l’on s’appuiera sur les données de la Banque mondiale pour étudier les 3 indicateurs restants, qui concernent ce domaine.
Le taux d’équipement en téléphone, tout d’abord portables, était de 98% de la population mondiale en 2015, 75% en Afrique subsaharienne, 78% en Asie du Sud, 104% en Asie de l’Est et Pacifique et 112% en Afrique du Nord. Le chiffre pour l’Afrique cache néanmoins des disparités car de nombreux pays africains ont un taux plus élevé, souvent supérieur à 100%.
Les lignes téléphoniques fixes, elles, équipent 14% de la population mondiale ; l’Afrique et l’Asie du Sud se situent bien en dessous, avec des taux d’équipement de respectivement 1% et 1,9%, contre 15% pour l’Afrique du Nord et Moyen Orient, et 15,8% pour l’Asie de l’Est et du Pacifique. Ce taux est de 37% pour les Etats Unis et 41% pour l’Union européenne.
Concernant les ordinateurs, ils équiperaient 51,4% de la population mondiale, mais seulement 10,8% de la population africaine en 2016 ; bien en dessous du taux d’équipements de l’Asie du Sud Est et Pacifique (38,1%), des Etats arabes (44,6%), de l’Europe Centrale (67%), de l’Amérique (67,6%) ou de l’UE (80%)[5].
Enfin, alors que 43% de la population mondiale utilise Internet en 2015, ce taux serait de 22% pour l’Afrique subsaharienne, légèrement en dessous de l’Asie du Sud (24%) mais bien en dessous de l’Afrique du Nord et Moyen Orient (43%), de l’Asie de l’Est et du Pacifique (50%), de l’Amérique Latine et Caraïbes (53%). L’Amérique du Nord et l’UE sont respectivement à 75 et 79%.
Conclusion
Cet article avait pour but de poser les bases théoriques permettant de comprendre ce qu’est l’économie de la connaissance, et de l’illustrer avec des statistiques dans les différents indicateurs identifiés.
Une question qui se pose régulièrement est notamment celle de savoir si cette économie de la connaissance peut réellement contribuer au développement de l’Afrique, et comment. Pour y répondre, il sera intéressant de regarder quels acteurs interviennent dans le processus de création de la connaissance, et quel rôle ils peuvent y jouer, que ce soit les gouvernements à travers les politiques publiques, ou le secteur privé, par exemple à travers les transferts de connaissance.
Marie Caplain
Sources
Mickael Clévenot, David Douyère. Pour une critique de l’économie de la connaissance comme vecteur du développement : Interaction entre les institutions, la connaissance et
les IDE dans le développement. Colloque international ” Economie de la connaissance et développement ” XXIVe Journées du développement de l’Association Tiers-Monde, Organisé par l’Université Gaston Berger (Sénégal), le Bureau d’économie théorique et appliquée de l’Université Nancy2/CNRS., May 2008, Saint Louis, Sénégal.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00323335/document
Données ouvertes de la Banque Mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/
Global Competitiveness Report 2015-2016 http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
Union Internationale des Telecommunications (données 2005-2016).
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
World Bank Institute, Measuring Knowledge in the World Economy.
http://www.oneworldarchives.org/kambooklet.pdf
World Intellectual Property Indicators 2015
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf
Vicente Jerome, Cours d’Economie de la connaissance.
fgimello.free.fr/documents/economie_connaissance.pdf
[2] Toutes les statistiques (sauf indication contraire) sont issues des données de la Banque Mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/. Pour utiliser cet outil, simplement taper dans la barre de recherche l’indicateur désiré (ex : taux d’alphabétisation) et le pays ou la région désirée (Afrique subsaharienne, Nigeria, etc). Attention, les indicateurs ne sont pas forcément disponibles pour tous les pays.
La « formalisation » de l’économie informelle est-elle la clé du développement et de la lutte contre la pauvreté en Afrique ?
 Certains l’appellent l’économie non-contrôlée ou l’économie de la débrouillardise, d’autres, l’économie souterraine ou l’économie populaire. Dans tous les cas, l’activité informelle occupe une place prépondérante dans l’économie des Pays les Moins Avancés (PMA) notamment ceux d’Afrique subsaharienne où les activités non-déclarées concernent en moyenne de 70% de la population active (1). L’économie informelle est d’autant plus difficilement identifiable et mesurable, qu’elle est écartée des comptabilités publiques et échappe à toute politique fiscale. Les Etats sont en carence de stratégies adaptées pour valoriser les produits de l’économie informelle et ramener le volume des activités qu’elle recouvre dans le système formel.
Certains l’appellent l’économie non-contrôlée ou l’économie de la débrouillardise, d’autres, l’économie souterraine ou l’économie populaire. Dans tous les cas, l’activité informelle occupe une place prépondérante dans l’économie des Pays les Moins Avancés (PMA) notamment ceux d’Afrique subsaharienne où les activités non-déclarées concernent en moyenne de 70% de la population active (1). L’économie informelle est d’autant plus difficilement identifiable et mesurable, qu’elle est écartée des comptabilités publiques et échappe à toute politique fiscale. Les Etats sont en carence de stratégies adaptées pour valoriser les produits de l’économie informelle et ramener le volume des activités qu’elle recouvre dans le système formel.
L’économie informelle existait bien avant les indépendances des pays africains dans les années 1960 (2). Après cette période, elle s’est accentuée dans le contexte des « trente glorieuses » dont les effets ont été ressentis jusqu’en Afrique, notamment à travers l’afflux d’investissements directs étrangers (IDE) en provenance des pays occidentaux vers le continent. Les pays comme l’Afrique du Sud, le Kenya ou encore la Côte d’ivoire ont su en profiter pendant un certain temps. Au début des années 1980 pourtant, l’économie informelle en Afrique a pris une nouvelle dimension après la mise en oeuvre des politiques d'ajustement structurel (PAS), qui ont généré des effets dévastateurs (réduction des salaires, diminution des effectifs de la Fonction publique, privatisation des entreprises d’État…). La dévaluation du Franc CFA en 1994 induisant des effets néfastes sur la structure économique, a contribué au ralentissement de la croissance, à la hausse du chômage et à la fragilisation des Etats. Tous ces facteurs ont eu pour résultante l’accroissement du nombre d'agents exerçant dans l’économie informelle.
I. Les contours flous de l’économie informelle
La notion d’informel est une notion à géométrie variable, elle est polysémique et a été utilisée pour désigner des activités à la fois diverses et complexes. Ainsi plusieurs définitions coexistent.
– La première est sectorielle et résulte de travaux élaborés par le Bureau International du Travail (BIT) en 1972 à travers « le rapport Kenya ». Ce dernier désigne le secteur informel comme un ensemble de petites entreprises dotées d'une échelle restreinte, d'activités essentiellement familiales et d'une faible intensité capitalistique.
– Le deuxième type de définition s’est polarisé sur la pauvreté et la marginalité, c’est-à-dire sur les conséquences de la participation des agents au marché du travail secondaire (3). De surcroît, cette définition prend en compte les unités de production et les micro-entreprises qui ne transgressent pas délibérément la réglementation pour exister contrairement aux activités dites illégales telles que la contrebande, le trafic de drogue, que nous retrouvons également dans nos sociétés. Dans tous les cas, ces définitions convergent inéluctablement vers une série de questions : Quelle est la structure de l’économie informelle en Afrique ? Quelles catégories de population sont concernées ? L’Afrique peut-elle se développer sans l’économie informelle ? Au final, l’économie informelle peut-elle être une porte de sortie pour l’Afrique ?
II. Structure et morphologie des populations les plus concernées par l’économie informelle.
La structure de l’économie informelle en Afrique regroupe essentiellement les activités liées à l’artisanat, au petit commerce, aux petites et moyennes entreprises non formellement identifiées par l'Etat. Par exemple, dès 2006 l’Agence Française pour le Développement soulignait dans un rapport qu’au Cameroun, l’économie informelle compte près de 90 % de la population active, alors qu’on estime qu’elle constitue près de 30% du PIB. Au Sénégal, elle est également le poumon de l’économie. Elle représente ainsi 60% du produit intérieur brut du pays et 60% de la population active est concernée. Au Mali, les dernières études publiées par l’Institut National de la Statistique (INSTAT) montrent que l’économie informelle touche 70% de la population active et qu’elle contribue à près de 55% du PIB (6). Il s’ensuit que ces tendances sont similaires dans la majorité des pays africains. Ainsi, si la structure de l’économie informelle varie d’un pays à l’autre, son importance dans la création de la richesse nationale est partout significative. Par ailleurs, l’économie informelle est également marquée par une grande hétérogénéité des populations concernées. Il existe deux catégories de population dans l’économie informelle en Afrique : celle qui en tire des revenus de subsistance et celle qui mène simultanément une ou plusieurs activités génératrices de revenus (AGR) formelles ou informelles. La première catégorie vit quasi-exclusivement de l’économie informelle tandis que la seconde effectue sporadiquement des activités informelles en s’affranchissant de l’impôt.
III. Recommandations
Bien que l’économie informelle présente à la fois des caractéristiques hétérogènes et complexes, elle pourrait faire l’objet d’une politique coordonnée à l’échelle régionale et constituer la porte de sortie pour l’atteinte de l’émergence des pays Africains d’ici à l’horizon 2035 (objectif fixé par l’Union Africaine). En effet, le but d’une telle politique ne viserait pas à traquer et appauvrir les agents tirant leurs revenus de subsistance du secteur informel mais à renforcer le cadre réglementaire des activités économiques et à étendre la protection sociale à tous les travailleurs. En outre, il est important de souligner que la deuxième partie de la population concernée par l’économie informelle regroupe majoritairement des petites entreprises à taille humaine avec une croissance d’activité régulière dont l’identification et l’assujettissement à l’impôt permettrait d’assurer la stabilité des finances publiques. L’exemple du Maroc en 2014 avec le statut de l’auto-entrepreneuriat élaboré par le Haut Commissariat au Plan (HCP) propose des mesures d’incitations fiscales pour faciliter l’intégration de la deuxième catégorie de population. En revanche, le statut ne propose pas de mesures en faveur d'une large couverture sociale des personnes exerçant dans l’économie informelle. De plus, l’économie marocaine est face à un paradoxe depuis quelques années ; c’est-à-dire que la croissance économique est de plus en plus soutenue, conduisant à la baisse du poids de l’ économie informelle dans le PIB tandis que dans le même temps l’emploi informel progresse. L’économie informelle devient ainsi peu à peu une zone grise qui ne manque pas d’interagir avec l’économie marocaine traditionnelle. En effet, il est important de mentionner qu’il existe une forte interaction entre le formel et l’informel, ne serait-ce que par la monnaie commune. Si le premier accuse le second de concurrence déloyale, le second quant à lui, accuse le premier d’une carence de considération. Seul une politique volontariste mettant en place des incitations fiscales et une flexibilisation du cadre juridique de la création d’entreprise permettra d’unifier les deux pans de l’économie.
En somme, il est impératif pour les Pays les Moins Avancés d’Afrique, de mettre en place des reformes à l’égard de l’économie informelle. Cela sera possible si les Etats jouent pleinement leur rôle, c’est-à-dire la création d’ un environnement propice à une meilleure condition de vie des citoyens et à un climat des affaires plus certain. L’économie informelle est essentiellement une question de gouvernance. Toutefois, il arrive souvent que les quelques micro-entreprises tenant des unités de production non déclarées et non réglementées ne s’acquittent ni de leurs obligations fiscales, ni de leurs obligations sociales vis-à-vis des travailleurs, faisant ainsi une sorte de concurrence déloyale aux autres entreprises. Celles-ci doivent être ciblées sans caractère punitif tout en étant mises à contribution. Dans ce cas, l’Etat qui voit déjà lui échapper des ressources fiscales qui devraient provenir de l’économie informelle, verra sa capacité de financement augmenter pour faire face aux services sociaux. Outre la couverture sociale au sens traditionnel, les agents exerçant dans l’économie informelle sont dépourvus de toute protection dans des secteurs tels que la formation, l’éducation, l’apprentissage, les soins sanitaires et plus particulièrement ceux liés à la petite enfance. En tenant compte de ces reformes, l’Afrique observera simultanément l’accélération de son développement économique et la baisse de la pauvreté.
Amadou SY
Sources
(1) https://www.oecd.org/fr/csao/publications/42358563.pdf
(2) https://www.monde-diplomatique.fr/mav/143/CESSOU/53893
(3) http://www.persee.fr/doc/ecop_0249-4744_1990_num_92_1_5155
(4) Rapport de l’Agence Française de Développement publié en 2006.
Réformer les indicateurs économiques : et si le sursaut venait d’Afrique ?
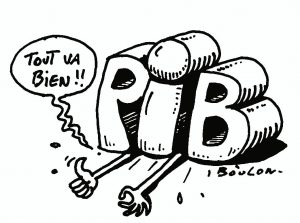 Alors que le débat autour de la redéfinition des indicateurs économiques se cristallise dans les sociétés occidentales, c’est d’Afrique que pourraient provenir des réformes audacieuses.
Alors que le débat autour de la redéfinition des indicateurs économiques se cristallise dans les sociétés occidentales, c’est d’Afrique que pourraient provenir des réformes audacieuses.
Dotés d’une croissance économique dynamique mais confrontés à des défis sociaux et environnementaux majeurs, certains pays du continent bénéficieraient d’ajustements de leurs indicateurs. Une meilleure gestion de ces défis nécessite en effet la création d’indicateurs pertinents et aptes à contrôler les évolutions (positives et négatives) dans ces domaines.
Au-delà d’une simple remise en question du PIB, c’est également l’opportunité d’une rupture idéologique inédite dans l’histoire économique et des relations internationales.
Un débat historique mais en suspens dans les économies occidentales
La limite de la croissance du PIB comme indicateur central dans notre appréhension et notre gestion des défis actuels est la question fondamentale. Historique, comptable et essentiellement quantitatif, il est en effet considéré comme caduc et inapte à mettre en lumière les problèmes sociaux et environnementaux contemporains. Reportant uniquement l’accroissement de la production, il ne révèle rien sur les évolutions sociales et environnementales de nos sociétés.
Depuis 1972, et le rapport « Limits to Growth » du Club de Rome, différentes contributions questionnent la « pertinence de ces données en tant qu’outils de mesure du bien-être sociétal » (Rapport « Stiglitz », 2008). Toutefois, jamais la mise en place d’indicateurs performatifs complémentaires au PIB ne s’est concrétisée.
Ces critiques militent pour l’ajout d’indicateurs propres aux questions sociales et à la préservation de l’environnement. On peut notamment évoquer les inégalités de revenus, la proportion d’individus vivant sous le seuil de pauvreté, l’accès à l’éducation, la pollution atmosphérique, la gestion des ressources en eaux, la dégradation des sols, etc. Il reste néanmoins important de noter que ces indicateurs ne doivent pas être substituables, c’est-à-dire que de bonnes performances dans un domaine ne doivent pas masquer de piètres résultats dans un autre. Ceux-ci permettraient de sortir d’une vision uniquement quantitative et d’orienter nos activités vers l’amélioration des conditions de vie des populations et la durabilité de nos écosystèmes.
Néanmoins, ces volontés d’ajustements se heurtent à de nombreux refus dans les sociétés occidentales. Tous se fondent en partie sur l’atonie actuelle de la croissance : en cette époque de croissance faible, la priorité serait son rétablissement, pas sa remise en question en tant qu’indicateur phare. Il leur semble déplacé de vouloir discréditer cet indicateur au moment précis où il vacille. C’est donc parce que ces sociétés cherchent aujourd’hui à renouer avec la croissance que les aspirations à revoir le modèle d’analyse sont écartées.
Une chance en Afrique subsaharienne ?
Il est donc approprié de se tourner vers des pays jouissant d’une croissance dynamique pour impulser cette initiative, notamment en Afrique de l’ouest francophone.
Le Sénégal ou la Côte d’Ivoire bénéficient, par exemple, de performances économiques saluées par des observateurs reconnus, comme la Banque Mondiale ou le cabinet McKinsey. Ils bénéficient d’une croissance stable, autour de 5% par an[1], depuis plusieurs années et les perspectives sont encourageantes.
Au-delà de leur croissance économique, c’est sa relative qualité qui en fait des candidats opportuns : ces économies sont relativement diversifiées, ne dépendent pas des exportations d’hydrocarbures et ont des marchés intérieurs dynamiques. Difficile donc d’objecter les mêmes critiques qu’en occident. Ces performances offrent également un certain prestige régional qui peut servir de catalyseur et, à terme, entrainer certains pays voisins, comme le Bénin ou le Togo, plus modestes et plus discrets sur la scène régionale.
Une réforme urgente au vu de la situation
Même si la croissance offre ici un avantage indéniable à ces économies, c’est surtout l’ampleur des défis à relever dans la région qui rend cette réforme urgente. Ces pays sont en effet les premiers concernés par les conséquences sociales et environnementales d’une croissance non-inclusive et d’une dégradation rapide de l’environnement.
La situation des littoraux d’Afrique de l’ouest[2] illustre cette urgence. Les industries minières et l’exploitation du sable accélèrent l’érosion du littoral, où vit plus du tiers de la population, et menace les écosystèmes naturels et les sociétés. Les destructions d’emplois issues de ces changements accentuent la précarité et la marginalisation socio-économique, en particulier des jeunes, ce qui amplifie la violence et les trafics. Il semble donc nécessaire de contrebalancer l’hégémonie de la croissance sur les décisions économiques et politiques par l’intégration d’indicateurs qualitatifs.
Outre cet exemple, c’est une prise de conscience plus large du danger inhérent aux facteurs quantitatifs qui est crucial. C’est le cas de la démographie et de l’urbanisation, qui sont encore trop souvent considérés comme des opportunités de fait et proclamés comme les principaux atouts du continent. En réalité, ces dynamiques quantitatives restent fondamentalement des défis à la stabilité de la zone.
L’évocation constante du « dividende démographique » illustre cette confusion entre quantitatif et qualitatif. La population de l’Afrique subsaharienne atteindra en effet plus de 2 milliards d’individus d’ici 2050 (environ 1.2 actuellement)[3] et sa main d’œuvre sera la plus abondante au monde, devant la Chine ou l’Inde. Ce « dividende » sous-entend que l’explosion démographique aurait naturellement un effet positif sur le développement général.
Néanmoins, ce lien est loin d’être évident. Comme le suggère la notion d’explosion, cette dynamique quantitative reste imprégnée du risque inhérent à l’accroissement rapide d’une population. Le dividende ne s’opère que si les services de base (logement, éducation, emploi, santé) sont fournis à l’intégralité des populations et si les jeunes intègrent le marché du travail sereinement. Marché sur lequel doivent se combiner formations adéquates et accessibles avec une offre suffisante d’emplois correspondants. Plus généralement, le dividende démographique est une conséquence d’une croissance inclusive et équitablement répartie à l’ensemble de la population et non un phénomène quantitatif, spontané et naturel.
Dans son dernier rapport[4], le cabinet McKinsey réalise également un raccourci optimiste sur les bénéfices de l’urbanisation rapide du continent. Vantant ses mérites, il passe brièvement sur les besoins qu’elle implique, concluant sur la nécessaire provision de « logements » et de « services ». Il aurait fallu être cynique pour évacuer le besoin de logements pour les nouveaux urbains, mais les auteurs n’ont pas approfondi la notion de « services », euphémisme osé qui englobe les minima requis pour des millions de citadins supplémentaires et sans lesquelles les bidonvilles grossiront.
A l’heure des plans ambitieux (notamment le Plan Sénégal Émergent[5]), ces réflexions sur les indicateurs ne sont donc pas de simples challenges intellectuels mais apportent des ajustements décisifs. Dépasser les paramètres quantitatifs (production, démographie, urbanisation) et superviser les évolutions sociales et environnementales est déterminant pour soutenir des trajectoires prometteuses mais encore fragiles.
Au-delà de la réforme technique : une révolution idéologique
Ce changement de paradigme implique également un recul idéologique vis-à-vis des politiques économiques traditionnelles en faveur d’un modèle endogène de croissance et de développement. Passée la période des plans d’ajustements structurels (caractérisée par le recul de la puissance publique et la rigueur budgétaire), les gouvernements régionaux suivent néanmoins encore les dogmes libéraux traditionnels dans leurs politiques. La suprématie de la croissance du PIB reste donc incontestable et favoriser des indicateurs complémentaires, malvenu. Les performances du PIB sont notamment un sésame précieux pour obtenir le soutien des bailleurs internationaux et elles focalisent donc l’attention de gouvernements.
Cette innovation impliquerait donc de s’émanciper de ces institutions en favorisant l’intégration régionale. L’UEMOA offre un cadre intéressant de discussion mais ne possède pas de capacités financières, contrairement à la Banque Africaine de Développement. Celle-ci dépend néanmoins à plus de 70% de l’étranger et nécessite donc des réformes profondes pour devenir une réelle force de proposition. Quoiqu’il en soit, financer son propre mode de développement semble décisif pour dépasser la simple déclaration de principe et promouvoir un modèle inédit.
Cette innovation incite donc à penser le développement hors des cadres hérités et calqués systématiquement. Elle implique de prendre du recul sur la notion de « rattrapage », de s’émanciper de la référence occidentale comme universelle et indépassable. Elle invite au contraire à tirer les conclusions des crises multiples qui la traversent pour éviter de tomber dans les mêmes écueils. En un mot, il est important de cesser de faire « du passé des autres notre avenir » pour reprendre la formule lapidaire du sociologue et écrivain togolais Sami Tchak (cité par Felwine Sarr dans « Afrotopia »).
Bien entendu, cela laisse planer de nombreuses questions et inconnues, notamment autour du choix de ces nouveaux indicateurs. Néanmoins, il semblerait que ce soit à l’Afrique de prendre ce débat en main, il en va de sa stabilité.
Gilles Lecerf
[1] Banque Africaine de Développement, « African Economic Outlook » 2016
[2] http://foreignpolicy.com/2016/10/21/west-africa-is-being-swallowed-by-the-sea-climate-change-ghana-benin/
[3] Projection des Nations Unies – World Population Prospects 2015
[4] McKinsey&Company – Global Institute – « Lions on the Move II. Realizing the Potential of Africa’Economies » – September 2016
[5] Cadre de référence pour les politiques sénégalaises. Plans quadri-annuels sur les périodes 2014-2035 – http://www.presidence.sn/pse
Le capital-investissement acclimaté à l’Afrique: un modèle en construction
 Malgré les taux de croissance élevés de la dernière décennie, le volume des investissements en Afrique est resté modeste comparé aux autres régions du monde. Le continent ne représente que 6.5% des transactions du capital-investissement sur les marchés émergents contre 78% pour les pays émergents d’Asie (1). Une situation qui résulte de la stratégie des sociétés de capital-investissement ; ces dernières investissent principalement dans les entreprises à forte capitalisation. Les grandes entreprises des secteurs du pétrole, des mines, de la banque, des télécommunications sont privilégiées au détriment des PME, certes peu structurées, mais représentant l’essentiel du tissu économique des pays. La moyenne des tickets d’investissement est d’environ 10 millions de dollars -hors Afrique du Nord- (2) ; des montants que très peu de sociétés ont la capacité d’absorber. Il se pose ainsi la nécessité de repenser le modèle actuel du capital-investissement dans un contexte où, les performances des entreprises des marchés cibles sont affectées par la baisse des cours des matières premières, réduisant davantage les opportunités d’investissement.
Malgré les taux de croissance élevés de la dernière décennie, le volume des investissements en Afrique est resté modeste comparé aux autres régions du monde. Le continent ne représente que 6.5% des transactions du capital-investissement sur les marchés émergents contre 78% pour les pays émergents d’Asie (1). Une situation qui résulte de la stratégie des sociétés de capital-investissement ; ces dernières investissent principalement dans les entreprises à forte capitalisation. Les grandes entreprises des secteurs du pétrole, des mines, de la banque, des télécommunications sont privilégiées au détriment des PME, certes peu structurées, mais représentant l’essentiel du tissu économique des pays. La moyenne des tickets d’investissement est d’environ 10 millions de dollars -hors Afrique du Nord- (2) ; des montants que très peu de sociétés ont la capacité d’absorber. Il se pose ainsi la nécessité de repenser le modèle actuel du capital-investissement dans un contexte où, les performances des entreprises des marchés cibles sont affectées par la baisse des cours des matières premières, réduisant davantage les opportunités d’investissement.
Le développement de compétences entrepreneuriales : La solution face à l’effet paradigme
L’effet paradigme résulte des divergences entre les méthodes de gouvernance d’entreprise appliquées par les fonds d’investissements et celles souvent moins orthodoxes des PME africaines. Ce qui constitue un frein au développement du capital-investissement.
Il convient de présenter l’entreprise comme un système composé d’éléments en interaction permanente. Envisager une entreprise en tant que système revient à la considérer comme un ensemble organisé composé de différentes fonctions, individus, ayant tous des objectifs, pouvant être contradictoires. C’est cette contrariété en termes d’objectifs qui oblige le manager à adopter un modèle de gestion moderne afin de concilier les buts et assurer une croissance maitrisée. L’entreprise moderne met en place des procédures, établie des organigrammes, définit les responsabilités et les délégations de pouvoirs puis assigne les rôles aux individus. En Afrique, les PME ou les entreprises en début d’activité communément appelées start-ups, sont caractérisées par la concentration du pouvoir entre les mains du chef d’entreprise, qui n’est généralement pas prêt à le partager. Une autre caractéristique de ces entreprises est qu’elles sont pour la plupart familiales. On entreprend en famille. Des facteurs socioculturels peuvent expliquer cet état de fait. L’esprit communautaire, le sentiment d’appartenance à un groupe social, souvent le village, est particulièrement présent dans les sociétés africaines. Zady Kessi, écrivain et Président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, disait dans Culture africaine et gestion de l’entreprise moderne (1998), que « L’esprit communautaire constitue la clef de voûte de l’édifice social africain ».
La mise en place d’un système de développement de compétences entrepreneuriales et d’apprentissage de bonnes pratiques, intégrant cette caractéristique indissociable à la culture de « l’entreprise africaine », qu’est l’esprit communautaire, trouve ainsi sens. Pour ce faire, le modèle des incubateurs est une piste. En effet les incubateurs, en plus d’être des lieux d’apprentissage, sont des lieux de socialisation. On apprend à se connaitre, à partager, à collaborer. Le lien de famille n’est plus le seul moteur de collaboration, donc de productivité. Pour l’investisseur, il permet de diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion d’entreprise, mais aussi d’aligner ses intérêts avec ceux de l’entrepreneur ou du dirigeant de la PME dans l’optique de favoriser l’entrée au capital et le partenariat à long terme. Le développement du numérique accélère la transition vers ce nouveau modèle. De plus en plus de centres d’innovations se créent sous l’impulsion d’institutionnels et d’investisseurs. Au Ghana, le « MEST » est un précurseur. Il a été créé en 2008 grâce au soutien de Meltwater, une multinationale spécialisée dans l’analyse de données en ligne. On le voit plus récemment au Sénégal avec Cofina start-up House l’incubateur du groupe COFINA, une institution de financement. Cette approche qui semble se développer davantage en faveur des start-ups n’est pas exclusive aux entreprises en démarrage. Le capital humain étant le principal accélérateur de croissance ; les dirigeants des PME dans une démarche participative, au cours de périodes d’incubation ou de « camps de formation » organisés au sein de ces lieux, pourraient être invités à travailler ensemble hors du cadre familial. Le changement de génération à la tête des PME facilite la mise en œuvre de tels programmes. Ces moments seraient des occasions pour faire connaitre les règles du financement, en l’occurrence du capital-investissement, et faire apprendre l’orthodoxie en matière de gouvernance d’entreprise ; favorisant ainsi l’entrée au capital des PME.
Promouvoir des équipes locales et une nouvelle stratégie de levée de fonds
La particularité de la plupart des fonds d’investissement intervenant en Afrique est de disposer d’équipes à très hauts potentiels. Ceci entraine des coûts de gestion élevés; ces dernières ayant des niveaux de rémunération identiques ou proches des standards occidentaux. Des équipes qui souvent, ne résident pas dans les pays où s’opèrent leurs investissements. Pour J-M. Severino, Président d’I&P -un fonds d’investissement dédié aux PME africaines-, « avec les structures de coûts que doivent supporter les professionnels opérant depuis Londres, Paris ou Dubaï, il est quasiment impossible d’imaginer être rentable en investissant seulement 500 000 euros ou 1 million par opération». Une contrainte qui justifie le fait que ces fonds préfèrent participer à des transactions de plusieurs millions. Pour permettre aux structures plus modestes telles que les PME et les start-ups d’avoir accès aux énormes ressources du capital-investissement, il faut nécessairement favoriser la mise en place d’équipes locales. Cela passe par des transferts de compétences via des partenariats-métiers avec des structures ou des professionnels aguerris du capital-investissement. Ces équipes locales présentent l’avantage d’être proches des entreprises bénéficiaires des investissements. Ce qui s’avère primordial pour la réussite de ces dernières pour lesquelles un accompagnement dit « hand-on » ; c'est-à-dire au plus près de l’entrepreneur, est essentiel. Jean-Marc Savi de Tové, ancien de Cauris Management et associé du fonds Adiwale explique que, « La difficulté de ce métier, c’est qu’il faut vivre à moins de 5 Km de l’entreprise dans laquelle on investit, car l’entrepreneur va avoir besoin de vous presqu’en permanence ». Les exemples de Teranga Capital au Sénégal ou de Sinergi au Burkina, des fonds soutenus par l’investisseur I&P et dirigés par des équipes locales sont illustratifs. Ces fonds investissent en moyenne entre 30 000 et 300 000 euros. Des montants qui correspondent aux besoins des entreprises.
Aussi réorienter la stratégie de levée de fonds s’avère indispensable. Au Sénégal par exemple -pays ayant bénéficié d’un des montants les plus élevés d’investissement d’impact en Afrique de l’Ouest- ; sur 535 millions de dollars levés sur la période 2005-2015, plus de 80% ont été mobilisés par le biais de transactions de plus de 10 millions de dollars (3). Les investisseurs habituels des fonds d’investissement ont des exigences de rentabilité qui peuvent contraindre les gestionnaires à cibler, les grandes entreprises présentant un profil de risque moins prononcé ou, des transactions dans les projets d’infrastructures, au détriment des entreprises de plus petite taille ne garantissant pas le niveau de rentabilité souhaité. S’orienter vers des investisseurs sociaux à vocation entrepreneuriale, c'est-à-dire privilégiant un impact social par l’accompagnement des entreprises, favoriserait l’accès aux ressources aux PME et aux start-up. Il s’agit entre autres des fondations, des institutions de développement au travers de programmes spécialisés, d’investisseurs privés, etc. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l’ensemble des chômeurs africains. Le rapport Perspectives Économiques en Afrique du Groupe de la Banque Africaine de Développement publié en 2012 indiquait que le continent avait la population la plus jeune au monde, avec 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans ; un chiffre qui devrait doubler d’ici 2045. Les défis auxquels fait face l’Afrique, en l’espèce la problématique du chômage des jeunes, rendent davantage pertinent cette approche et le choix du continent comme terre d’investissement pour ces investisseurs. Ce capital dit « patient » permet de rallonger la durée des investissements. En moyenne de sept (7) ans dans le modèle classique, la durée des investissements pourrait aller au-delà de dix (10) ans et ainsi garantir une croissance réelle des entreprises financées.
Instaurer un cadre législatif et fiscal avantageux et encourager la création d’associations locales du capital-investissement
Disposer d’un environnement juridique et fiscal incitatif pour le capital-investissement, véritable alternative à l’emprunt bancaire, est essentiel au plein essor de ce mode de financement. Le développement de ce concept a toujours été précédé par l’introduction d’un cadre juridique organisateur. Aux Etats-Unis où est né le capital-investissement, il a fallu la promulgation du décret de la Small Business Investment Act (4) par le gouvernement américain en 1958, pour voir se développer le métier de capital-investisseur. Certains pays africains ont pris la mesure de l’importance du capital-investissement en édifiant des réglementations propres à ce métier ; c’est le cas de l’Afrique du sud et de l’île Maurice -où sont enregistrés la plupart des fonds d’investissement opérant en Afrique-. Dans l’espace UEMOA, une loi Uniforme sur les entreprises d’investissement à capital fixe a été prise et transposée par certains pays. Malgré des avancées sur le plan fiscal de cette loi, elle reste silencieuse sur certains points. S’agissant de la gouvernance des sociétés, elle n’indique pas les modalités de gestion et de contrôle. Par ailleurs, aucun texte ne précise clairement le capital minimum requis. Des améliorations restent à apporter afin de rendre cette loi plus efficace et incitative ; notamment en rendant possible un accompagnement financier par les Etats, à ces sociétés, avec pour objectif de favoriser le soutien financier aux PME et aux start-ups. Cela passe par l’orientation de l’épargne locale, en l’occurrence celle collectée par les caisses de retraite, vers les fonds dédiés.
Afin de dynamiser le secteur du capital-investissement en Afrique, la mise en place d’associations locales est essentielle. Tel que préconisé par Jean Luc Vovor, – associé de Kusuntu Partners- lors d’une conférence tenue à Lomé sur le sujet ; les associations locales de capital-investissement devraient avoir pour mission d’informer et de promouvoir cette classe d’actif, parfois méconnue, auprès des partenaires que sont les entreprises en l’occurrence les PME et les start-ups, les sociétés d’investissement, les fonds de pension et les Etats.
La diffusion d’informations passe au préalable par le développement de programmes de recherches liés à ce secteur ; avec des recherches sectorielles, des enquêtes, le développement de normes, et aboutissant sur des sessions de formation et d’information. L’association sud-africaine de capital-risque et de capital-investissement (SAVCA), par son action, a favorisé l’instauration et la promotion de la réglementation relative aux fonds de pension en 2011 ; des amendements ont permis auxdits fonds de faire passer à 10% la part du capital–investissement géré. Il s’agit là du rôle déterminant que pourraient jouer les associations locales dans le développement du capital-investissement en Afrique.
Un écosystème entrepreneurial dynamique est essentiel au développement du capital-investissement en Afrique. Contribuer à l’éclosion de cet écosystème passe par la mise en place de centres de développement de compétences entrepreneuriales, en favorisant l’accès au financement. Les programmes comme celui lancé récemment par la BAD et la Banque européenne d’investissement, Boost Africa, qui ambitionnent de couvrir la totalité du secteur de la création d’entreprise ; en aidant à constituer un portefeuille de 25 à 30 fonds au cours des prochaines années sont à multiplier. Pour croitre et créer des emplois durables, les entreprises à forts potentiels que sont les start-ups et les PME ont besoin d’investisseurs capables de s’adapter à leur niveau de risque. Le capital-investissement en Afrique doit s’inscrire dans un cadre plus global mêlant développement de compétences, promotion d'équipes locales, accès au financement, et implication des pouvoirs publics.
Larisse Adewui
- Source : EMPA, Fundraising & Investment Analysis, Q4 2014
- Source : EMPA, Fundraising & Investment Analysis, Q4 2014
- Source : Le Marché de l’investissement d’impact en Afrique de l’Ouest : Etat des lieux, tendances, opportunités et enjeux actuels, Pages 12-17
- La Small Business Act est une loi du congrès des Etats-Unis votée en 1958, visant à favoriser le développement des PME.
Blue economy: an opportunity for inclusive growth In Sub-Saharan Africa
 Sub-Saharan African countries have over the last few decades recorded strong growth rates, resulting in an average growth of about 5% in the region in 2014. Countries such as Côte d’Ivoire, Kenya and Senegal have continued to perform well in spite of the notable drop in 2015 as a result of the fall in oil prices.
Sub-Saharan African countries have over the last few decades recorded strong growth rates, resulting in an average growth of about 5% in the region in 2014. Countries such as Côte d’Ivoire, Kenya and Senegal have continued to perform well in spite of the notable drop in 2015 as a result of the fall in oil prices.
Despite these performances, most Sub-Saharan African countries continued to be plagued by high levels of poverty and inequalities and low standards of health and education systems, which explain the reason for their very low Human Development Index (HDI). According to the 2015 UNDP report on Human Development, 38 of the 48 Sub-Saharan countries are ranked among the fourth and last categories of countries with the lowest Human Development.
This situation can be attributed to a lack of exploitation of all the potentials available to these African countries. These include potentials offered by the seas, oceans, lakes and rivers, through fishing, tourism, commerce, energy supply and the production of pharmaceutical products which ensure the creation of wealth and employment. While maritime commerce can be said to be developed in the coastal nations of sub-Saharan Africa, fishing, tourism, energy and pharmaceutical production remain under exploited.
This article revisits the under-exploited aspects of the Blue economy in the Sub-Saharan African region that offer a strong economic growth potential for the region.
Tourism: An under-exploited but important revenue-generating sector for Sub-Saharan Africa
According to the World Tourism Organization, Global revenues for tourism was about $1.5 billion in 2014, in which $221 billion was revenue from passenger transportation and $1245 billion was from visitors’ expenditures in accommodation, food and drinks, leisure, shopping and other goods and services. This offers a really great opportunity in direct employment, particularly for the youth.
However, although the global revenues for tourism were high, Africa was only able to gain 3% from this total revenue – which equals less than 3% for Sub-Saharan Africa. This low tourism revenue rates is due to lack of significant political action that ensures revenue growth in the tourism sector. This lack of policy is characterized by under-equipped and under-managed beaches, inadequate infrastructure, a lack of promotion of tourist sites, and oftentimes a high political instability. If Sub-Saharan African countries, through the tourism potentials that the oceans offer can improve their tourism sector and achieve at least 10% from the global revenue for tourism totaling about $150 billion, they would then be able to have additional resources to finance other developmental projects.
Fisheries and Aquaculture: Low African Productivity in the global market
The Food and Agricultural Organization (FAO) in its 2016 report on the State of the World Fisheries and Aquaculture highlights the fact that fish continue to be one of the most traded basic commodities globally, and that more than half of the these exports are from developing countries. However, African marine and coastal aquaculture production was only 0.2% in 2014 (FAO 2014). This then gives a lower estimated turnover for Sub-Saharan Africa.
Considering the fact that Africa has an estimated maritime area of about 13 million square kilometers, it is a wonder why African production is not large enough. The importance of fishery and aquaculture in the economic transformation of Sub-Saharan African countries towards inclusive economies lies in their ability to create direct employment particularly for the underprivileged population. For example in Mauritius, 29,400 jobs were created through the Fishing sector in 2014, according to the FAO.
More so, there is no doubt that fishery and aquaculture have played an important role in the economic expansion of Asian countries over the past decades. That 53% of the global maritime and coastal aquaculture production of fish come from Asia in 2014, is proof of this fact. In other words, the global exports of fish, cited at the beginning of this section, come principally from Asian countries.
Hydro-electricity: Harnessing the Potential to fully Power Africa
Energy is undoubtedly essential in the economic development of any country. Electricity is vital for the proper functioning of services such as health and education, as well as for the smooth running of businesses that create employment.
Access to electricity, especially in the rural areas would help in the creation of a certain employment, allowing the structural reduction of the level of poverty. Despite these benefits however, according to the African Development Bank, more than 640 million Africans do not have access to power, which corresponds to an access rate of just over 40%. The same source states that the energy consumption per capita in Sub-Saharan Africa (excluding South Africa) is about 180kWh, a far cry from 13,000 kWh per capita in the U.S, and 6,500 kWh in Europe.
Despite the fact that Hydroelectricity supplies about a fifth of the current energy capacity, this represents only a tenth of its total output. Yet according to the International Energy Agency, the ocean’s renewable energy could supply up to 400% of the global demand. Simply put, the 28 coastal countries in Africa can fully power up their population and can equally export energy to the remaining 20 Sub-Saharan African countries. African states must therefore consider further exploitation of hydroelectricity so as to supply energy to their populations. This would enable the creation of jobs and ensure an all-inclusive growth.
Climate-change awareness
Despite their enormous provision of natural wealth to the population, the over exploitation or the improper exploitation of the oceans, seas, rivers and lakes can have adverse effects on the environment. The Life Index of marine species have indeed decreased by 39% between 1970 and 2000. It is therefore essential to respect certain rules in addressing the environmental production while enjoying the benefits of a Blue Economy. Countries wishing to take advantage of the Blue economy can look into the recommendations made in the Africa’s Blue Economy: A policy Handbook, of the United Nations Economic Commission for Africa. These policies include, among others, the development of a framework in promoting infrastructure that respects the environment such as green ports and the use of renewable technologies. The report also recommends investment in information services on the environment to facilitate the ready availability of information on the climate and the environment.
Translated by: Tomilade Adesola
Source :
http://www.uneca.org/publications/africas-blue-economy-policy-handbook
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2015-human-development-report.html
http://www.afdb.org/fr/the-high-5/light-up-and-power-africa-–-a-new-deal-on-energy-for-africa/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/9ba59d60-6d96-4991-b768-3509eeffc4da/
http://www.worldwildlife.org/publications/reviving-the-oceans-economy-the-case-for-action-2015