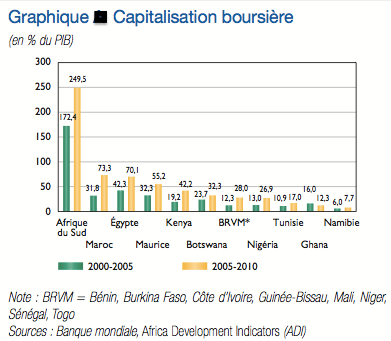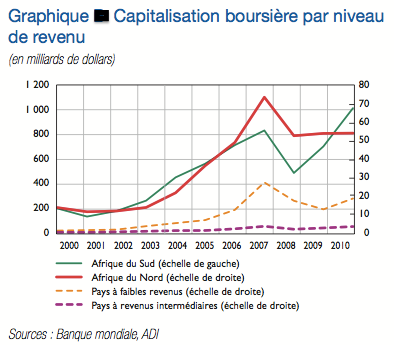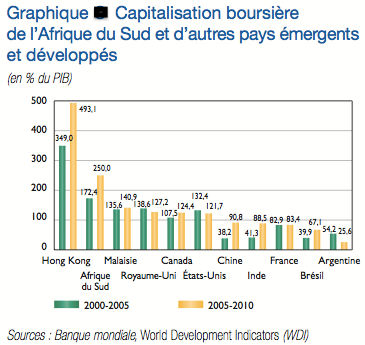Dès le début des années 2000, plusieurs entreprises marocaines privées sont allées s’installer en Afrique, couvrant un ensemble diversifié de secteurs. A titre d’illustration, l’implantation de filiales bancaires de la Banque Centrale Populaire, de BMCE Bank of Africa et d’Attijariwafa Bank dans une quinzaine de pays africains. Le holding d’assurance Saham est également présent dans une vingtaine de pays du continent, depuis le rachat de l’opérateur nigérian Continental Reinsurance en 2015. Dans les télécommunications, Maroc Télécom a renforcé son emprise dans le continent avec le rachat de 6 filiales africaines de son actionnaire émirati Etisalat. En outre, plusieurs holdings comme Ynna Holding et la Société Nationale d’Investissement (SNI), à travers sa filiale minière Managem interviennent en Afrique. Dans le secteur immobilier, Alliances Développement Immobilier a signé des accords de partenariat avec les gouvernements camerounais et ivoirien pour la construction de milliers de logements sociaux, Palmeraie Développement a lancé des projets de construction au Gabon, en Côte d’Ivoire et récemment au Rwanda. Le Groupe Addoha a également jeté son dévolu sur le continent via ces deux entreprises : Addoha et Ciments de l’Afrique (CIMAF), motivé par les importants investissements en infrastructures (autoroutes, ponts, ports, logements sociaux, universités, etc). Rejoint depuis peu par LafargeHolcim Maroc Afrique (LMHA), filiale détenue à parts égales par le cimentier LafargeHolcim et le holding royal SNI.
Ainsi, le secteur privé joue un rôle primordial dans l’intégration économique régionale. La mobilisation des investissements privés y est essentielle pour la création d’emploi, l’amélioration de la productivité et l’augmentation des exportations. L’intégration économique maroco-africaine dessinée par le Roi Mohammed VI appelle les opérateurs nationaux à partager leurs expériences et à raffermir leurs relations de partenariat avec les pays africains. Le secteur privé marocain aura alors pour rôle de transférer ses connaissances, tout en exploitant le potentiel de production, contribuant ainsi à l’amélioration de sa compétitivité à l’échelle internationale. Pour sa part, le commerce interrégional offre une occasion de dynamiser les échanges commerciaux – encore faibles – et de réduire le déficit structurel de la balance commerciale marocaine. Le potentiel économique étant important. La CEDEAO (Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest) et la CEMAC (Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale) comptent plus de 300 millions de consommateurs, soit un marché 9 fois supérieur à la population marocaine.
Rôle des Groupements d’impulsion économique dans le renforcement des relations économiques bilatérales
A chaque déplacement officiel de Mohammed VI, le Maroc conclut avec les autres pays africains des accords préférentiels prévoyant des facilités douanières et des avantages fiscaux afin de promouvoir les échanges commerciaux et développer les investissements intra-africains. Aujourd’hui, les relations économiques entre le Royaume et les autres pays africains sont régies par un cadre juridique de plus de 500 accords de coopération.
Ceci est tellement important que le Roi Mohammed VI a invité le Gouvernement – lors de la 1ère Conférence des ambassadeurs organisé en août 2013 – à œuvrer en coordination et en concertation avec les différents acteurs économiques des secteur public et privé en vue de saisir les opportunités d’investissements dans les pays à fortes potentialités économiques. Ainsi, les derniers périples royaux ont été marqués par la mise en place de Groupes d’impulsion économique (GIE) entre le Maroc et le Sénégal, d’une part, et le Maroc et la Côte d’Ivoire, d’autre part. Ces instruments, co-présidés par les ministres des Affaires étrangères et les présidents des patronats de chaque pays, visent à promouvoir le partenariat entre les secteurs privés et à booster les échanges commerciaux ainsi que les investissements[1].
Avec une population de près de 22 millions d’habitants, la Côte d’Ivoire est la 1ère économie de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine) et est également la 2e puissance économique de la CEDEAO. Et les opportunités d’investissements n’y manquent pas : l’industrie, les infrastructures et BTP, les mines, énergies, etc. Le Sénégal n’est d’ailleurs pas en reste. Il existe de nombreuses raisons qui encouragent les investissements dans le pays tels que la stabilité politique, l’ouverture économique et la modernité des infrastructures. La protection des investisseurs marocains est également assurée grâce notamment aux accords de promotion et de protection réciproque des investissements et des accords de non double imposition. Le protocole d’accord relatif à la création d’une joint-venture entre le groupe marocain « La Voie Express » et la société sénégalaise « Tex Courrier » signé le 9 novembre 2015 lors de la cérémonie de présentation des travaux du GIE maroco-sénégalais – présidé par le Roi Mohammed VI et le Président Macky Sall – témoigne à juste titre du rôle moteur joué par cet instrument pour la dynamisation du partenariat privé-privé[2].
Par ailleurs, les échanges entre le Royaume et le continent africain ont connu une nette augmentation durant la dernière décennie. Sur la période 2004-2014, les échanges globaux du Maroc avec le continent ont quadruplé, passant de 1 milliard de dollars à 4,4 milliards de dollars. L’étude ‘‘Structure des échanges entre le Maroc et l’Afrique : Une analyse de la spécialisation du commerce’’ réalisée par OCP Policy Center en juillet 2016 montre que l’Afrique de l’ouest reste la 1ère destination des exportations marocaines[3]. Cette région a notamment accueilli environ 50,08% de ces exportations en 2014, soit l’équivalent de 1,04 milliard de dollars[4]. Toutefois, l’analyse de la structure des exportations fait ressortir que les exportations marocaines vers le continent sont dominées par les biens intensifs en matières premières et ressources naturelles[5]. Un fort potentiel reste encore à développer pour dynamiser davantage les exportations marocaines. La Direction des études et des prévisions financières (DEPF), rattachée au Ministère de l’Economie et des Finances marocain, soulignait dans son étude ‘‘Relations Maroc-Afrique : l’ambition d’une nouvelle frontière’’ que « les entreprises marocaines, ciblant le marché africain, devraient privilégier une stratégie de pénétration basée sur des considérations de coûts à partir de choix sectoriels ciblés en fonction de l’évolution des besoins actuels et surtout futurs des populations africaines, l’essor démographique, la montée des classes moyennes et l’urbanisation rampante du continent sont autant de facteurs à prendre en considération pour anticiper la configuration ascendante de ces économies en voie d’émergence ». Dans ce sens, les entreprises exportatrices marocaines ont intérêt à anticiper les dynamiques de transformations économiques, sociales et culturelles qui se profilent à l’horizon en Afrique subsaharienne en mettant en place des stratégies d’adaptation afin de capter une part de marché supérieure et combler leur retard sur cette région dynamique.
L’action économique au cœur de la stratégie d’intégration du Maroc en Afrique
L'intégration économique est aussi importante pour le Maroc que pour le continent. La récente tournée royale effectuée au Rwanda, Tanzanie, Sénégal, Ethiopie, Madagascar et Nigéria a vocation à la renforcer. L’Afrique de l’est est la région africaine la plus dynamique. Et le potentiel économique y est encore inexploité. Ainsi, afin que le Maroc puisse renforcer davantage sa présence sur le continent africain, il convient d’explorer un certain nombre de pistes. Tout d’abord, encourager l'internationalisation des entreprises marocaines et leur investissement en terre africaine en mettant à leur disposition une véritable base de données sur les spécificités et le potentiel de chaque économie. Ensuite, favoriser les flux d’exportations vers les pays africains. Les acteurs publics et privés sont tous les deux concernés par la promotion des produits marocains. La nouvelle Agence marocaine de développement des investissements et des exportations mais également l’ASMEX (Association marocaine des exportateurs) devront conduire des missions commerciales dans différents gisements africains et offrir aux entreprises nationales l’accompagnement nécessaire pour développer leurs exportations et/ou réaliser leur projet de développement sur le continent. Enfin, renforcer l’intégration commerciale avec les différents pays africains. Le marché de consommation est en train de se constituer avec l’émergence d’une classe moyenne davantage tournée vers les produits manufacturés et à forte valeur ajoutée. La négociation de partenariats avancés avec la CEDEAO et la CEMAC incluant la mise en place de zones de libre-échange, constitue à son tour une porte d’entrée idéale sur ce grand marché de plus de 300 millions d’âmes.
A l'ère de la mondialisation et de la concurrence internationale acharnée, la projection accrue des économies émergentes sur le continent africain est empreinte de rivalités : Chine, Inde, France, Japon ou encore l’Allemagne, tous ont dévoilé leurs ambitions africaines. Face à ce contexte international, la diplomatie marocaine se veut plus ambitieuse et agressive. Le Roi Mohammed VI déclarait à l’ouverture du Forum Maroco-Ivoirien du 24 février 2014 : « les relations diplomatiques sont au cœur de nos interactions. Mais, à la faveur des mutations profondes que connaît le monde, leurs mécanismes, leur portée ainsi que leur place même dans l'architecture des relations internationales, sont appelés à s'adapter aux nouvelles réalités. » Dans ce sillage, le Maroc gagnerait à organiser un sommet d’affaires maroco-africain. Ce dernier s’inscrirait dans la continuité de l’Africa Action Summit et porterait sur le potentiel de développement économique du continent. Le Sommet réunirait, ensemble, les gouvernements et entreprises, les secteurs public et privé, autour du développement économique, social, et humain de l’Afrique. L’enjeu étant de réaffirmer la stratégie d’influence du Maroc sur le continent.
Hamza Alami
[1] Les groupements d’impulsion économiques comprennent 10 secteurs d’activités identifiés comme prioritaires : il s’agit des commissions Banque-finances-assurance, agri-business-pêche, immobilier-infrastructures, tourisme, énergie-énergie renouvelables, transport-logistique, industrie-distribution, économie numérique, économie sociale et solidaire-artisanat, capital humain-formation et entreprenariat
[2] Christophe Sidiguitiebe, Quatre nouveaux accords signés entre le Maroc et le Sénégal, Telquel.ma, le 10.11.2016 : www.telquel.ma/2016/11/10/quatre-nouveaux-accords-signes-maroc-senegal_1523082
[3] Quatre des cinq principaux partenaires commerciaux africains (Algérie, Mauritanie, Sénégal, Côte d’Ivoire et Nigéria) font partie de l’Afrique de l’ouest.
[4] En ce qui concerne les importations, le poids de l’Afrique du nord a constitué la source de près de la totalité des importations marocaines, avec une part de 82% en 2014 contre 53% en 2004, en important principalement du gaz naturel, du gaz manufacturé, du pétrole et produits dérivés.
[5] Les exportations marocaines sont constituées essentiellement de produits alimentaires et animaux vivants (25%), les machines et matériels de transport (18,5%), les produits chimiques et produits connexes (18,1%), les articles manufacturés (15,9%) et les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes (11,7%).