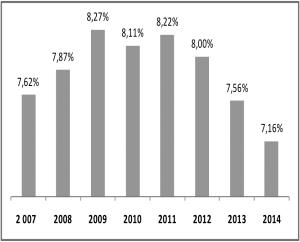Longtemps évoqué dans les débats publics, le projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO semble se préciser de plus en plus. Après avoir dressé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet, cet article lance une réflexion sur les conditions à réunir pour la construction d’une solide zone monétaire ouest africaine à même de booster le développement de la région.
Longtemps évoqué dans les débats publics, le projet de création de la monnaie unique de la CEDEAO semble se préciser de plus en plus. Après avoir dressé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet, cet article lance une réflexion sur les conditions à réunir pour la construction d’une solide zone monétaire ouest africaine à même de booster le développement de la région.
1. La monnaie unique de la CEDEAO : un vieux projet qui peine à se concrétiser
Dès la création de l’institution en 1975, l’idée de la mise en place d’une monnaie unique était déjà inscrite dans la vision des pères fondateurs de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest)[1]. Les premières véritables initiatives n’ont été prises qu’à partir de 1996 avec la création de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO). Regroupant les huit banques centrales de la CEDEAO (la BCEAO et les sept banques centrales des pays non membres de la zone franc d’Afrique de l’ouest), l’AMAO qui avait pour mission de piloter la conception et la mise en œuvre opérationnelle de l’ambitieux projet est malheureusement restée inactive pendant les trois premières années suivant sa création. Dans ce contexte, réaffirmant fermement leur volonté de doter l’Afrique de l’Ouest d’une monnaie unique, les Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO réunis à Lomé en 1999 ont défini une stratégie dite « approche accélérée de l’intégration » qui vise justement à donner un coup d’accélérateur à ce projet qui commençait à s’enliser. Avec l’adoption de cette nouvelle stratégie, la feuille de route de la création de la monnaie CEDEAO prévoyait deux grandes étapes. Dans un premier temps, les pays non membres[2] de la « zone franc » doivent créer une zone monétaire unique qui fusionnera par la suite avec la zone UMOA (Union Monétaire Ouest Africaine)[3] déjà existante. Ainsi, en 2000, cinq pays (Gambie, Ghana, Guinée, Nigéria, Sierra Leone) non membres de l’UMOA ont défini les bases d’un projet de zone monétaire commune dénommée ZMAO (Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest). Depuis cette date, malgré l’appui apporté par les institutions sous-régionales, ce projet n’a pas connu d’avancée majeure. Face à cet immobilisme, et compte tenu du fait que l’avènement de la zone monétaire unique CEDEAO est subordonné à la mise en place de la ZMAO, le conseil des ministres de la CEDEAO réuni en cession extraordinaire à Abidjan en septembre 2013 a exhorté les cinq pays concernés à prendre les dispositions nécessaires en vue de déployer leur projet avant la fin de l’année 2015. En dépit de cette pression supplémentaire, le projet semble encore en gestation à cinq mois de l’échéance fixée ; ce qui amène certains observateurs à proposer de créer la monnaie unique de la CEDEAO sans passer par l’étape intermédiaire de la ZMAO qui alourdit finalement le processus. En tout état de cause, au regard des balbutiements qu’a connu cette initiative depuis son lancement au milieu des années 1990, il est difficile à ce jour d’affirmer que le calendrier initial qui était d’aboutir à la mise en circulation de la monnaie unique de la CEDEAO à l’horizon 2020 sera respecté.
2. D’importants défis restent encore à relever avant le lancement du projet
Le rappel historique présenté dans le paragraphe précédent montre bien que les pays membres de la CEDEAO ont du mal à observer une discipline minimale pour décliner opérationnellement le projet de création de la zone monétaire. Au delà de ces difficultés administratives et techniques qui plombent le démarrage du projet, d’importants défis stratégiques et politiques préalables à la mise en œuvre réussie d’une zone monétaire n’ont jusqu’à présent pas été sérieusement traités, laissant ainsi de nombreuses questions fondamentales sans réponses concrètes dont les plus importantes sont présenté ci-dessous.
- Un contexte socio-économique peu favorable au succès d’une monnaie commune : à quelques années seulement de la date buttoir prévue pour le lancement de la monnaie, une analyse rapide du contexte économique et social de la région permet de s’apercevoir que les conditions minimales pour le succès d’une zone monétaire restent à construire. En effet, presqu’aucun des quatre critères[4] d’une zone monétaire optimale définis par le prix Nobel d’économie Robert Mundell, ne semble rempli au sein de la CEDEAO. Dans ce contexte, la communauté a défini un ensemble de critères de convergences[5] à respecter par les Etats membres avant la mise en place de la monnaie unique. Ces critères essentiellement composés d’objectifs économiques, que les pays ont d’ailleurs du mal à respecter, devraient être renforcés par des indicateurs sociaux afin d’aboutir à une zone monétaire plus optimale (voir cet article de Georges).
- La suppression de la zone franc, une question en suspens : la création de la zone monétaire de la CEDEAO implique la disparition du Francs CFA, une monnaie que se partagent des anciennes colonies de la France depuis plus de 70 ans sous le contrôle de la métropole. Au regard du rôle important que joue la zone francs dans sa stratégie de conquête des économies africaines, il est évident que la France opposera une farouche résistance quand il sera question de supprimer cette monnaie. Et paradoxalement, bien qu’étant conscients de cette réalité, les pays membres de l’UMOA restent inactifs et ne se sont visiblement pas encore décidés à mettre en place une feuille de route claire pour une sortie réussie du système du FCFA.
- Aucune visibilité sur le régime de change envisagé : Enfin,mais pas des moindres, alors que la CEDEAO semble impatiente de mettre en circulation sa future monnaie unique, la question fondamentale du régime de change (fixe, flottant ou mixte) n’est pas encore clairement tranchée.
3. Le rationnel de la création de la zone monétaire devrait être guidé par la « raison » plutôt que la « passion »
Que la CEDEAO exprime un vif intérêt pour une monnaie régionale au moment où la zone Euro affiche un bilan mitigé près de quinze ans après le lancement de sa monnaie commune (l’Euro) est une bien curieuse coïncidence qui suscite réflexion. Quelles sont alors les motivations d’une telle initiative et que peut-elle apporter à la région ? De fait, au delà d’une simple expression des velléités souverainistes et révolutionnaires, pour qu’elle soit porteuse de synergies positives, la décision de création de la zone monétaire doit avant tout être fondée par une volonté d’accélérer et d’améliorer l’intégration économique de la sous-région. En effet, les revendications de souveraineté bien qu’étant nobles, relèvent du politique et donc de l’émotionnel, ce qui peut parfois conduire à la déraison. Ainsi, le projet de création de la monnaie unique doit être considéré comme un processus normal de l’intégration des peuples d’Afrique de l’Ouest et non pas un quelconque défi lancé à des puissances étrangères. Cela suppose de traiter la question avec toute la rigueur qui s’impose en abordant avec minutie et intelligence l’ensemble des défis techniques et stratégiques préalables au succès de toute zone monétaire. C’est uniquement à ce prix que l’avènement de la zone monétaire de la CEDEAO pourrait catalyser le développement des pays membres en produisant des avantages tels que l’accroissement du commerce intra-régional, la réduction des coûts de transaction, la maitrise de l’inflation, la protection contre la dévaluation etc.
En définitive, si elle parvient à surmonter les obstacles se dressant sur le chemin de la mise en place de sa monnaie unique, la CEDEAO qui reste d’ailleurs un modèle d’intégration réussi en Afrique notamment avec son passeport unique garantissant une libre circulation des personnes, marquera un grand pas dans le processus d’émergence de ses pays membres. Toutefois, pour éviter un effet de massue, il est important de dépassionner les débats en mettant l’accent sur les aspects économiques de sorte à pouvoir construire sereinement une zone monétaire solide reposant sur des fondamentaux inébranlables.
Lagassane Ouattara
[1] La CEDEAO comprend 15 pays : Nigéria, Ghana, Sierra Leone, Guinée, Libéria, Cap Vert, Gambie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Niger, Mali, Togo, Benin, Guinée Bissau
[2] Les pays ouest africain non membres de la zone francs (Nigéria, Ghana, Siera Leone, Guinée, Libéria, Cap Vert, Gambie) possèdent chacun une monnaie, soit un total de 7 différentes monnaies.
[3] L’UMOA (Union et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest) est une organisation sous-régionale qui regroupent huit pays (Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Niger, Mali, Togo, Benin, Guinée Bissau) de l’Afrique de l’Ouest ayant en commun une monnaie dénommée « Francs CFA » héritée de la colonisation française. Cette monnaie est gérée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
[4] Les critères d’une zone monétaire optimale selon Robert Mundell : une parfaite mobilité des travailleurs, un mouvement libre des flux de capitaux, une économie suffisamment diversifiée et un système fiscale commun facilitant le transfert des capitaux d’un pays à un autre
[5] Les 4 principaux critères de convergences de la CEDEAO : Equilibre budgétaire/PIB >= -4% ; taux d’inflation<=5% ; Réserves brutes >=6 mois ; Financement du déficit budgétaire par la Banque centrale par rapport aux recettes fiscales de l’année précédente <=10%