
Elle avait reçu un nom prédestiné. Scholastique, c’est l’enseignement, celui en l’occurrence de la philosophie du Moyen-âge, lui a été donné par un prêtre. Mukasonga, c’est son vrai nom donné par son père, celui qui compte, celui qui signifie point culminant.
Prédestiné d’abord car Scholastique Mukasonga a reçu de ses parents la mission de transmettre la mémoire de son peuple, de sa famille, d’enseigner aux autres leur histoire quand, en 1973, après qu’elle ait été chassée de l’école d’assistante sociale de Butare parce que Tutsi, ils ont choisi de l’envoyer au Burundi, d’en faire une survivante, qu’elle leur survive pour se faire la voix de leur histoire car ils se savaient, déjà, menacés. Et elle, plus tard, a choisi de sublimer sa voix, leur voix, entremêlées, dans la littérature. Ou pas vraiment choisi car, ainsi qu’elle l’a souligné, c’est le génocide qui a fait d’elle une écrivain, c’est un destin qu’elle n’avait pas pensé, elle n’a pas eu le choix de cette écriture. Elle a fait sien cet adage de Primo Lévi : survivre et témoigner sont inextricablement liés.
Scholastique insiste avant tout sur le fait qu’elle est une survivante, pas une rescapée. Parce qu’il n’y a pas eu de rescapés à Gitagata, son village, tous ont été massacrés, génocidés, machettés en 1994 dans cette folie qui a emporté près d’un million de Tutsi et de Hutu dits modérés en 100 jours. Tous les hommes mais aussi maisons, lieux, animaux, dans son village d’enfance tout a été éradiqué, il ne reste rien pour témoigner de l’existence de ces gens, des 37 membres de sa famille, qu’il y a eu même un village. Gitagata est devenu la colline de la mort. « Les tueurs se sont acharnés sur la maison jusqu’à en effacer la moindre trace. […] C’est comme si nous n’avions jamais existé [dit-elle]. Et cependant ma famille a vécu là. Dans l'humiliation, la peur de chaque jour, dans l’attente de ce qui allait survenir et que nous ne savions pas nommer : le génocide »[1]
De ça, de cette horreur il reste pourtant Scholastique. Avec en elle la culpabilité et l’injustice du survivant, les cauchemars et les questions qui tournent dans la tête : qu’est-ce qu’on a de plus pour être encore vivant, pourquoi est-t-on choisi par le destin pour porter cette histoire très lourde ? Quel sens donner à sa vie après ça ?
Alors elle a jeté ses mots sur le papier, sa mémoire, celle de sa famille, de tout le peuple de Nyamata disparu, dans une urgence pour ne pas oublier, que tout s’efface à jamais. Dans cette urgence elle écrit deux récits autobiographiques, Inyenzi ou les cafards (2006), La femme aux pieds nus (2008), ainsi qu’un recueil de nouvelles, L’Iguifou (2010), qui, tous, sonnent comme un double impératif intimement liés, celui du devoir de mémoire et celui de dresser un tombeau de papier, un linceul de mots pour ceux et celles qui sont mort sans corps ni sépultures. Car il fallait avant tout un lieu et un linceul pour rendre le deuil possible. Lorsqu’elle écrit Inyenzi ou les cafards, récit des persécutions qu'elle a vécues, c’est d'abord « pour [elle], pour ne pas oublier. [Elle se] disai[t] que si un matin [elle se] réveillai[t] incapable de raconter cette histoire, tous ces gens seraient vraiment morts ». C’est ce cri lancinant chez elle qui insuffle son écriture :
« où sont-ils à présent ? Dans la crypte mémoriale de l’église de Nyamata, crânes anonymes parmi tant d’ossements ? Dans la brousse, sous les épineux, dans une fosse qui n’a pas encore été mise au jour ? Je copie et recopie leurs noms sur le cahier à couverture bleue, je veux me prouver qu’ils ont bien existé, je prononce leurs noms, un à un, dans la nuit silencieuse. Sur chaque nom je dois fixer un visage, accrocher un lambeau de souvenir. Je ne veux pas pleurer, je sens des larmes glisser sur mes joues. Je ferme les yeux, ce sera encore une nuit sans sommeil. J’ai tant de morts à veiller.»[2]
 Car même si elle est de tradition orale, il semble que la parole ne suffise plus là où il y a eu génocide, que la transmission orale ne peut raconter l’irracontable. Avec le génocide on rentre dans le domaine de l’indicible. Elle pense au journal d’Ann Frank, elle visite le mémorial de Caen. Son cahier d’écolier ne la quitte plus, elle écrit, des mots qui sortent comme du venin de son corps.
Car même si elle est de tradition orale, il semble que la parole ne suffise plus là où il y a eu génocide, que la transmission orale ne peut raconter l’irracontable. Avec le génocide on rentre dans le domaine de l’indicible. Elle pense au journal d’Ann Frank, elle visite le mémorial de Caen. Son cahier d’écolier ne la quitte plus, elle écrit, des mots qui sortent comme du venin de son corps.
Ses mots, récits, nouvelles, romans écrivent dans le même temps son autobiographie et l’histoire du Rwanda, elle décrit son enfance, sa jeunesse et les jalons du génocide. Sa vie et son écriture sont marqués au même fer de tous les épisodes sanglants du Rwanda. A la limite du dicible et de l’humain donc. Alors dans ce cri de survivante il y a très vite sa volonté de retracer, d’expliquer que ce million de morts n’était pas soudain, il s’explique, qu’il a des racines, beaucoup ont alerté, beaucoup en sont responsables.
Elle est née en 1956 au début de cette époque charnière qui a vu le discours de la haine anti-tutsi se mettre en place, s’institutionnaliser, se répandre dans toute la société rwandaise, époque où, juste après l’indépendance, la majorité Hutu, influencée par les plus extrémistes d’entre eux, prend les commandes du pays et se donne comme mission d’épurer la société des Tutsi, ces quelques 10% de la population sur lesquels les colons belges s’appuyaient. En 1960, sa famille est parmi celles déportées vers Nyamata, région inhospitalière et désertique du Rwanda, où nombre de Tutsi ont été parqué en 1960. Enfant, elle voit la fuite, elle raconte les maisons qui brulent, déjà les machettes, les massues, les torches, elle raconte comment ils ont été entassé dans des camions, sans que personne ne sache où ils allaient, comment elle lisait le désespoir dans le regard de sa mère, comment elle avait peur, déjà[3] ; et dès lors c’est le début de la fin, la machine de mort, d’annihilation qui se met en route, et cela, cette pression faite de menaces, brimades, insultes et tueries, cela à Nyamata, va devenir le quotidien de Scholastique, de sa famille, des Tutsis. Avec la déportation c’est d’abord la faim car ils n’avaient plus rien, il fallait tout reconstruire, tout planter, la soif car il n’y avait presque pas d’eau vers Nyamata, puis quand la vie se reconstruit peu à peu dans ce lieu hostile de l’exil intérieur, ce sont les militaires qui imposent la « terreur au quotidien » : patrouilles, tueries surprise, viols, grenades, menaces, humiliations, couvre-feu, arrestations arbitraires, insultes:
« Ils nous appelaient les Inyenzi – les cafards. Désormais à Nyamata, nous serions tous des Inyenzi. J’étais une Inyenzi »[4].
Des insultes qui sont en réalité autant de machettes linguistiques, qui sonnent déjà comme un prélude au génocide car inyenzi, cafard, déshumanise, animalise, renvoie les Tutsi au rang d’insectes nuisibles et indésirables et donc insectes que les véritables humains sont en droit de tuer, doivent tuer même, inyenzi c’est déjà un appel au meurtre. En choisissant cette insulte comme mot-titre Scholastique Mukasonga met en exergue cette manipulation politique qui disait aux Tutsi comme aux Hutu que les Tutsi n’avaient pas droit à la vie, qu’ils devaient être éradiqués par tous les moyens. Elle a grandi dans cette idéologie où elle ne se voyait pas comme un être humain mais comme un cafard, il y avait la deshumanisation, l’aliénation et l’acceptation de la mort, il n’y avait pas de lendemain ni d’avenir possible, notre vie était égale a la mort rappelle-t-elle.
Comme elle le souligne au long d’Inyenzi ou les cafards et de La femme aux pieds nus tous savaient que cela allait arriver, ils attendaient le jour fatidique. Vivre c’était déjà survivre.
Dès l’indépendance du Rwanda en 1962 « des milliers de Tutsi avaient été massacrés, plus de cent cinquante mille avaient fui dans les pays avoisinants, ceux qui restaient au Rwanda allaient être réduits à l’état de parias. A Nyamata, les réfugiés intérieurs étaient voués aux bienfaits de la « demokarasi » etnhique. »[5]. « Les mois de janvier et février 1964 virent une véritable préfiguration au génocide de 1994. […] La rivière Rukarara, avait-on dit à ma mère était rouge de sang. »[6]. Scholastique grandit malgré tout dans ce climat et juste avant la fin de l’école primaire, en 1967, juste avant l’examen national qui permet de passer au secondaire, il y a un nouveau massacre prophétique de l’avenir, une vision de l'horreur qui la hante encore aujourd’hui, elle se terre avec ses sœurs, craint pour ses parents et lorsque tout rentre dans l’ordre « dans les fossés, il y avait des cadavres. Certains avaient été jetés là, d’autres avaient été charriés par les torrents qu’avaient formés les eaux de pluie. »[7] et lorsqu’il faut aller chercher de l’eau au bord du lac elle voit « les corps ligotés des victimes qui agonisaient lentement dans les eaux basses du lac, recouverts de temps à autre par le mouvement des vagues [et des sentinelles qui sont] là pour repousser les familles qui voulaient sauver leurs enfants ou au mois récupérer leurs corps [et] longtemps, en puisant de l’eau, [elle a] trouvé, dans [ses] calebasses, des lambeaux de chairs et de membres putréfiés »[8] : l’œuvre de la jeunesse révolutionnaire du parti unique : le MDR-Parmehutu.
 Nyamata c’était tout ça mais aussi la vie quotidienne, les souvenirs heureux, comment la vie continuait, s'agençait malgré tout, parce qu’il y a ça que l’Homme est plus fort malgré tout, qu’il a cette capacité-là de recréer la vie partout, même dans les pires conditions. Ses deux premiers récits sont donc aussi pleins de cette vie intime quotidienne, car l’écriture de Scholastique est aussi faite de cela, comme si sous sa plume tout devait reprendre vie, elle retrace son enfance raconte le travail au champ, le voisinage des éléphants et des léopards, la vie qui se reconstruit, l’école aussi, les nouveaux amis qu’on s’y fait, l’enfance ordinaire, les bonheurs ordinaires, Candida la meilleure copine, l’école encore et les livres qui ouvrent l’horizon, et parallèlement c’est toute une culture, presque une anthropologie de ce Rwanda des années 60 qui se dresse là dans ses récits et roman, avec l’école, le mariage, l’église, avec la lessive et les baignades dans le lac, les recettes de cuisine familiale, la fabrique du pain, les jours de fête ou l’on fabrique l’urwarwa, la bière de banane, le champs encore, l’utilisation des plantes médecinales, les histoires et légendes contées par la mère, à travers ces récits de la vie au village, avec tout ça elle explique et transmet toute une culture, toute une organisation socio-familiale.
Nyamata c’était tout ça mais aussi la vie quotidienne, les souvenirs heureux, comment la vie continuait, s'agençait malgré tout, parce qu’il y a ça que l’Homme est plus fort malgré tout, qu’il a cette capacité-là de recréer la vie partout, même dans les pires conditions. Ses deux premiers récits sont donc aussi pleins de cette vie intime quotidienne, car l’écriture de Scholastique est aussi faite de cela, comme si sous sa plume tout devait reprendre vie, elle retrace son enfance raconte le travail au champ, le voisinage des éléphants et des léopards, la vie qui se reconstruit, l’école aussi, les nouveaux amis qu’on s’y fait, l’enfance ordinaire, les bonheurs ordinaires, Candida la meilleure copine, l’école encore et les livres qui ouvrent l’horizon, et parallèlement c’est toute une culture, presque une anthropologie de ce Rwanda des années 60 qui se dresse là dans ses récits et roman, avec l’école, le mariage, l’église, avec la lessive et les baignades dans le lac, les recettes de cuisine familiale, la fabrique du pain, les jours de fête ou l’on fabrique l’urwarwa, la bière de banane, le champs encore, l’utilisation des plantes médecinales, les histoires et légendes contées par la mère, à travers ces récits de la vie au village, avec tout ça elle explique et transmet toute une culture, toute une organisation socio-familiale.
Mais tout cela est nécessairement emprunt d’un parfum de nostalgie car on sait déjà quand et comment tout va disparaitre.
Le génocide Scholastique Mukasonga en parle. Elle distille son horreur par de petites phrases tout au long de ses récits : « c’est là qu’on l’a tué avec ma mère »[9], « en 1994 on s’est acharné sur la vieille dame. Je ne dirais pas comment on l’a humilliée, violée, suppliciée. »[10], « ce n’est pas ce matin-là qu’on l’a tué, c’est vingt ans plus tard »[11] « en 1994, ils étaient toujours là, au bout de notre champ. Qu’ont-ils vu ? Qu’ont-ils fait ? »[12]. C’est lancinant, c’est là, ça ne s’oublie jamais. Mais elle fait également appel à la mémoire des rescapés, elle assemble des bouts de témoignages recueillis parmi les quelques survivants de sa famille, ceux qui été là à Nyamata en 1994, qui ont souffert dans leur corps, ceux dont les yeux ont vue les pires atrocités perpétrées sur leurs plus proches, qui n’en sont pas sortis indemnes mais qui sont là aujourd’hui, ces récits de l’horreur brute qu’elle dit vouloir écrire avec ses larmes, qui décrivent les horreurs subies, une sœur mutilée, les corps sans sépulture, les corps qu’on ne retrouvent pas, les récits qui se taisent, finalement, interrompus brutalement parce qu’ils ne peuvent plus dire l’horreur quand elle est au-delà de l’imaginable.
Alors dans Inyezi ou les cafards elle nomme chacun, ceux dont elle se souvient. Elle re-parcourt la route de son village, physiquement lors d’un retour en 2004 et mentalement en revoyant ce qui était et qui n’est plus, elle marche sur cette route et désigne les maisons qui ne sont plus là que dans son souvenir, se rappellent de ceux qui vivaient là, elle les nomme comme pour crier le nom des disparus, et redonne un souvenir à chacun, si ce n’est pour les faire revivre, au moins pour les sauver de l’oubli, de l’annihilation complète.
Car c’est bien de ça, toujours, dont il est question dans le travail de Scholastique Mukasonga, la mémoire et la dignité des disparus.
Aurélie Torre
[1] Inyenzi ou les cafards, p58, Editions Gallimard
[2] Inyenzi ou les cafards, p12, Editions Gallimard
[3] Inyenzi ou les cafards, p24, Editions Gallimard
[4] Inyenzi ou les cafards, p53, Editions Gallimard
[5] Inyenzi ou les cafards, p47, Editions Gallimard
[6] Inyenzi ou les cafards, p54, Editions Gallimard
[7] Inyenzi ou les cafards, p82, Editions Gallimard
[8] Inyenzi ou les cafards, p83, Editions Gallimard
[9] Inyenzi ou les cafards, p83, Editions Gallimard
[10] Inyenzi ou les cafards, p83, Editions Gallimard
[11] Inyenzi ou les cafards, p120, Editions Gallimard
[12] Inyenzi ou les cafards, p136, Editions Gallimard
 Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
Alors que le monde entier célèbre le vingtième anniversaire du tragique génocide rwandais, au Burundi, on déplore le vingtième anniversaire d’un assassinat. Celui de Melchior Ndadaye, président du Burundi de juin à octobre 1993, qui faisait partie de la majorité Hutu. Une tentative de coup d’Etat suivie de près par le massacre de milliers de Tutsi, minoritaires au Burundi, puis d’une escalade de violence qui fait écho à celle qui sévissait au Rwanda à la même période. Frontalier du Rwanda, avec lequel il partage certains aspects démographiques, le Burundi a lui aussi été le théâtre de massacres entre Hutu et Tutsi. Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Bujumbura au moment des faits, le Dr Mouhtare Ahmed revient sur les constats réalisés par une équipe de l'ONU dépêchée sur les lieux entre 1994 et 1995, et sur sa propre expérience.
Ndadaye : « ils ont tué Ndadaye, mais ils n’ont pas tué tous les Ndadaye ».


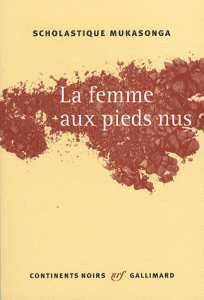
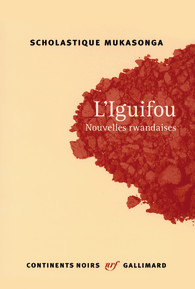 Notre-Dame du Nil est un tissage de petites scènes légères, anodines, drôles ou plus graves de la vie dans le lycée, la vie quotidienne faite des cours, des tâches, des repas, des amourettes et des visites le dimanche au tailleur ou aux guérisseurs de la région mais aussi les évènements singuliers, ceux qui marquent la vie réglée des pensionnaires, comme l’arrivée de professeurs français hippies dans ce lycée de haute morale, la grossesse de l’une des élèves, le jour de la fête du lycée à la source Notre-Dame du Nil, une visite aux gorilles, habitant des forêts voisines, celle tant espéré, tant rêvé de la reine belge, Notre-Dame du Nil est un tissage de tout ça et, dans le même temps, entrelacée, la menace qui pèse sur les Tutsi du lycée, menace de plus en plus prégnante, de plus en plus lourde et précise.
Notre-Dame du Nil est un tissage de petites scènes légères, anodines, drôles ou plus graves de la vie dans le lycée, la vie quotidienne faite des cours, des tâches, des repas, des amourettes et des visites le dimanche au tailleur ou aux guérisseurs de la région mais aussi les évènements singuliers, ceux qui marquent la vie réglée des pensionnaires, comme l’arrivée de professeurs français hippies dans ce lycée de haute morale, la grossesse de l’une des élèves, le jour de la fête du lycée à la source Notre-Dame du Nil, une visite aux gorilles, habitant des forêts voisines, celle tant espéré, tant rêvé de la reine belge, Notre-Dame du Nil est un tissage de tout ça et, dans le même temps, entrelacée, la menace qui pèse sur les Tutsi du lycée, menace de plus en plus prégnante, de plus en plus lourde et précise.
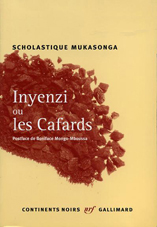 La responsabilité des colonisateurs est symbolisée par deux personnages très important dans le roman. Le Père Herménégilde d’une part qui est fier « d’avoir contribué à la révolution sociale qui avait aboli le servage et les corvées. S’il ne faisait pas partie des signataires du Manifeste des Bahutu de 1957, il en était, et cela sans se vanter, l'un des principaux inspirateurs »
La responsabilité des colonisateurs est symbolisée par deux personnages très important dans le roman. Le Père Herménégilde d’une part qui est fier « d’avoir contribué à la révolution sociale qui avait aboli le servage et les corvées. S’il ne faisait pas partie des signataires du Manifeste des Bahutu de 1957, il en était, et cela sans se vanter, l'un des principaux inspirateurs »
 Car même si elle est de tradition orale, il semble que la parole ne suffise plus là où il y a eu génocide, que la transmission orale ne peut raconter l’irracontable. Avec le génocide on rentre dans le domaine de l’indicible. Elle pense au journal d’Ann Frank, elle visite le mémorial de Caen. Son cahier d’écolier ne la quitte plus, elle écrit, des mots qui sortent comme du venin de son corps.
Car même si elle est de tradition orale, il semble que la parole ne suffise plus là où il y a eu génocide, que la transmission orale ne peut raconter l’irracontable. Avec le génocide on rentre dans le domaine de l’indicible. Elle pense au journal d’Ann Frank, elle visite le mémorial de Caen. Son cahier d’écolier ne la quitte plus, elle écrit, des mots qui sortent comme du venin de son corps.
 Nyamata c’était tout ça mais aussi la vie quotidienne, les souvenirs heureux, comment la vie continuait, s'agençait malgré tout, parce qu’il y a ça que l’Homme est plus fort malgré tout, qu’il a cette capacité-là de recréer la vie partout, même dans les pires conditions. Ses deux premiers récits sont donc aussi pleins de cette vie intime quotidienne, car l’écriture de Scholastique est aussi faite de cela, comme si sous sa plume tout devait reprendre vie, elle retrace son enfance raconte le travail au champ, le voisinage des éléphants et des léopards, la vie qui se reconstruit, l’école aussi, les nouveaux amis qu’on s’y fait, l’enfance ordinaire, les bonheurs ordinaires, Candida la meilleure copine, l’école encore et les livres qui ouvrent l’horizon, et parallèlement c’est toute une culture, presque une anthropologie de ce Rwanda des années 60 qui se dresse là dans ses récits et roman, avec l’école, le mariage, l’église, avec la lessive et les baignades dans le lac, les recettes de cuisine familiale, la fabrique du pain, les jours de fête ou l’on fabrique l’urwarwa, la bière de banane, le champs encore, l’utilisation des plantes médecinales, les histoires et légendes contées par la mère, à travers ces récits de la vie au village, avec tout ça elle explique et transmet toute une culture, toute une organisation socio-familiale.
Nyamata c’était tout ça mais aussi la vie quotidienne, les souvenirs heureux, comment la vie continuait, s'agençait malgré tout, parce qu’il y a ça que l’Homme est plus fort malgré tout, qu’il a cette capacité-là de recréer la vie partout, même dans les pires conditions. Ses deux premiers récits sont donc aussi pleins de cette vie intime quotidienne, car l’écriture de Scholastique est aussi faite de cela, comme si sous sa plume tout devait reprendre vie, elle retrace son enfance raconte le travail au champ, le voisinage des éléphants et des léopards, la vie qui se reconstruit, l’école aussi, les nouveaux amis qu’on s’y fait, l’enfance ordinaire, les bonheurs ordinaires, Candida la meilleure copine, l’école encore et les livres qui ouvrent l’horizon, et parallèlement c’est toute une culture, presque une anthropologie de ce Rwanda des années 60 qui se dresse là dans ses récits et roman, avec l’école, le mariage, l’église, avec la lessive et les baignades dans le lac, les recettes de cuisine familiale, la fabrique du pain, les jours de fête ou l’on fabrique l’urwarwa, la bière de banane, le champs encore, l’utilisation des plantes médecinales, les histoires et légendes contées par la mère, à travers ces récits de la vie au village, avec tout ça elle explique et transmet toute une culture, toute une organisation socio-familiale.
 Genocide is not a crime as any other. While the other forms of conflicts meet political and economic interests, genocide is a concerted plan in view of eliminating the members of a given group. Genocide aims to “purify” the social group by removing the elements regarded as unworthy to be part of it: Jews in Germany, Blacks in South Africa
Genocide is not a crime as any other. While the other forms of conflicts meet political and economic interests, genocide is a concerted plan in view of eliminating the members of a given group. Genocide aims to “purify” the social group by removing the elements regarded as unworthy to be part of it: Jews in Germany, Blacks in South Africa