Des élections présidentielles auront lieu au Mali, ce dimanche 28 Juillet 2013. Après deux ans de crise, et quelques mois seulement après la reprise en main du pays par les forces françaises, maliennes et africaines. Etait-ce si urgent d'organiser les élections aussi rapidement? Les candidats ont-ils eu le temps de préparer correctement ces élections? Les Maliens se dépalceront-ils? Quelle légitimité aura ce scrutin? Autant de questions examinées dans cet article de V. Rouget.
En campagne, toutes ! Le7 juillet a marqué le coup d’envoi officiel de la campagne électorale malienne en vue des élections présidentielles du 28 juillet. Les premiers meetings, tels que ceux d’Ibrahim Boubacar Keita (à Bamako), de Soumaïla Cissé (Mopti) ou de Dramane Dembélé (Sikasso) ont démarré en fanfare. Pendant trois semaines, les 28 candidats vont sillonner le pays et tenter d’apparaître aux yeux des électeurs maliens comme l’homme providentiel capable de relever le pays. Pour la femme providentielle, on repassera : la seule candidate (et nordiste qui plus est), Aïssata Haïdara Cissé, ne possède qu’une chance infime de l’emporter…
 Au début de l’année, dans l’enthousiasme général consécutif à la libération du Nord-Mali, les autorités de transition annonçaient la tenue d’élections en juillet, destinées à tourner pour de bon cette page sombre de l’histoire malienne. Depuis, l’enthousiasme a laissé la place au scepticisme et à l’inquiétude : est-il vraiment réaliste de vouloir organiser un scrutin national dans un délai aussi court ? Des doutes qui s’immiscent même parmi les candidats : ainsi, Tiébilé Dramé, candidat du PARENA (et par ailleurs responsable des négociations de Ouagadougou avec le MNLA ces derniers mois), a déposé en début de semaine une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander l’ajournement des élections.
Au début de l’année, dans l’enthousiasme général consécutif à la libération du Nord-Mali, les autorités de transition annonçaient la tenue d’élections en juillet, destinées à tourner pour de bon cette page sombre de l’histoire malienne. Depuis, l’enthousiasme a laissé la place au scepticisme et à l’inquiétude : est-il vraiment réaliste de vouloir organiser un scrutin national dans un délai aussi court ? Des doutes qui s’immiscent même parmi les candidats : ainsi, Tiébilé Dramé, candidat du PARENA (et par ailleurs responsable des négociations de Ouagadougou avec le MNLA ces derniers mois), a déposé en début de semaine une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander l’ajournement des élections.
Une élection sous pression
En accédant à sa demande, la Cour manifesterait là un beau signe d’indépendance. Mais il n’y a guère d’espoir que les juges suprêmes fassent preuve d’une telle audace, tant les pressions pour maintenir la date du scrutin sont fortes. Dioncounda Traoré a une nouvelle fois confirmé la date de l’élection ce mardi 9 juillet… tout en reconnaissant les nombreux problèmes qui subsistent : « il ne saurait y avoir d’élection parfaite et surtout dans un pays qui vient de sortir d’une crise profonde (…) les imperfections du processus électoral peuvent être compensées par l’esprit civique des candidats et des électeurs ». En lisant ces lignes, on se demande si le Président par intérim n’essaie pas avant tout de se convaincre lui-même qu’il ne mène pas le Mali droit dans le mur.
C’est qu’il n’a pas vraiment le choix, Dioncounda. Sa marge de manœuvre est étroitement limitée par ses partenaires internationaux. La France, en premier lieu, qui attend avec impatience de pouvoir annoncer la fin de la transition, rapatrier le gros de ses soldats, crier « mission accomplie ! » et se gargariser des succès de sa glorieuse armée, capable d’éviter dans le Nord-Mali un scénario à l’afghane. Les Etats-Unis, justement, sont aussi pressés de retrouver au Mali un interlocuteur adoubé par le suffrage universel. Comme d’autres bailleurs de fonds, ils attendent de pouvoir relancer leurs projets de développement, leurs procédures interdisant de financer un gouvernement qui ne soit pas démocratiquement élu. A ces pressions étatiques s’ajoutent d’autres, plus discrètes, venant du secteur privé: la reconstruction du Nord-Mali, c’est aussi l’occasion de juteux contrats d’investissements, qui ne tarderont pas à tomber une fois un nouveau gouvernement constitué. Ainsi, les entreprises occidentales déjà positionnées sur ce marché de l’après-conflit suivent de près la préparation des élections. En témoigne la réunion tenue début juillet entre plusieurs ministres maliens et des représentants du MEDEF français.
Une élection prématurée
Le Mali vient donc de commencer un sprint électoral de trois semaines, sans réellement avoir eu le temps de se mettre en place dans les starting-blocks. Nombreux sont les problèmes qui auraient dû justifier un report du scrutin de quelques semaines.
La saison, tout d’abord : l’élection va se dérouler en plein milieu de la période d’hivernage, alors que 70% de la population malienne, encore largement rurale, est occupée à travailler dans les champs. Dans plusieurs régions soumises aux crues du Niger, les déplacements vers les bureaux de vote pourront être difficiles, voire totalement impossibles. A cela s’ajoute le Ramadan : toute la campagne présidentielle et les opérations de vote vont avoir lieu en période de jeûne.
Plus important, la préparation des élections est considérablement gênée par des erreurs techniques et administratives. Les archives municipales de plusieurs localités du Nord ont été détruites pendant les combats, et certains villages ne comptent plus qu’une poignée d’électeurs sur leurs listes ; les cartes d’électeurs biométriques NINA sont délivrées aux mauvaises localités, ou n’arrivent pas dans les délais prévus ; les quelque 350 000 mineurs arrivés en âge de voter depuis le précédent recensement de 2010 n’ont pas tous été ajoutés au fichier électoral ; environ 175 000 Maliens se trouvent encore dans des camps de réfugiés en Mauritanie, au Burina Faso et au Niger, et malgré tous les efforts de l’ONU, beaucoup n’auront certainement pas la possibilité de voter… Tous ces détails, à grande échelle, commencent à peser et engendreront très certainement des frustrations le 28 juillet, lorsque des électeurs se verront refuser l’accès aux bureaux de vote.
Enfin, et surtout, la question de Kidal et des régions du nord reste insoluble. L’accord signé à Ouagadougou le 18 juin entre le MNLA/HCUA et le gouvernement malien n’a que partiellement déverrouillé la situation, et il a fallu attendre ce vendredi 5 juillet pour voir l’armée malienne se réinstaller dans la ville. Les soldats s’y sont déjà heurtés à plusieurs manifestations d’hostilité ce week-end ; le gouverneur de Kidal est encore bloqué à Bamako « pour des raisons de sécurité », et tout porte à croire que les cartes NINA et le matériel électoral ne seront pas déployés à temps pour permettre aux électeurs de la région de participer au premier tour le 28 juillet. Au vu des tensions actuelles, il ne serait pas étonnant que nombre des 28 candidats évitent soigneusement d’aller faire campagne dans la région. Sur le plan démographique et géographique, Kidal n’est qu’un grain de sable perdu dans le désert, 67 000 habitants dispersés sur une surface de 260 000 km². Mais un grain de sable ô combien symbolique pour le Mali. C’est de là qu’est partie la rébellion du MNLA à la fin de 2011 (ainsi que les deux précédentes rébellions touareg, en 1990 et 2006) ; l’opération Serval, efficace contre les groupes terroristes, a laissé intact l’enjeu principal du Nord-Mali, à savoir la place des populations touareg dans la nation malienne. Ainsi, Kidal est aujourd’hui le baromètre de l’évolution du Mali post-conflit. Quelques semaines de plus auraient pu permettre aux populations du Nord de voter et ainsi d’effectuer le premier pas d’une réintégration dans la vie politique nationale qui s’annonce si difficile. Mais les autorités de Bamako ne semblent pas disposées à accorder ce délai supplémentaire. Dès lors, c’est tout le processus de réconciliation qui se retrouve en péril : comment peut-on envisager de remettre une région séparatiste dans le giron de l’Etat si on l’empêche de donner sa voix, d’exprimer ses ambitions et sa vision pour cet Etat reconstitué ?
Une élection dénaturée ?
Ces trois problèmes viennent empoisonner la préparation des élections. Sans doute, la présidentielle malienne se déroulera sans violences ouvertes ; une dérive « à l’ivoirienne » n’est a priori pas d’actualité, et les problèmes énoncés ci-dessus ne déboucheront pas sur un bain de sang. Ce critère doit-il pour autant être le seul pris en considération lorsqu’il s’agit de fixer un calendrier électoral de sortie de crise ? Un scrutin sans affrontements meurtriers est-il nécessairement un scrutin réussi ? Tristement, l’élection malienne est en train d’être travestie, de perdre son sens premier, celui d’une consultation populaire réunissant toutes les communautés maliennes à un moment charnière, pour ne devenir qu’un élément d’une to-do-list bureaucratique, une étape de plus dans un schéma préconçu de transition post-conflit. Là où une élection bien préparée aurait constitué un véritable évènement refondateur, le pari a été fait d’une élection rapide. Le risque que les plaies ouvertes par ces derniers mois de crise ne se résorbent pas totalement est là, bien réel.
Alors, quelles portes de sortie reste-t-il aujourd’hui, alors que les élections se rapprochent à grands pas ? Seule la Cour constitutionnelle a encore l’autorité pour entraîner un report, et une seule hypothèse pourrait lui faire prendre une telle décision : Dioncounda Traoré, ne voulant se mettre la communauté internationale à dos en prenant seul la décision d’un report, aurait-il négocié avec la Cour constitutionnelle pour qu’elle accède à la requête de Tiébilé Dramé (un proche de Dioncounda), le report apparaissant ainsi comme une décision judiciaire indépendante ? Le scénario apparaît tout de même improbable, et en l’absence d’un tel jeu de poker menteur, les élections auront vraisemblablement bien lieu ; on ne peut alors qu’espérer qu’elles ne tourneront pas au fiasco.
L’occasion était pourtant belle : alors que d’ordinaire les Maliens se distinguent par des taux de participation électorale extrêmement faibles (environ 25% aux élections présidentielles et législatives de 2002 et 2007), l’échéance de juillet suscite les débats et attire les foules, bien au-delà de tout ce qu’avaient réussi les nombreuses initiatives de sensibilisation citoyenne avant les précédentes élections. C’est donc d’autant plus dommage que cet engouement démocratique soit « pollué » par des problèmes techniques ou administratifs que l’on aurait facilement pu résoudre avec quelques semaines supplémentaires de préparation.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On aurait aimé que les autorités maliennes retiennent la leçon.

 Ce qui est advenu en Egypte, le 3 juillet, est un coup d'Etat – en tout cas si l'on se tient à une définition assez vague qui voit dans le coup un moyen de prendre le pouvoir par la force. La vraie question était de savoir si ce coup d'Etat était de la catégorie qui marque les pages les moins glorieuses de l'histoire d'une nation ou si l'on en parlerait comme une étape indispensable à la construction de la démocratie en Egypte.
Ce qui est advenu en Egypte, le 3 juillet, est un coup d'Etat – en tout cas si l'on se tient à une définition assez vague qui voit dans le coup un moyen de prendre le pouvoir par la force. La vraie question était de savoir si ce coup d'Etat était de la catégorie qui marque les pages les moins glorieuses de l'histoire d'une nation ou si l'on en parlerait comme une étape indispensable à la construction de la démocratie en Egypte.
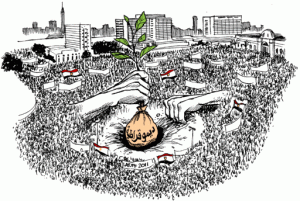 Il y a une importante contradiction entre les valeurs défendues, il y a un peu plus d’un an, sur la place Tahrir, et les revendications actuelles. Si on parle de valeurs démocratiques, il ne faut pas se contenter d’en saisir la moitié. Il est vrai que la démocratie doit permettre d’instaurer un gouvernement élu à la majorité, mais il est aussi vrai qu’une fois ce gouvernement élu, il est légitime jusqu’à la fin de son mandat. Ce point reste essentiel pour qu’une tradition démocratique puisse subsister dans un pays qui n’a connu que des dictatures jusque-là.
Il y a une importante contradiction entre les valeurs défendues, il y a un peu plus d’un an, sur la place Tahrir, et les revendications actuelles. Si on parle de valeurs démocratiques, il ne faut pas se contenter d’en saisir la moitié. Il est vrai que la démocratie doit permettre d’instaurer un gouvernement élu à la majorité, mais il est aussi vrai qu’une fois ce gouvernement élu, il est légitime jusqu’à la fin de son mandat. Ce point reste essentiel pour qu’une tradition démocratique puisse subsister dans un pays qui n’a connu que des dictatures jusque-là.
 Lors du discours d’inauguration de la nouvelle coalition, Tom Ikimi, le président du « comité de fusion » de l’ACP, a proclamé : « Un changement radical n’a jamais été aussi urgent dans la vie de notre pays… Nous, les partis suivants – respectivement le ACN (Le congrès d’action du Nigéria), l’ANPP (Le Parti de tout le peuple nigérian), l’APGA (La Grande Alliance Progressiste) et le CPC (Le Congrès pour le Changement Progressiste) – avons décidé de fusionner sur le champ pour devenir l’ACP afin d’offrir à notre peuple assiégé une recette de paix et de prospérité. »
Lors du discours d’inauguration de la nouvelle coalition, Tom Ikimi, le président du « comité de fusion » de l’ACP, a proclamé : « Un changement radical n’a jamais été aussi urgent dans la vie de notre pays… Nous, les partis suivants – respectivement le ACN (Le congrès d’action du Nigéria), l’ANPP (Le Parti de tout le peuple nigérian), l’APGA (La Grande Alliance Progressiste) et le CPC (Le Congrès pour le Changement Progressiste) – avons décidé de fusionner sur le champ pour devenir l’ACP afin d’offrir à notre peuple assiégé une recette de paix et de prospérité. »
 En effet, les deux protagonistes majeurs de l’APC –
En effet, les deux protagonistes majeurs de l’APC – 







