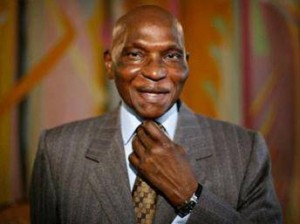 Sous-couvert de patriotisme et de la volonté de sauver son parti, Abdoulaye Wade est rentré au Sénégal. Après avoir disparu de la scène politique pendant 2 ans, il a fait un retour remarqué au Sénégal le vendredi 25 avril 2014. L’ancien Président sénégalais avait quitté son pays pour la France après avoir perdu l’élection présidentielle du 25 mars 2012 face à son ancien Premier Ministre Macky Sall. Son retour a été marqué par quelques péripéties lors de son escale à Casablanca, puisque son arrivée à Dakar a été reportée à plusieurs reprises sans fondement à l’en croire, et pour défaut d’autorisations selon les autorités sénégalaises. Quoi qu’il en soit, le Pape du Sopi a encore accompli, à 88 ans, une démonstration de sa capacité de mobilisation, et surtout de sa position centrale au Parti Démocratique Sénégalais (PDS).
Sous-couvert de patriotisme et de la volonté de sauver son parti, Abdoulaye Wade est rentré au Sénégal. Après avoir disparu de la scène politique pendant 2 ans, il a fait un retour remarqué au Sénégal le vendredi 25 avril 2014. L’ancien Président sénégalais avait quitté son pays pour la France après avoir perdu l’élection présidentielle du 25 mars 2012 face à son ancien Premier Ministre Macky Sall. Son retour a été marqué par quelques péripéties lors de son escale à Casablanca, puisque son arrivée à Dakar a été reportée à plusieurs reprises sans fondement à l’en croire, et pour défaut d’autorisations selon les autorités sénégalaises. Quoi qu’il en soit, le Pape du Sopi a encore accompli, à 88 ans, une démonstration de sa capacité de mobilisation, et surtout de sa position centrale au Parti Démocratique Sénégalais (PDS).
Volontairement ou involontairement, il a revêtu le manteau de la victime lors de son escale de 48 heures à Casablanca, en faisant croire à l’opinion publique que les autorités sénégalaises ont tenté d’empêcher son retour. Ces dernières ont pour leur part évoqué des questions de procédures pour expliquer le report de son vol. Il aurait ainsi modifié le personnel qui avait été initialement annoncé et changé d’appareil entre autres manœuvres, entraînant alors des vérifications supplémentaires pour l’autoriser à atterrir à Dakar. L’opinion la mieux partagée sur cet épisode est que quelqu’un, du côté de Wade ou du pouvoir, a délibérément provoqué ce retard. Tout étant bien qui finit bien, Wade a été accueilli par une importante foule de partisans et de sympathisants dans la capitale sénégalaise. Dans un élan d’enthousiasme, il a déclaré que le régime actuel était incapable de satisfaire les aspirations des Sénégalais et que son fils, Karim Wade, en détention préventive dans le cadre d’une enquête pour enrichissement illicite, en est le seul capable. Mais au-delà de ces aspects épisodiques, deux grands enseignements peuvent être tirés de son come-back :
1) Le Parti démocratique sénégalais est en essoufflement
Selon ses propres termes, Abdoulaye Wade est revenu pour sauver le PDS, qu’il a fondé il y a 40 ans. Le PDS connaît en effet une importante saignée depuis deux ans car beaucoup de ténors du parti l’ont quitté : Pape Diop, qui fut Maire de Dakar, Président de l’Assemblée Nationale ainsi que Président du Sénat sous sa bannière, a quitté le navire pour créer la Convergence démocratique Bokk Gis Gis ; Abdoulaye Baldé, Maire de Ziguinchor (Sud) et plusieurs fois Ministre sous Wade a fait de même en créant l’Union des Centristes du Sénégal (UCS) ; Aida Mbodj, Maire de Bambey (Centre) et plusieurs fois Ministre sous Wade a créé un courant politique et a brillé par son absence à l’accueil de l’ancien Président ; tandis que d’autres anciens responsables du parti ont simplement rejoint le pouvoir actuel, comme Kalidou Diallo, Awa Ndiaye, Ousmane Seye, etc.
Tous ces départs témoignent d’une grande désaffection à l’égard du PDS et, in fine, de sa perte de vitalité depuis la défaite de 2012. Cela est probablement dû au fait qu’Abdoulaye Wade, comme les membres du PDS le disent souvent, est la seule constante dans ce parti. En d’autres termes, il y décide de tout et le parti ne peut pas fonctionner sans lui, du fait du centralisme qui y a prévalu depuis toujours. Ainsi, il semble que personne d’autre n’est apte à diriger le parti à part lui, puisque son leadership est le seul qui y prévaut. La volonté de Wade de sauver le PDS, à deux mois des élections locales prévues en juin 2014, est consécutive à un essoufflement de son parti qui s’est émietté.
2) Wade cherche un second souffle
Abdoulaye Wade est conscient du désamour que les Sénégalais lui ont exprimé le 25 mars 2012. Il a fait 26 ans d’opposition, dirigé le Sénégal pendant 12 ans, et aura certainement été l’un des personnages les plus marquants de la vie politique sénégalaise. Mais il lui reste un ultime combat : Karim Wade, son fils. En prison depuis près d’un an dans le cadre d’une enquête pour enrichissement illicite, Karim Wade a été l’une des principales causes de sa défaite, du fait des lourds soupçons sur Abdoulaye Wade de vouloir lui transmettre le pouvoir. L’ancien Président sénégalais ne semble pas pour autant avoir renoncé à l’idée de voir son fils occuper le fauteuil présidentiel, comme il l’a lui-même laissé entendre dans sa déclaration au siège du PDS le soir de son retour. Il souhaite en fait le positionner comme le seul adversaire crédible contre Macky Sall. Et pour ce faire, Abdoulaye Wade cherche un second souffle. Il souhaite remettre sur pied le Parti démocratique sénégalais en faisant revenir les responsables qui l’ont quitté, et surtout en réunifiant la famille libérale. Dans son esprit, Idrissa Seck (Maire de Thiès, Président du Rewmi, et ancien Premier Ministre sous Wade), Pape Diop, Abdoulaye Baldé et… Macky Sall peuvent tous se retrouver pour reconstituer le PDS. Il considère qu’ils proviennent de la même famille libérale qu’il a fondée et doivent pouvoir revenir dans ce parti. Cette réunification servirait bien entendu la cause de son fils biologique, Karim Wade, qu’il rêve de voir diriger le Sénégal. Pour lui, personne d’autre n’en est capable.
Il faut reconnaître à Wade le mérite de vouloir sauver son parti et son fils à un moment aussi difficile. Il faut cependant le faire revenir à la raison : ce rêve est purement utopique. Le PDS a fait sous son règne une gestion calamiteuse des ressources publiques en multipliant les scandales financiers. Ses responsables faisaient preuve d’une grande arrogance vis-à-vis des Sénégalais. Karim Wade a été traité de tous les noms d’oiseaux par les Sénégalais qui lui reprochaient d’avoir été trop associé à la gestion du pouvoir. Il a été à la tête de plusieurs ministères importants et a provoqué beaucoup de frustration dans les rangs du PDS même. Il est de plus soupçonné d’avoir détourné des centaines de milliards de francs CFA par une bonne frange du peuple. Peut-il dès lors prétendre être un martyr du simple fait que la justice de son pays le poursuit ? La réponse est non ! Son père peut-il lui servir tout le PDS sur un plateau ? Même réponse négative ! Karim Wade, à son corps défendant, doit rendre compte de la gestion des deniers publics qu’il a effectuée, et expliquer la provenance de son patrimoine. Cela prendra le temps qu’une bonne administration de la justice nécessite. Pour l’heure, il est utopique de vouloir rassembler la famille libérale : les courants idéologiques ne sont pas déterminants dans la vie politique sénégalaise. Ce qui peut paraître comme un retour en héros du Pape du Sopi, et qu’Abdoulaye Wade regarde avec un zeste d’aveuglement comme une occasion de sauver son parti et son fils, témoigne en réalité d'un essoufflement du PDS.
Mouhamadou Moustapha MBENGUE


 Mamadou Cissokho est Président du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux du Sénégal (CNCR) et du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
Mamadou Cissokho est Président du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux du Sénégal (CNCR) et du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest (ROPPA).






