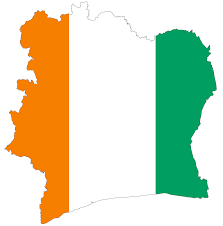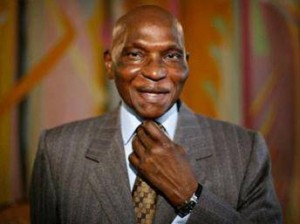Malgré les avancées considérables consenties en matière de démocratisation, force est d’admettre certains faits têtus qui caractérisent l’espace politique en Afrique Sub-saharienne. Le processus de démocratisation s’est déroulé dans un apprentissage difficile marqué par un tribalisme politique menaçant , un détournement d’objectif alarmant , et, in fine, la non satisfaction des besoins socioéconomiques des populations .
Malgré les avancées considérables consenties en matière de démocratisation, force est d’admettre certains faits têtus qui caractérisent l’espace politique en Afrique Sub-saharienne. Le processus de démocratisation s’est déroulé dans un apprentissage difficile marqué par un tribalisme politique menaçant , un détournement d’objectif alarmant , et, in fine, la non satisfaction des besoins socioéconomiques des populations .
Un tribalisme politique menaçant
Le lien ethnique constitue un paramètre déterminant dans les Etats d’Afrique Sub-saharienne. Beaucoup de partis politiques se structurent suivant des clivages tribaux, régionaux ou claniques. En effet, « on cherche à s’emparer du pouvoir, non pas en fonction d’options politiques libérales ou socialistes, mais d’un clivage purement ethnique »[1]. A cet égard, il est intéressant de relater un épisode anecdotique au Cameroun où le gouvernement « a confisqué la vie à la première expérience de faculté privée de médecine créée au sein de l’université des Montagnes à l’Ouest du pays (…) la manœuvre reposait sur la volonté d’éviter que les Bamiléké ne monopolisent la formation des médecins »[2]. Lors du génocide rwandais, il a été signalé que « toute personne de telle ou telle autre ethnie qui ne montrait pas sa détermination à défendre son ethnie était considérée par cette dernière comme traître et risquait la mort. Il y en a effectivement qui sont morts tués par des gens de leur ethnie »[3]. Au Congo-Brazzaville, la politisation du fait identitaire a causé une déconsolidation des acquis démocratiques. Ainsi, « la constitution de milices basées sur des solidarités ethno-régionales et la transformation des leaders politiques en chefs de troupes tribales ont plongé le pays dans deux guerres civiles qui l’ont dévasté et mis terme à l’expérience de démocratisation »[4]. Même dans un pays comme le Bénin, les partis politiques n’ont pas été fondés sur une base nationale : «Il s’agit de partis d’obédience ethnique dont l’apparition vient aggraver ainsi les difficultés de la construction nationale (…) Certaines régions du pays sont écartées de la scène politique au niveau élevé du pouvoir (…) Mais depuis peu, les régions minoritaires sont en train de s’organiser elles aussi pour participer aux différents jeux politiques en créant leurs propres partis politiques ». Il apparaît dès lors que certains groupes ethniques qui seraient exclus de l’espace du pouvoir pendant un certain temps sont tentés de prendre leur revanche en opérant un « rattrapage ethnique » qui galvaude la cohésion nationale et remet en question les fondements mêmes de l’Etat-Nation en Afrique Sub-saharienne.
Ce phénomène est encore plus prononcé dans un pays comme la Côte d’Ivoire où les plus grands partis politiques se basent sur des allégeances purement ethniques et/ou régionales. Ainsi, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) compte dans ses rangs les Baoulé et les Agni, concentrés à l’Est et au Centre du pays. Le Rassemblement des Républicains (RDR), quant à lui, demeure le foyer des Malinké, des Gur, des Senoufo et des Lobi. Le Front Populaire Ivoirien (FPI) est l’antre des peuples de l’Ouest, notamment les Bété, les Dida, les Guéré, les Gouro. Les Abbey, les Ebrié et les Attié, eux, peuples du Sud, ont rejoint ce dernier depuis 2000 après avoir été déçus par le PDCI[5].
La prépondérance du fait ethnico-tribal dans le jeu politique s’avère donc très néfaste pour la construction de la démocratie dans des Etats où les crises post-électorales prennent souvent une coloration ethnique, régionale ou tribale. Cela est le cas en RDC, en Centrafrique, au Burundi ou encore en Guinée Conakry.
Un détournement d’objectif alarmant
Cependant, l’un des fléaux qui touchent le plus durement le processus de démocratisation en Afrique Sub-saharienne est probablement le détournement d’objectif dont il fait l’objet. Le but ultime du pouvoir politique étant la satisfaction de l’intérêt général, cet objectif a été complètement jeté aux oubliettes par les dirigeants africains. Ce détournement d’objectif s’illustre par une nette déconnection des élites par rapport aux populations et à leurs besoins. En effet, « une mauvaise compréhension, donc une mauvaise pratique de la démocratie pluraliste, a tendance, dans notre continent aussi, à couper de plus en plus des populations une classe politique qui semble s’être enfermée dans le cercle clos de luttes de positionnement »[6].
Ainsi, la démocratie apparaît sur le continent comme « un contrat de dupes, un système trop inique car au lieu de fonder une Afrique libre, il proroge paradoxalement le monolithisme archaïque »[7]. Les gouvernants africains et leur administration ont achevé d’appauvrir leurs populations en se livrant à un pillage sauvage des ressources publiques dans la plus grande opacité et la corruption généralisée. De ce fait, « l’Etat africain reste par excellence le lieu d’accumulation et demeure une source de redistribution et de profits pour la classe dirigeante. Seuls les pourvoyeurs et bénéficiaires de la rente étatique ont changé avec l’alternance politique »[8].
Par ailleurs, les avancées démocratiques notées dans les années 1990 s’estompent vers la fin de la décennie, avec la prise du pouvoir par la force de Laurent Désiré Kabila au Congo-Kinshasa, une nouvelle guerre civile au Congo-Brazzaville, une période de troubles politiques en République Centrafricaine, une répression d’opposants et de journalistes au Nigéria du Général Sani Abacha, ainsi que des tensions au Niger, au Mali, en Guinée et en Mauritanie, voire de guerre civile en Sierra Léone et au Libéria.
Le détournement d’objectif s’illustre aussi par la rapide volte-face qu’ont opérée les pouvoirs en place quelque temps après la vague pluraliste des années 1990. Beaucoup de dirigeants se sont ainsi adonnés à des modifications substantielles de leur Constitution pour pouvoir se représenter. Ce fut le cas en Guinée avec Lansana Conté en 2002, en Tunisie avec ZineAbiddine Ben Ali en 2002, au Tchad avec Idriss Déby en 2005, au Togo avec Gnassingbé Eyadéma en 2003, au Cameroun avec Paul Biya en 2008, et cela a failli être le cas au Sénégal avec Abdoulaye Wade en 2011 et au Burkina Faso avec Blaise Compaoré en 2014, n’eussent été les contestations de la rue auxquelles ils se sont heurtés. Dans d’autres pays comme le Rwanda, le Burundi, le Congo Brazzaville et la RDC, les velléités de tordre le cou aux dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats présidentiels sont légion[9].
Il apparaît dès lors que les acquis démocratiques ont été confisqués par l’élite au pouvoir contre les aspirations des peuples africains qui restent écartés de la gestion des ressources publiques.
La non satisfaction des besoins socioéconomiques des populations
Le moins que l’on puisse dire, c’est que même dans les cas où la démocratie a prévalu sur le continent, elle n’a pas pu apporter une réponse satisfaisante aux besoins socioéconomiques des populations. Ainsi, cinquante ans après les indépendances, l’Afrique reste l’une des régions du monde les plus pauvres et les plus en recul en matière de progrès social. Si on prend en compte le taux d’alphabétisation par exemple, 65 millions d’adultes Ouest-africains, soit 40% de la population adulte, ne savent ni lire ni écrire[10]. De même, selon un haut fonctionnaire sénégalais, « près de 29 millions d’enfants d’âge scolaire ne sont toujours pas à l’école et près de 159 millions de jeunes et d’adultes ne savent ni lire ni écrire »[11]. Malgré l’ouverture démocratique, le progrès social n’a pas été au rendez-vous. Selon certains auteurs, le lien entre démocratie et développement économique n’est pas encore établi et la corrélation serait non linéaire : « aux niveaux faibles de droits politiques, une augmentation de ceux-ci stimule la croissance économique. Cependant, une fois atteint un niveau modéré de démocratie, davantage de démocratie réduit la croissance »[12]. Ceci corrobore l’hypothèse de Lipset selon qui « la démocratie est liée au stade de développement économique. Concrètement cela signifie que plus un pays est prospère, plus grandes sont les chances qu’il pérennise la démocratie »[13]. En d’autres termes, la croissance économique favoriserait le processus démocratique mais l’inverse ne serait pas vérifié pour le moment, sinon de façon résiduelle, et donc non décisive pour l’Afrique.
A partir d’une situation non démocratique, la démocratie favoriserait donc effectivement la croissance économique ; cependant, à un seuil de démocratisation significative, plus de démocratie serait de nature à limiter la croissance économique. Si l’on en croit certaines études, la relation entre démocratie et développement est tributaire du contexte, des conditions initiales, et du contenu de la démocratie propre à chaque pays[14]. Le contexte africain, où la culture du partage prend le pas sur celle de l’échange chère à l’économie de marché, demeure, dans cette perspective, singulièrement réticent au processus de démocratisation. La démocratie n’a pas été un facteur réel de progrès économique.
Axelle Kabou interpellait l’intelligentsia africaine et le système néo-libéral en interrogeant : « Et si l’Afrique refusait le développement ? ». Plus de vingt ans après, malgré les taux de croissance record enregistrés sur le continent, sa question reste toujours d’actualité. Mais au-delà du développement, c’est la capacité des Etats africains à assurer leurs missions régaliennes, et même ne serait-ce que d’avoir un fonctionnement institutionnel régulier qui est mis en cause. Malgré l’adoption et la mise en place de constitutions pluralistes, l’organisation d’élections plus ou moins transparentes selon les pays, l’existence d’une société civile de plus en plus exigeante, force est de reconnaître que les principes démocratiques de base sont encore largement ignorés par la plupart des pouvoirs en place, sous fond d’ethnisme de la vie politique. Pis, les besoins socioéconomiques des populations ne sont pas satisfaits par une classe dirigeante dont la première préoccupation est son enrichissement personnel. Devant cette situation, il urge pour l’Afrique de trouver un modèle de gouvernance adapté à son héritage culturel et pertinent pour son épanouissement économique et social. Il est difficile de dire si ce modèle devrait ressembler ou non au système démocratique, car le débat sur l’universalité de ce dernier reste entier et ouvert. Mais il devra en tout cas tenir compte des énormes défis sécuritaires, environnementaux, éducatifs, et relatifs au capital humain, qui devraient être le cœur des préoccupations des pouvoirs publics, et, de plus en plus, se nourrir des principes de gouvernance essentiels au vivre-ensemble pour assurer un minimum de cohésion aux Nations africaines encore si fragiles et composites, où l’expérimentation d’un système politique fragmenté a longtemps prévalu.
Mouhamadou Moustapha Mbengue
[1]EbénézerNjohMouelle& Thierry Michalon, L’Etat et les clivages ethniques en Afrique, Abidjan, CERAP, 2011.
[2] Jean Claude Shanda TONME, La Crise de l’intelligentsia africaine, Paris, L’Harmattan, 2008.
[3] Emmanuel Ndikumana, « Ministère de la réconciliation dans un contexte de conflit tribal » in Le Tribalisme en Afrique… et si on en parlait ? Abidjan, Presses bibliques africaines, 2002.
[4] Mamadou GAZIBO, Introduction à la politique africaine, op. cit.
[5] Dieudonné Brou Koffi ; « Démocratie et tribalisme en Afrique » in Le procès de la démocratie en Afrique, sous dir. Justine Bindedou-Yoman, Paris, L’Harmattan, 2016.
[6]Sémou Pathé GUEYE, Du bon usage de la démocratie en Afrique, Dakar, NEAS, 2013.
[7] Jean-Rodrigue-Elysée EYENE MBA, Démocratie et développement en Afrique face au libéralisme : Essai sur la refondation politique, Paris, L’Harmattan, 2001.
[8] Grégoire, 1994.
[9] Olivier Bilé, La Démocratie africaine reste mal partie… Rectifions le tir !, Paris, L’Harmattan, 2016.
[10]http://www.irinnews.org/fr/report/84101/afrique-de-l-ouest-lutter-contre-les-taux-d-alphab%C3%A9tisation-les-plus-faibles-du-monde
[11]http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=22318:lafrique-a-le-taux-danalphabetisme-le-plus-eleve-au-monde-selon-un-officiel&catid=98:education
[12]Barro R. J. Determinants of Economic Growth : A cross-country empirical study. MIT Press, 1997, Cambridge Massachussetts
[13]Lipset S. M. Some social requisities of Democracy : Economic development and Political Legitimacy. The American Political Science Review, vol. 53, No 1 (March 1959.
[14]Huber E., Rueschemeyer D., & Stephens J. D., The Journal of Economic perspective.Vol. 7, No 3, 1993.