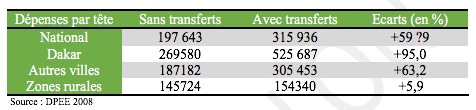Avec l’adoption de la loi 2004 -13 du 1er Févier 2004, le Sénégal était devenu le pionner de la pratique des Partenariats Public Privé (PPP) en Afrique subsaharienne. En dehors de l’Afrique du Sud, seule l’Ile Maurice pouvait se prévaloir d’avoir adopté, dans la même année, un dispositif juridique relatif aux PPP (PPP Act No. 37 of 2004). A titre de comparaison, il faut rappeler que l’Ordonnance sur les Contrats de Partenariat n’a été prise, en France, qu’au mois de Juin de l’année 2004, soit plusieurs mois après l’adoption de la loi sénégalaise.
Avec l’adoption de la loi 2004 -13 du 1er Févier 2004, le Sénégal était devenu le pionner de la pratique des Partenariats Public Privé (PPP) en Afrique subsaharienne. En dehors de l’Afrique du Sud, seule l’Ile Maurice pouvait se prévaloir d’avoir adopté, dans la même année, un dispositif juridique relatif aux PPP (PPP Act No. 37 of 2004). A titre de comparaison, il faut rappeler que l’Ordonnance sur les Contrats de Partenariat n’a été prise, en France, qu’au mois de Juin de l’année 2004, soit plusieurs mois après l’adoption de la loi sénégalaise.
Le dispositif juridique et institutionnel mis en place en 2004 au Sénégal a donc inspiré plusieurs pays africains de la sous-région. En effet, entre 2008 et 2012, l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), chargée de la mise en œuvre de la loi, a reçu plusieurs délégations africaines venant de différents pays du continent, pour s’inspirer de l’expérience sénégalaise.
Il faut souligner que les PPP sont devenus, aujourd’hui, une mode et une pratique qui se sont propagées à travers toute l’Afrique. A titre d’exemple, le Cap Vert s’est doté d’une loi PPP en 2010, Le Nigeria, le Niger et l’Angola en 2011, la Cote d’Ivoire en 2012, le Kenya et le Burkina Faso en 2013 et le Maroc en 2014 . Il est à noter que le Mali et la Gambie envisagent la même démarche. Même les institutions financières internationales telles que la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont mis en place des instruments pour la promotion des PPP. La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sont engagés dans le processus d’élaboration de directives et règlements destinés à une meilleure harmonisation de la règlementation sous régionale en matière de PPP.
En effet, ce besoin d’harmonisation du cadre juridique au plan régional est d’autant plus urgent que le concept même de PPP suscite beaucoup d’engouement et d’intérêt, mais également de controverses. D’ailleurs, certains de ses détracteurs définissent désormais l’acronyme PPP comme signifiant Problèmes, Problèmes, Problèmes.
Bref rappel historique
Pour une bonne compréhension du concept de PPP, il n’est pas sans intérêt de faire un petit rappel historique. Le Sénégal possède une vielle tradition des partenariats public privé, puisqu’en effet le premier contrat PPP serait conclu le 21 Mai 1888 à St Louis (alors capitale de l’Afrique Occidentale Française) et portait sur un service de transport par bateau à vapeur entre Dakar et Gorée. Dans les années 90, plusieurs contrats PPP, notamment dans le secteur de l’eau et de l’électricité, ont été signés au Sénégal et dans plusieurs pays en Afrique. En France, la pratique des PPP date de plusieurs siècles, soit depuis les premiers textes sur le service public publiés entre 1270 à 1789 (Voir, à cet égard, Xavier Bezancon, dans Une Approche Historique des PPP). Du point de vue juridique, ces textes concernaient essentiellement le contrat de concession ou de délégation de service public. Toutefois, la fin des années 90 allait voir cette pratique évoluer pour donner naissance à de nouvelles formes de partenariats publics privés, notamment les Private Finance Initiative (PFI) en Grande Bretagne ou les contrats de partenariat en France.
Sur la typologie des PPP
Ce bref rappel historique avait pour objectif de différencier les deux grandes familles de PPP. D’une part, les PPP de type concessif qui comprennent les délégations de services publics, les contrats d’affermage, les concessions (BOT, BOO, BOOT…) et, d’autres part, les PPP à paiements publics. Les principales différences entre ces deux familles de PPP tiennent (i) au partage des risques et des responsabilités, et (ii) à la source de rémunération de l’operateur privé (paiement public sous forme de loyer ou péage des usagers).
Au Sénégal, cette différenciation qui, pourtant, est clairement établie dans la règlementation, est encore la source de plusieurs confusions. Il faut ,en effet ,rappeler les PPP sont régis par deux régimes juridiques distincts. Les PPP de type concessif sont codifiés et relèvent du code des marchés publics, alors que les PPP à paiement public sont, désormais, régis par la loi 2014.09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat, entrée en vigueur .
En réalité, cette loi de 2014, abusivement qualifiée de loi PPP, couvre uniquement les contrats de partenariat et non les contrats de type concessif. Ce qui ajoute à la confusion, c’est que cette loi est, paradoxalement, venue abroger et remplacer la loi de 2004 dont l’objet portait principalement sur les PPP de type concessif. Le choix de faire abroger la loi 2004 par la loi de 2014, alors même que les deux textes pouvaient cohabiter et se compléter moyennant une petite mise en cohérence, est peut être à l’origine de ce manque de clarté dans la règlementation actuelle des PPP au Sénégal.
En vérité, la loi sénégalaise de 2014 s’est peut être trop inspirée de l’expérience française et de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les Contrats de Partenariat. Il est vrai qu’en France, le concept de PPP, du reste très controversé, est généralement assimilé aux contrats de partenariat.
A cet égard, il est intéressant de souligner que la Cote d’Ivoire a, pour sa part, choisi une option qui suscite moins de controverse dans la définition des concepts. Pourtant, ironie de l’histoire, c’est en 2011 que la Cote d’Ivoire est venue s’inspirer de l’expérience sénégalaise en matière de cadre juridique et institutionnel des PPP. En effet, le décret ivoirien de 2012.1151 du 19 Décembre 2012 relatif aux Contrats PPP en Cote d’Ivoire a une portée plus large et couvre toutes les formes de PPP, y compris les contrats de partenariats et les contrats de concession. Un tel choix présente l’avantage de la clarté pour les praticiens.
Sur le dispositif institutionnel des PPP
La création du Conseil National d’Appui aux PPP (CNAPPP) est, assurément, une avancée majeure du dispositif institutionnel des PPP au Sénégal, même si, un an après la réforme, le décret d’application portant organisation et fonctionnement de cet organe n’est toujours pas publié. Depuis, 2005, à la suite de l’étude Chemonics sur les potentialités de PPP au Sénégal, il avait été convenu de mettre en place une unité PPP ou « PPP Unit » pour développer une politique de partenariat à grande échelle, à l’instar des pays du monde où les PPP se sont développés avec succès.
Force est cependant de constater que le cadre institutionnel au Sénégal présente encore des insuffisances qui ne favorisent pas le développement des PPP au Sénégal. La cohabitation de deux dispositifs juridiques fait que la régulation des procédures de passations des contrats PPP relève de différentes compétences. Les PPP de type concessif tombent sous le régime des marchés publics donc sous la responsabilité de la DCMP (contrôle à priori) et de l’ARMP (contrôle à posteriori) alors que les contrats de partenariat sont assujettis à la régulation du CNAPPP (contrôle à priori) et du Conseil des Infrastructures (contrôle à posteriori).
Il est vrai que le Sénégal a été précurseur dans le domaine des PPP en Afrique. Cependant, entre 2004 et 2014, trois (03) contrats PPP seulement ont été effectivement signés et mis en œuvre. Ils concernent les projets relatifs à l’autoroute à péage, la charge à l’essieu et le contrat Construction Exploitions et Transfert (CET) de Sindia. Par contre, au mois de Septembre dernier, le Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé (CNP-PPP) de la Cote d’Ivoire, faisant le bilan deux ans après la reforme, a révélé un portefeuille de 127 PPP dont 16 déjà signés et en phase d’exécution, 80 en préparation et 31 en transaction (appels d’offres et négociations entamés). Le retard du Sénégal, pourtant pionnier dans le domaine, est donc très préoccupant, voire alarmant.
Il est donc urgent de mettre en place au Sénégal un dispositif juridique harmonisé et commun à toutes les formes de PPP. Ce dispositif devra s’appuyer sur un cadre institutionnel distinct du régime des marchés publics. Le Conseil des Infrastructures, dans sa composition et compte tenu de son expérience, offre toutes les garanties pour pleinement jouer ce rôle de régulation des contrats PPP. Cependant, son autonomie budgétaire doit être renforcée. Dans le même ordre d’idée, l’ancrage institutionnel de l’unité PPP (CNAPPP) n’offre pas aujourd’hui des garanties de pérennité et devrait faire l’objet d’un repositionnement. En somme, il faut ériger les PPP en politique de financement avec une stratégie globale et de long terme.
Abdou Salam DIAW
Expert PPP au sein de l'Agence de Promotion des Investissement du Sénégal – APIX.


 Située dans l’un des pays d’Afrique dont la stabilité politique fait figure de modèle, la région de la Casamance, est en proie depuis quelques semaines à des affaires de crimes qui ravivent des tensions que l’on pensait apaisées.
Située dans l’un des pays d’Afrique dont la stabilité politique fait figure de modèle, la région de la Casamance, est en proie depuis quelques semaines à des affaires de crimes qui ravivent des tensions que l’on pensait apaisées.






 La migration, conséquence de la répartition inégale des richesses dans le monde. Tout au long de l’histoire de l’humanité, les mouvements migratoires n’ont cessé de se succéder et semblent toucher tous les continents du monde. Ces migrations, lorsqu’elles ne sont pas forcées, résultent directement de la répartition inégale des richesses, qui poussent les personnes à aller là où sont ces richesses. Selon certains auteurs, la volonté et la capacité d’émigrer à l’étranger résultent à la fois de la personnalité et de la situation socio-économique du candidat migrant, des circuits d’informations auxquels il a accès, des réseaux migratoires, des contextes politiques et économiques des pays d’origine et d’accueil et de leurs rapports historiques. En effet il est certain que la distribution des hommes à la surface de la terre résulte pour une large part des grandes migrations qui se sont déroulées le plus souvent sur de longues périodes.
La migration, conséquence de la répartition inégale des richesses dans le monde. Tout au long de l’histoire de l’humanité, les mouvements migratoires n’ont cessé de se succéder et semblent toucher tous les continents du monde. Ces migrations, lorsqu’elles ne sont pas forcées, résultent directement de la répartition inégale des richesses, qui poussent les personnes à aller là où sont ces richesses. Selon certains auteurs, la volonté et la capacité d’émigrer à l’étranger résultent à la fois de la personnalité et de la situation socio-économique du candidat migrant, des circuits d’informations auxquels il a accès, des réseaux migratoires, des contextes politiques et économiques des pays d’origine et d’accueil et de leurs rapports historiques. En effet il est certain que la distribution des hommes à la surface de la terre résulte pour une large part des grandes migrations qui se sont déroulées le plus souvent sur de longues périodes.