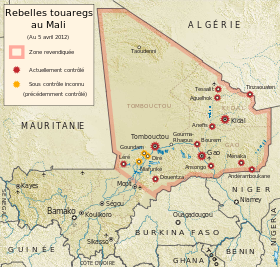Un calendrier de reformes pour la RDC
Un calendrier de reformes pour la RDC
Le lien patriarcal conserve un sens très important dans l’arène politique congolaise. Les alliances politiques se font au gré presque exclusif des appartenances ethniques et familiales. Joseph Kabila n’hésita pas à se lier à Nsanga Mobutu, fils de l’ancien Président. De même, Antoine Gizenga, qui a réuni autour de lui des fidèles de Patrice Lumumba, se fit remplacer par son propre neveu, Adolphe Muzito, qui ne fit pas mieux que lui au poste de Premier ministre. Obtenir la délivrance d’une pièce d’état civil, d’un permis de conduire, ou d’autres documents administratifs, est beaucoup plus facile lorsqu’on a un « bon » patronyme. Les liens familiaux, au sens large, régissent la vie politique et administrative, et sapent la réforme.
La corruption qui passe par les dirigeants des firmes multinationales accentue le retard. L’effondrement en 1990 d’installations minières de Kamoto (Katanga), important pan de la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), qui assure en grande partie les fonds du Trésor de la RDC, témoigne de la négligence qui gangrène le secteur minier. Y passent argent, cuivre, or, cobalt, diamant, et des centaines de milliards de dollars. Le régime Kabila, d’une manière ou d’une autre, a réussi la malicieuse prouesse de la restauration des privilèges consentis aux cartels transnationaux qui gravitent autour des richesses minières sous Mobutu.
La Barrick Gold Corporation, L’Anglo-American Corporation, l’American Diamond Buyers, De Beers, etc. n’ont rien perdu de leur superbe en ce qui concerne l’opacité de leurs opérations financières, et continuent de sucrer éperdument les politiciens et fonctionnaires véreux pour acheter leur silence. En filigrane, apparaît un véritable nouvel ordre politique et économique voulu et entretenu par les dirigeants de ces multinationales, qui n’est pas sans rappeler une certaine Conférence tenue à Berlin, en 1885. La RDC, grande comme l’Union Européenne, frontalière de neuf Etats, est toute désignée pour de telles pratiques.
Assainir le secteur minier
Une redéfinition des termes d’exploitation qui prenne mieux en compte les besoins sociaux, notamment en termes d’emplois autochtones et de considérations environnementales, s’impose, en effet, en République Démocratique du Congo. Elle doit être protégée au plan politique et administratif. Il faudrait tout d’abord exiger une prise en compte systématique des méthodes de gestion qui permettent une transparence absolue dans les documents comptables de chaque entreprise pour parvenir à un assainissement de la vie privée. Il serait ensuite très opportun d’inclure des objectifs sociaux dans les conditions d’octroi d’agrément ou d’autorisation aux firmes multinationales, pour arriver à une exploitation optimale des ressources naturelles.
L’inclusion d’une forte dose de mesures revêtant un caractère de responsabilité sociale à l’octroi de licences d’exploitation accompagnera ces entreprises dans leur recherche d’assentiment de la part des populations autochtones. Ces mesures pourraient prendre la forme d’une augmentation du nombre d’emplois de type cadre, qui soient en tout cas importants et/ou bien rémunérés, aux populations locales.
Mieux, une priorité devrait être donnée aux Congolais disposant des qualifications requises pour accroître sensiblement les effectifs nationaux dans les grandes entreprises opérant dans le pays. Cette préférence nationale devra être étroitement surveillée, et intégrée au besoin dans les textes, afin de donner aux administrations compétentes la possibilité de la faire respecter.
Beaucoup plus de mesures participatives de la part des entreprises pourraient également se décliner sous forme d’actions régulières en faveur des associations ou groupements de certaines catégories sociales (jeunes, femmes, personnes âgées) pour les accompagner dans leurs activités citoyennes. Par ailleurs, il est plus que jamais utile d’augmenter la dose écologique dans les activités d’exploitation des ressources naturelles, qui fasse en sorte que l’activité industrielle ne se nuise pas à elle-même et profite également aux générations futures.
Mieux identifier les priorités des populations
Dans le même esprit, il serait utile de mieux prendre en compte les besoins des destinataires ultimes des réformes institutionnelles et administratives. Il s’agira pour les responsables politiques et les fonctionnaires d’inclure dans leurs prévisions et actions ultérieures le besoin criant de bien-être social qui s’est installé en République Démocratique du Congo. Au lieu de lamentablement suivre les orientations des bailleurs de fonds internationaux, notamment FMI et Banque Mondiale, les responsables politiques congolais, puisqu’ils disposent de la légitimé du suffrage universel, devraient plutôt s’enquérir au préalable des réelles priorités de leur peuple. Celles-ci ne sont pas inscrites dans des théories classiques internationalement admises, elles se trouvent à peu près dans chaque localité du pays.
Dans cette optique, les compétences des fonctionnaires formés à l’exécution de chaque tâche déterminée doivent dorénavant être mobilisées pour identifier les urgences sociales qui sévissent dans chaque partie de la RDC. Une certaine harmonie devrait se mettre en place dans les différentes actions entreprises par les administrations territoriales, les organismes publics destinés à l’accompagnement des initiatives locales, et les organes politiques locaux, pour atteindre une rationalisation des initiatives publiques en faveur du développement local.
Ce dernier pourrait utilement s’inspirer ou se faire aider par les mécanismes déjà mis en place au niveau national pour attirer les investissements privés internationaux et les financements des institutions publiques internationales. En d’autres termes, la coopération décentralisée, si elle est pensée en des termes plus soucieux des priorités du peuple congolais, pourra contribuer de manière décisive à l’essor économique de la RDC. Le programme de décentralisation, inscrit dans la Constitution et qui donna lieu à des heurts violents en 2009, pourra ainsi mettre à profit l’expertise internationale en la matière pour éviter toute sclérose.
Mouhamadou Moustapha Mbengue