ADI : Comment Google accompagne le développement de l’écosystème digital en Afrique? Et surtout pourquoi le fait-il?
Nous le faisons parce que nous sommes convaincus qu’il faut que se développe dans la région un écosystème internet qui soit à la fois dynamique et très ouvert. C’est-à-dire un internet où chacun est libre de consulter le contenu qu’il veut et de le consommer comme il souhaite sans entrave. Malgré le développement que l’on observe actuellement avec l’internet mobile, cela reste insuffisant, nous ne remplissons pas tous les critères. Le débit est faible, le taux de pénétration est très faible. Je prends toujours l’exemple de la lecture d'une vidéo haute définition sans se poser de question de quotas ou de faire des pauses pour attendre que ça charge. On ne peut pas tout faire sur internet et cela coûte relativement cher.
Même ceux qui sont sur Internet n’ont pas encore un accès internet haut débit (broadband). Il y a des tendances à faire de l’internet limité qui favorise les sites web les plus populaires.  Certains fournisseurs d'accès à l'internet (FAI) proposent des packages qui ne donnent accès qu’à certains sites populaires. Par exemple si un entrepreneur quelconque lance un nouveau service, il n’est pas inclus dans le package et il n’est donc pas accessible à tout le monde. D’où notre volonté d’avoir un internet ouvert. Nous essayons donc de faire face à trois aspects :
Certains fournisseurs d'accès à l'internet (FAI) proposent des packages qui ne donnent accès qu’à certains sites populaires. Par exemple si un entrepreneur quelconque lance un nouveau service, il n’est pas inclus dans le package et il n’est donc pas accessible à tout le monde. D’où notre volonté d’avoir un internet ouvert. Nous essayons donc de faire face à trois aspects :
- Nous travaillons sur les problématiques d’accès à Internet, c’est-à-dire les problèmes d’infrastructures qui limitent l’accès, les problèmes de coût et les problèmes de politique publique (régulation) qui limitent le développement d’internet ouvert. Le haut débit à notre entendement permet un accès rapide et à tout contenu.
- Notre deuxième aspect est le contenu. Aujourd’hui, il y a du contenu dans les médias. Mais ce contenu est sous-représenté sur internet.
- Notre troisième aspect consiste à encourager les entrepreneurs à développer un secteur en croissance
Développement de l'internet en Afrique francophone / Quelle nuance entre les régions dans l’espace francophone ?
Il y a de nombreuses différences constatées en fonction des pays. Je dépasserai le cadre francophone pour aborder la situation de manière plus globale. Il est difficile de faire des généralités car il y a une cinquantaine de pays avec des spécificités et des contextes différents. Nous faisons des regroupements selon des caractéristiques précises. Et nous analysons des critères précis.
Un des premiers critères qui définit l’accès sur internet est l’état de la régulation et de la règlementation des opérateurs de télécommunications dans chaque pays. C’est cet environnement qui détermine souvent l’état du marché. Et sur cela, nous voyons énormément de différences entre l’Afrique de l’Est anglophone et l’Afrique de l’Ouest essentiellement francophone. De manière générale entre les pays francophones et anglophones, l’état de la régulation est très différent. Nous avons des régulations que je dirais très modernes. En effet, comme le secteur évolue très vite, la régulation doit avoir des mécanismes qui s’adaptent à un environnement qui change très vite, mais ce n'est pas encore le cas dans beaucoup de pays. En guise d'exemple, le Sénégal change sa régulation tous les dix ans. Il y a eu un code des télécoms mis en place en 2001 et un nouveau code des télécoms qui à ce jour n’a pas fait l’objet d’un décret d’application. Donc on évolue avec une loi de régulation qui date de 2001 sur un marché qui a beaucoup évolué depuis. La capacité du système de régulation de s’adapter au marché est un facteur de modernité.
Un deuxième aspect sur la régulation qui est très important c’est la segmentation des licences. Les régulations très anciennes (il y a 20 ans) étaient basées sur des licences monolithiques. Une seule licence valait  pour être opérateur mobile. Aujourd’hui quand on regarde les marchés des télécoms, il y a beaucoup d’opérateurs qui font des choses très différentes. Par exemple il y a des opérateurs qui font de la data (ISP), les acteurs qui développent les tours mobiles, des antennes qui les partagent ensuite aux différents opérateurs. Vous trouverez également des opérateurs qui font les infrastructures, d’autres qui font de la voix sur IP (VoIP) sur le mobile, d’autres sur le fixe.
pour être opérateur mobile. Aujourd’hui quand on regarde les marchés des télécoms, il y a beaucoup d’opérateurs qui font des choses très différentes. Par exemple il y a des opérateurs qui font de la data (ISP), les acteurs qui développent les tours mobiles, des antennes qui les partagent ensuite aux différents opérateurs. Vous trouverez également des opérateurs qui font les infrastructures, d’autres qui font de la voix sur IP (VoIP) sur le mobile, d’autres sur le fixe.
Un dernier critère de modernité dans les licences est lié au fait que les télécoms ont longtemps été conçus comme des concessions données à un tiers en vue que celui-ci donne des recettes à l’état. L’approche politique s'est longtemps focalisée sur les recettes et non pas sur l’impact du secteur des télécoms sur l’ensemble de l’économie en générale. Une régulation moderne va mesurer l’impact de chacun des actes de régulation sur le secteur des télécoms et sur l’ensemble de l’économie. Quand on regarde ces trois critères, les pays francophones restent sur des approches encore archaïques, pas très flexibles et qui ne permettent pas l’existence d’un grand nombre d’acteurs et ciblent un nombre restreint d’acteurs que l’on taxe très lourdement (Bénin, Mali, Sénégal, Cameroun, etc). Nous avons totalement l’inverse, avec un souci de bénéfices à long terme, en Afrique anglophone ou au Mozambique (en cours de procédure).
Le résultat de tous ces points crée deux critères qui distinguent les pays. Ensuite, c’est la structure du marché qui en résulte. Dans certains pays vous aurez un marché avec très peu d’acteurs qui gèrent, qui sont très intégrés verticalement et qui font tout. Prenons l’exemple du Sénégal, vous avez trois opérateurs mobiles et un FAI. Au Bénin vous avez cinq opérateurs. Prenons maintenant le Ghana : 5-6 opérateurs, une vingtaine de FAI, plusieurs acteurs qui font du contenu. Pour le Kenya, 13 fournisseurs de capacité internationale, 5 fournisseurs d’infrastructures, le secteur du mobile est peu compétitif avec Safaricom qui domine le marché (85%) mais en amont il y a plusieurs acteurs qui agissent énormément. On classe les pays selon ces trois critères : 1. l’état de la régulation, 2. la dynamique du marché et 3. L’état des infrastructures.
Le 4è critère sur l’état de l’écosystème est celui de l’ensemble des investisseurs qui occupent le marché, créent de l’emploi, de la valeur et que les gouvernements des pays Africains n’ont pas appris à appréhender et à encourager.
Sur les Marketplaces en Afrique francophone. Quels sont les moyens de paiement? Comment observez-vous l’arrivée de ces nouveaux acteurs?
On a longtemps dit que les solutions classiques du e-business ne pouvaient pas marcher en Afrique car il y avait des composants manquants dans l’écosystème digital africain comme le paiement. Quand on regarde l’arrivée de nouveaux acteurs comme Rocket International, Jumia, Kaymu, et Kangoo au Nigeria, il y a deux phénomènes qui expliquent leur développement. Tout d’abord, l’émergence d’une classe moyenne qui grandit dans les mégapoles africaines et qui vit de manière très proche de n’importe quelle classe moyenne en Europe ou aux Etats-Unis. Donc des populations qui possèdent des cartes de crédit, qui consomment en ligne par besoin en raison de leur modèle de vie. Quand cette classe moyenne s’épaissit suffisamment, un marché s’est créé pour dupliquer ce qui se passe en Europe. C’est une de ces raisons qui explique l’arrivée de Jumia, Kaymu, Jovago, etc. Ils ont aussi innové pour atteindre le reste de la population internaute par de nouvelles solutions de paiement. On a toujours pensé que le mobile allait être un relais intéressant pour le paiement. Mais aujourd’hui, quand on regarde ces acteurs, ils contournent le mobile en proposant un paiement à la livraison. Ils n’utilisent pas le mobile comme moyen de paiement. Cela veut dire que les opérateurs sont surement entrain loupé un coche. Ils ont tous tardé à ouvrir leur interface de programmation (API) aux développeurs. Et cela ne concerne pas que l’Afrique francophone. Safaricom avec son outil populaire M-PESA peine à proposer une solution de paiement en ligne. Orange vient seulement d’annoncer qu’ils vont commencer à tester leur API avec des développeurs pour Orange Money*. Idem pour MTN Money. Donc je pense que les opérateurs n’ont pas encore exploré ce réservoir de développement du Mobile Money qu’est le paiement en ligne. Néanmoins, il y a une bonne base d’utilisateurs qui usent du paiement mobile pour les transferts d’argent et le règlement de facture. Ce n’est donc pas surprenant que ces solutions arrivent avec une classe moyenne qui se développe.
Copyright Photos Google – Will Marlow The real internet – Charles Roffey –
Le contexte de la société numérique Africaine. Interview de Tidjane Deme sur la stratégie générale de Google pour l’Afrique francophone. Propos recueillis en septembre 2015
Mots Clés : Google / Régulation des Télécoms / écosystème digital / Marketplaces / Mobile Money
(*) Propos recueillis en septembre 2015 dans le cadre d'une thése professionnelle sur les leviers du marketing digital pour la promotion des produits culturels africains – ILV Paris – MBAMCI


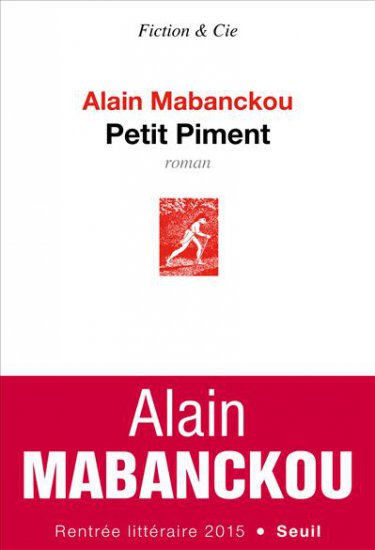



 Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.
Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.
 GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?
GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?
 GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?
GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?
 GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?
GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?
 Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.
Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.
 Je suis diplômé d’un Master de Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine avant d’effectuer le MBA de HEC avec un programme d’échange à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Je suis du reste membre du Wharton club of Africa, responsable du secteur énergie et de la France.
Je suis diplômé d’un Master de Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine avant d’effectuer le MBA de HEC avec un programme d’échange à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Je suis du reste membre du Wharton club of Africa, responsable du secteur énergie et de la France.
 Dans votre livre «l’énergie solaire après Fukushima: La nouvelle donne», vous défendez la thèse selon laquelle les énergies renouvelables sont une évidence et qu’elles finiront par s’imposer?
Dans votre livre «l’énergie solaire après Fukushima: La nouvelle donne», vous défendez la thèse selon laquelle les énergies renouvelables sont une évidence et qu’elles finiront par s’imposer?