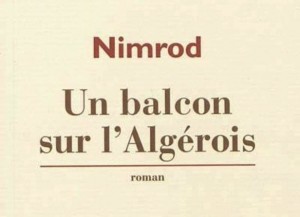Hemley Boum, écrivaine camerounaise, est l'auteure d'un roman remarquable alliant faits historiques et fiction autour du leader nationaliste Ruben Um Nyobé et du volet bassa du maquis camerounais. Les maquisards, ce roman, est publié aux éditions La Cheminante et disponible en librairie ou en ligne. La romancière camerounaise a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses sur ce thème sensible, douloureux et peu connu de la décolonisation en Afrique.

Hemley Boum, Bonjour. Vous avez choisi d’écrire sur le maquis camerounais. Un roman plutôt qu’un essai…
C’est un roman intense, complexe avec plusieurs entrées, plusieurs histoires qui s’imbriquent, s’enlacent afin de donner de la cohérence à l’ensemble. Il est assez métaphorique aussi. Je comprends que l’on choisisse certaines portes d’entrée plutôt que d’autres, c’est la liberté du lecteur. Même si « Les Maquisards » est un roman très documenté mais il ne s’agit en aucun cas d’un essai. J’ai délibérément choisi les éléments historiques qui venaient nourrir ma fiction et mis la grande Histoire au service des existences individuelles des hommes et des femmes dont il est question ici. Bien que certaines actions en background se déroulent ailleurs, j’ai choisi une unité de lieu, la forêt bassa, et partant de là, d’étendre ma narration sur plusieurs générations de personnes. L’idée étant d’être au plus près des êtres, au plus près de leur parcours de vies, leurs espoirs, leurs ambitions afin d’expliquer pourquoi toutes ces personnes, ces paysans se sont engagés dans un combat de cette ampleur. Je n’aurais probablement pas pu me permettre une telle licence dans le cadre d’un essai.
C’est votre marque de fabrique déjà observée dans le précédent roman Si d’aimer…
Oui, nous sommes au plus près des désordres humains, de nos humanités. C’est une littérature qui est dans l’intime, elle se veut être au plus près des hommes.
Comment passe-t-on de Si d’aimer… à ce nouveau roman Les maquisards?
C’est difficile à expliquer, des évènements personnels, des commentaires, des rencontres m’ont fait comprendre qu’il y avait là un sujet d’une extrême gravité et que comme beaucoup de camerounais de ma génération, je passais à côté d’un pan important de l’histoire de mon pays. Ce qui était une vague curiosité s’est changé en interpellation puis en nécessité impérieuse. Je me suis aperçue que plusieurs personnes dans mon entourage immédiat avaient été impactées par cette histoire, avaient personnellement souffert dans cette lutte, elles avaient perdu des membres de leurs familles, des patronymes avaient dû être changés pour échapper à la répression, des villages que je croyais immuables dataient des déplacements forcés de population organisés par l’administration coloniale dans sa stratégie pour isoler les rebelles réfugiés dans la forêt.
En pays bassa, les paysannes pratiquent l’agriculture par jachère. Elles laissent respirer la terre pendant de longues périodes. Des personnes m’ont expliqués qu’encore dans les années 80-90, il arrivait qu’en abordant une nouvelle terre, qu’elles tombent sur des charniers. J’avais l’impression d’ouvrir une boite de Pandore.
J’ai effectué quasiment toutes mes études au Cameroun, et dans mon parcours scolaire je n’ai pas été frontalement confrontée à cette histoire. Si je l’ai rencontrée, c’était tellement édulcoré, peu mis en avant que j’ai zappé. Jusqu’à quel point mon esprit subodorant la supercherie s’est fermé aux faux-semblants officiels. Combien sommes-nous de ma génération à avoir réagi ou à réagir encore ainsi ?
Ecrire sur Um Nyobé, est-ce que le projet a été difficile? D’ailleurs Um Nyobé, est-il personnage prétexte dans votre roman? Comment avez-vous reconstitué cet univers?
Dans les maquisards, Mpodol* n’est pas un personnage prétexte. C’est un vrai personnage qui impulse des choses. Il existe. Il y a quelque chose qui va se mettre en place entre lui et ses proches. Pour connaitre Mpodol, il faut écouter ses discours. Il est très différent d’un Césaire ou plutôt d’un Senghor, d’ailleurs ils n’avaient aucune sympathie l’un pour l’autre. L’homme d’Etat Sénégalais a été particulièrement injuste avec les nationalistes camerounais, mais ce n’est pas le sujet. Mpodol a du respect pour le français, la langue française, mais il n’a pas cette admiration béate devant la culture française que vont avoir certains leaders africains. Son père est un patriarche traditionnel et il est lui-même très ancré dans la culture bassa. Il a peu d’amis hormis un noyau dur de personnes qui restera jusqu’au bout et dont plusieurs partageront son sort tragique. Il n’est pas mondain. Ce qui va faire le roman, c’est cela, toute cette force, ces passions, cet engagement sans concession, tout cela concentré dans cette forêt, cette cabane, leur environnement naturel. Mpodol n’est pas un poète, un grammairien ou quelqu’un qui a le goût des belles phrases, des envolées lyriques. Il cherche le mot juste, la bonne intonation. Ses discours aux Nations Unies sont révélateurs, il est précis, convaincant, factuel. Il a une mentalité de juriste. Quand il rentre dans les textes français, il les aborde avec profondeur, il les dissèque car il pense que c’est là que ça se joue et qu’il s’agit d’un combat loyal. C’était leur force et leur terrible faiblesse, ces hommes étaient capables de comprendre la complexité d’un texte, sans toutefois saisir l’esprit des rédacteurs. Il pensait sincèrement que cela se jouait à la loyale.
Au début le livre devait se concentrer sur Um Nyobe, j’ai travaillé sur cinquante pages puis j’ai bloqué. La construction avait du mal à avancer. C’est à ce moment que j’ai créé le personnage d’Amos qui est son double. Ainsi Amos existe et Um Nyobé prend sa place de leader. Il devient un personnage. Je peux donc exploiter les aspects historiques et la dimension personnelle, je peux l’insuffler dans leur relation.
Ces personnages de fiction prennent une place très importante. Le roman prend la forme d’une saga familiale. Il y a des femmes fortes. Il est question de deux femmes particulièrement Thérèse Nyemb et Esta Mbondo Njee.
Elles sont toutes fortes. Likak aussi est une femme forte. Si être une femme forte c’est ne pas se laisser briser, dévaster par l’adversité, même Jeannette et Christine Manguele sont fortes à leur manière.
C’est un roman très féminin. Il y a une démarche de montrer ces femmes qui bougent, bousculent la société bassa traditionnelle.
Votre propos est étonnant. Il y a des hommes forts dans ce roman. Amos Manguele est une grosse personnalité. Alexandre Muulé Nyemb, Ruben Um Nyobe aussi… Mais, comme ils coexistent avec des femmes de caractère dans une relation de complémentarité, vous en déduisez que le roman est féminin. L’important c’est que ces personnes, hommes et femmes, sont puissantes en tant qu’individus mais aussi en tant que communauté, les deux sont liés, imbriqués même. Cela explique leur engagement.
En outre, l’immense implication des femmes dans le mouvement national Camerounais et la guerre de libération est une vérité historique. Mes personnages sont fictifs, cependant dans la réalité, des femmes seront assassinées en même temps que Ruben Um Nyobe ce jour là à Boumnyebel.
Ici, le propos n’est-il pas de dire que ce sont les femmes qui introduisent une certaine rupture? De plus, on pense à un roman comme Cent ans de solitude de Gabriel Garcia-Marquez : La malédiction et le silence. Y-a-t-il de votre part une réflexion sur la malédiction et les chaines de silence qui se reproduisent de génération en génération? Qu'est-ce que ce silence ?
Le poids des non-dits, le poids du silence sur des faits aussi graves, sur des atteintes aussi importantes aux populations d’un pays provoque un sentiment de honte diffus mais bien réel. Un manteau de violence et de peur a été posé sur cette période.
On peut se demander pourquoi Um Nyobé n’a pas eu la même reconnaissance que Lumumba. D’abord, ce n’est pas le même profil de personne. D’une part. Et d’autre part, le maquis Camerounais s’est fait en deux temps. Il y a le maquis en pays bassa qui fait l’objet du traitement de mon roman. Puis après l’indépendance, il y a eu le volet en pays bamiléké. Le gouvernement camerounais d’Ahidjo avec l’appui logistique, financier et militaire de l’ancienne métropole s’attèlera à la traque des partisans qui continuent le combat en pays bamiléké. Vous savez, dans la spiritualité bamiléké, il y a des pratiques très fortes autour du crâne des ancêtres. Alors les forces conjointes en lutte contre les nationalistes vont systématiquement trancher les têtes de leurs adversaires et les accrocher sur des pics. Peut-on imaginer une telle violence, une si grande volonté de destruction va au-delà de la nécessité de mater la rébellion, il s’agit de soumettre, de dévaster et d’instaurer durablement la terreur. Sauf qu’au moment où cela a lieu, le gouvernement au pouvoir est Camerounais. Certaines personnes impliquées dans ces exactions sont encore au pouvoir aujourd’hui. Cela ne facilite pas le devoir de mémoire. Mais les temps changent, j’ai bon espoir. Nous devrons tôt ou tard affronter nos propres démons.
Sur la place des colons : Pierre Le Gall, le colon, est le personnage pour lequel vous introduisez le moins de nuances. Qu’incarne-t-il pour vous? Sur la rencontre entre la femme africaine et l’homme occidental?
Non, je n’ai pas introduit de nuance sur ce personnage pour une raison simple, ce que j’ai écrit sur ce personnage est bien en deçà de ce que les témoignages laissent entendre du comportement de certains colons. La colonisation en elle-même était un système d’une extrême violence uniquement justifiée par des intérêts économiques. La nuance s’inscrira plus globalement dans le livre, le roman dans son ensemble fait coexister des personnes que tout oppose et qui malgré tout se rejoignent dans une commune humanité.
Vous savez certains sujets sont plus porteurs que d’autres. Par exemple dans mon précédent roman Si d’aimer… je raconte cette relation entre le personnage de Céline et son proxénète. Et plus loin dans le roman, je parle aussi de la relation d’amour entre Céline et Paul. Une relation plus apaisée beaucoup plus belle. Mais on me parle toujours de la première et rarement de la seconde. Avec Les Maquisards, c’est un peu la même chose. Il y a Pierre Le Gall, mais aussi son pendant, son fils Gérard, ou la sœur Marie-Bernard qui offre une vision différente des relations entre les personnages y compris dans ces configurations tendues. Et puis, au cœur même de la rébellion, lorsque les choses se corsent, des partisans se retournent contre les populations, ceux dont l’implication dans le mouvement est mise en doute sont molestés, terrorisés, le personnage de Joseph Manguele traduit bien cette réalité aussi.
Ce n’est pas un problème de couleur de peau, cela ne l’a jamais été, en tout cas pas dans mon écriture. Il s’agit plus fondamentalement du respect de l’autre dans son humanité et sa singularité, du respect de l’autre comme unique garantie d’une relation que l’on veut sincère.
Pouvez-vous nous parler la construction de vos personnages?
Je suis profondément dans l’intime. Les écrivains américains sont doués pour cela, quelqu’un qui fait cela et qui me bouleverse, c’est l’auteur américaine Toni Morrison mais aussi Philip Roth dans un livre que j’adore qui s’appelle « La tache », ou Faulkner dans « Absalon, Absalon ». Même l’incroyable James Ellroy est sacrément doué dans cet exercice. Et Balzac dans la littérature française.
Lorsque vous avez fini de les lire, les pires personnages ont une humanité. Il y a des choses à voir au-delà des actes qu’ils posent. Ils ont une intériorité. C’est de la bonne fiction. Celle qui donne l’impression que nous sommes dans une tragédie antique, chaque personnage est potentiellement Orphée, Perséphone Médée…C’est la fiction que j’aime, celle qui repousse les limites et qui dit l’Histoire, la vie et ses bifurcations dans toute leur complexité en partant de l’humain lambda, vous, moi, n’importe quel personnage de roman. C’est celle que j’essaie d’écrire.
Sur la place de spiritualité dans le livre, il y a une approche un peu manichéenne. Mais sans aller dans le détail, vous présentez cette thématique sous un angle particulier, avec l’idée d’un éventuel retour en arrière, vers ces croyances ancestrales. Est-ce le cas?
Peut-on revenir en arrière? Tant de choses ont été détruites. Pour illustrer mon propos, je raconterai une situation que Soyinka a vécue en Jamaïque à l’époque où il est chassé du Nigéria par Sani Abacha. Soyinka raconte dans ses mémoires que son errance à travers le monde le mène à un village en Jamaïque qui porte le même nom que son propre village de naissance et où l’on pratique un rite à un dieu Yoruba qui est profondément pur. En fait, les jamaïcains avaient gardé des aspects de ces pratiques qui avaient été violemment combattus par le système colonial.
Les croyances et la spiritualité des groupes humains en Afrique datent de l’Egypte ancienne, Cheikh Anta Diop ainsi que des anthropologues de l’Afrique anglophone, Nigéria, Ghana, ont longuement analysé cet héritage. Il faut comprendre que les croyances africaines, ces spiritualités si anciennes ne sont pas, dans leurs essences, prosélytes. C’est une manière d’être, d’exister dans un accord parfait avec son environnement, son groupe incluant les vivants et les morts. Ce sont des communautés qui comprennent bien que la spiritualité est intime, confidentielle. Elle dépend de votre relation, votre histoire propre en tant qu’individu et en tant que groupe avec les divinités que vous vénérez et à ce titre ne peut en aucune manière être imposée à d’autres.
Aujourd’hui et c’est bien là le paradoxe, le retour des jeunes vers ces spiritualités africaines se fait contre, en réaction de… Il ne s’agit plus d’un être au monde fluide et naturel, mais d’une spiritualité de combat et de revendication. Je comprends la démarche mais je ne suis pas certaine que ce soit judicieux.
Est-ce que la fiction peut permettre un changement, introduire le débat?
C’est le rôle de la fiction. Elle permet la prise de recul sur la situation. L’Histoire sur laquelle l’on choisit d’édifier la mémoire d’un peuple est avant toute chose un choix idéologique, cela a l’air d’une science, mais au fond c’est un tri de ce qui va renforcer la conscience de faire corps, le lien, la communauté. Appelez-le prise de la Bastille, République, Guerre de Sécession, Shoah, ainsi s’écrit la légende des peuples, les valeurs qu’ils partagent. La fiction participe à bâtir des édifices imaginaires forts. Au Cameroun, nous n’avons pas tant que cela des motifs de fierté collective et symbolique, les forces disproportionnées lâchées sur ces personnes de rien, ces paysans désarmés, ces instruits de premières générations, sont une honte et le resteront de toute éternité. Le courage de ces hommes et ces femmes, de même que le sacrifice consenti, est notre plus grande fierté ; quelque chose d’assez solide pour bâtir une Nation.
Vous avez une profonde connaissance de la culture bassa. Pouvez-vous nous en parler?
Je me suis intéressé à ces données. Comme je l’ai dit plus haut, je voulais ancrer mes personnages dans une réalité sociale et spirituelle forte. Etre au plus près de leur réalité, de leur vécu. Pour cela je devais m’imprégner de la culture bassa, la comprendre dans ses nuances et ses non-dits. Me l’approprier. Je ne regrette pas, j’ai beaucoup appris, mieux compris. Cela reste une belle expérience personnelle.
Il y a une déstructuration très forte portée au niveau des filiations. Quel est votre propos à ce sujet?
La sexualité telle que la conçoit, l’église catholique, avec cette notion de culpabilité est très peu présente dans les sociétés traditionnelles, elle n’a même pas de sens dans ce contexte. Dans l’organisation sociale traditionelle, la parenté est sociale avant d’être biologique Chez moi, quand une femme avait un enfant avant le mariage, c’était un très bon point, elle avait fait la preuve de sa fécondité alors sa dot était plus importante. Les peuples sont pragmatiques, la cohésion du groupe prime sur l’idéologie, la spiritualité et les croyances travaillent dans ce sens. À ce titre la complémentarité des hommes et de femmes est à la fois économique, sociale, politique et spirituelle.
Un dernier point sur la place de la langue bassa. Manguele communique en bassa avec les autres membres de la guérilla. Quel regard portez-vous sur les langues africaines. Y-a-t-il un enjeu à revenir vers elles, comme elles ont été un moyen de communication sécurisé dans le maquis bassa?
Les bassa, comme quelques autres groupes tribaux au Cameroun ont très vite appris à écrire leur langue. Les églises protestantes américaines installées dans cette zone dès la fin du XIXème choisissent de commencer les apprentissages avec l’écriture et la lecture du bassa. Elles n’ont pas la même appréhension de la question que les catholiques français qui en interdisent formellement l’utilisation à l’école. Ce qui donne une génération de personnes qui non seulement évolue dans leur environnement naturel en parlant leur langue maternelle, mais en plus ont appris à l’intellectualiser à la façon occidentale. C’est un vrai atout.
En outre, les pères fondateurs de l’UPC étaient issus de tous les grands groupes ethniques camerounais. Cela a permis une transmission du message en langue locale qui a surtout infusé auprès de ceux à qui personne ne prenait la peine d’expliquer les enjeux économiques dont ils étaient l’objet. Tout d’un coup, nous sommes dans de l’entre soi, un immense entre soi qui réunit les camerounais en excluant l’occupant. Et bien sûr les communications qui ont lieu dans les centres urbains plus hétéroclites en terme de population que les villages le sont en français. Le mouvement développe ainsi une souplesse, une adaptabilité supplémentaire.
La langue est un enjeu de communication majeur. Chacune d’elle véhicule ses propres subtilités, un imaginaire, une histoire que l’on peut traduire dans une autre langue bien sûr mais sans jamais être assuré d’avoir respecté au-delà de la lettre, l’esprit. Malgré tout, comme le reste, elles vivent et meurent, remplacées par d’autres plus accessibles ou que sais-je. Mais à chaque fois qu’ainsi disparaît une langue, la perte est à la fois silencieuse, dévastatrice et sans rémission.
Hemley Boum, merci !
Merci!
Propos recueillis par Laréus Gangoueus
 Le roman Racines d’amertume m’a permis de me replonger dans l'univers complexe et passionnant des urgences. J’ai longtemps été un fan de la fameuse série de télévision Urgences. Beaucoup regardaient cette série américaine pour les beaux yeux du Dr Ross incarné par Georges Clooney. 15 ans après, il est difficile de mettre des mots sur l’intérêt qu’on porte à un tel sujet. Les urgences portent en elles plusieurs réalités : la fragilité de la vie, l’élitisme pourtant accessible des urgentistes, les disparités en terme de prévoyance sociale des patients et bien d’autres tares ou croustillantes anecdotes.
Le roman Racines d’amertume m’a permis de me replonger dans l'univers complexe et passionnant des urgences. J’ai longtemps été un fan de la fameuse série de télévision Urgences. Beaucoup regardaient cette série américaine pour les beaux yeux du Dr Ross incarné par Georges Clooney. 15 ans après, il est difficile de mettre des mots sur l’intérêt qu’on porte à un tel sujet. Les urgences portent en elles plusieurs réalités : la fragilité de la vie, l’élitisme pourtant accessible des urgentistes, les disparités en terme de prévoyance sociale des patients et bien d’autres tares ou croustillantes anecdotes.



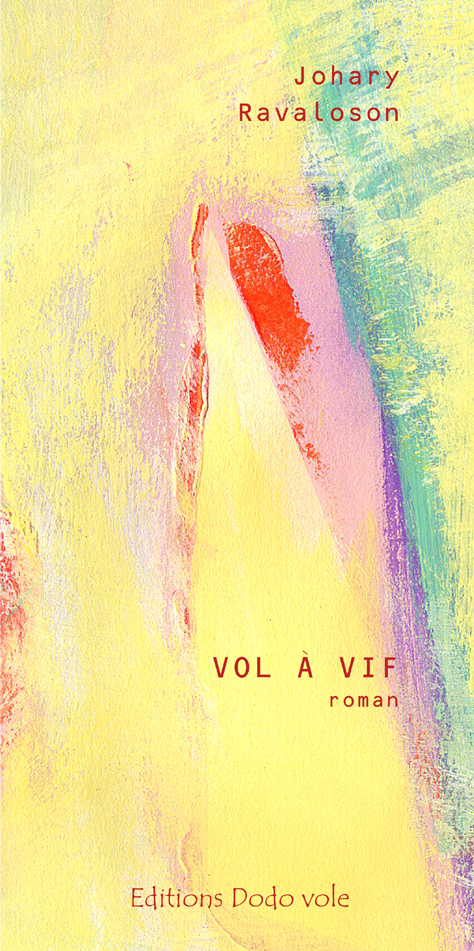




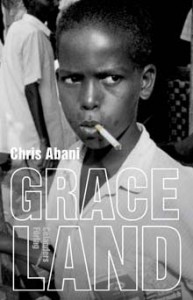


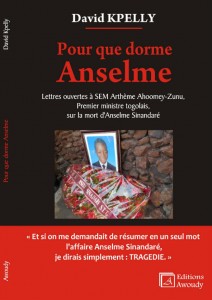

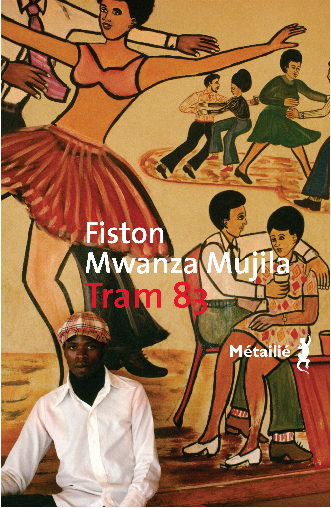


 Bofane ou l’art du contrepied
Bofane ou l’art du contrepied
 Isookanga ou la mondialisation des cynismes
Isookanga ou la mondialisation des cynismes