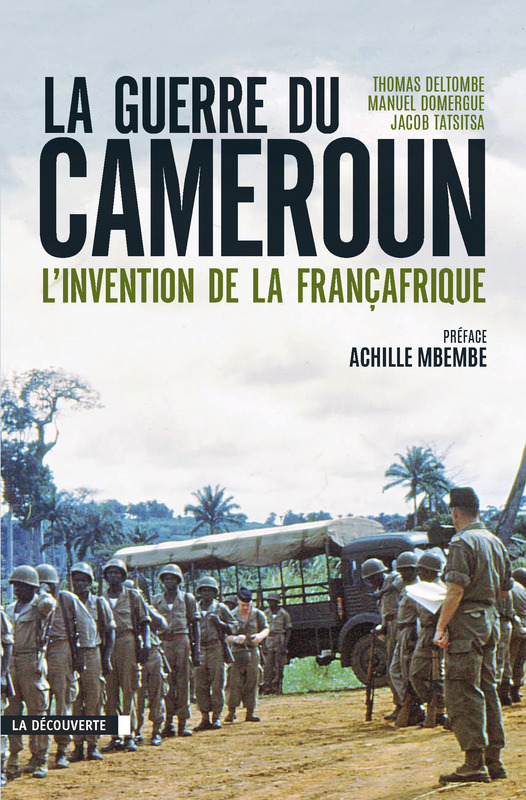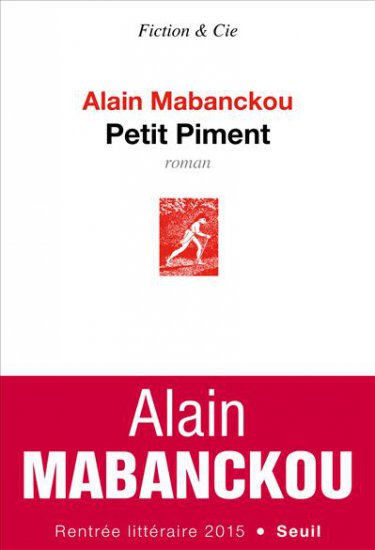L’ Année 2018 démarre sous les pires auspices en République démocratique du Congo, ce pays qui porte si mal son nom, où des forces de l’ordre usent de gaz lacrymogène et tirent à balles réelles à la sortie des églises.
L’ Année 2018 démarre sous les pires auspices en République démocratique du Congo, ce pays qui porte si mal son nom, où des forces de l’ordre usent de gaz lacrymogène et tirent à balles réelles à la sortie des églises.
Le 31 décembre, à quelques heures du réveillon, des marches de catholiques contre le pouvoir en place ont été brutalement réprimées et il faut entendre la légitime et puissante indignation de l’archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo. “Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie (…) Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l’amour du peuple ? Il est temps que la vérité l’emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règnent la paix, la justice en RD Congo ». A juste raison, l’International Crisis Group, ce think tank qui analyse les régions à risque dans le monde, décrit la situation en RDC et son année électorale à venir comme l’une des dix crises internationales à suivre avec attention dans les mois qui viennent.
Et pour cause, officiellement, le mandat du président Joseph Kabila s’est achevé le 20 décembre 2016. Depuis, il exerce son pouvoir en dehors de tout cadre constitutionnel, et les élections sont sans cesse repoussées. A la Saint-Sylvestre 2016-2017, sous l’égide de l’Eglise catholique, un accord encourageant avait pourtant été signé avec l’opposition pour annoncer un scrutin un an plus tard et mettre en place une transition. Mais il a été foulé au pied, et voilà les élections générales, présidentielle, législatives et provinciales renvoyées officiellement au 23 décembre 2018, plongeant à nouveau le pays dans l’incertitude. Tout cela alors que l’année a été difficile pour ce pays très fragile, de violents troubles touchant même des régions relativement épargnées jusqu’ici comme le Kasaï.
Finalement, les craintes de l’opposition se sont confirmées. Le président Joseph Kabila, 49 ans, est bien parvenu à faire durer son mandat, et prouve une nouvelle fois, malgré sa personnalité mystérieuse et discrète, qu’il est un fin manoeuvrier, comme le confie Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur de France en RDC, interrogé par l’Afrique des idées: “il est beaucoup plus intelligent et subtil qu’on ne le laisse entendre dans certaines chancelleries. Il écoute les uns et les autres mais n’est en aucune manière influencé. Aujourd’hui, il est dans une position extrêmement favorable. Il a réussi à rester au pouvoir pour permettre à son entourage de continuer à amasser de l’argent. Il y a une absence d’unité internationale. On est dans une situation un peu bloquée”.
Le diplomate décrit aussi la profonde déception de l’Eglise catholique congolaise, qui pensait avoir fait le plus dur il y a un an en accompagnant le fameux accord de la Saint-Sylvestre, finalement bafoué. “Dans le passé, il y a eu plusieurs médiations organisées sous l’égide de l’Eglise qui ont donné des résultats. Cette fois, cela n’a pas marché. Tout le monde vit cela comme un échec, ils ont l’impression de se faire avoir, d’être tournés en bourrique par un président, et une commission électorale absolument hallucinante”, estime-t-il.
Les arguments avancés par la commission électorale pour justifier le report des élections sont connus. Il faut du temps pour l’enrôlement des électeurs (leur enregistrement sur les listes électorales) et les défis logistiques et budgétaires sont immenses dans ce pays continent de 80 millions d’habitants.
“C’est très compliqué d’organiser des élections au Congo, ça c’est indéniable. Sur le plan logistique, il faut des moyens considérables, des hélicoptères pour transporter les urnes, installer les bureaux de vote. C’est un pays où l’état civil est défaillant, toutes les opérations, depuis l’enrôlement jusqu’au dépouillement sont compliquées. Mais il n’empêche que cela a déjà été fait dans le passé: il y a eu des élections en 2006 et en 2011. Il n’y a pas de raison d’invoquer des problèmes maintenant, ils ont eu le temps, c’est un argument fallacieux qui ne tient plus à mon avis”, tranche encore Pierre Jacquemot.
L’autre atout de Joseph Kabila est sa maîtrise de la scène politique congolaise. “Sa majorité politique est restée cohérente toute l’année, alors que l’opposition est divisée, surtout depuis février dernier et la disparition de son chef de file historique Etienne Tshisekedi”, relève Richard Moncrieff, le directeur Afrique Centrale de l’International Crisis Group qui a récemment rendu public un rapport sur la RDC, réclamant une “action concertée” des acteurs occidentaux et africains pour résoudre la crise.
La situation du RDPS symbolise les difficultés de l’opposition: le parti fondé par Etienne Tshisekedi est scindé en deux. D’un côté le premier ministre Bruno Tshibala, qui a fait le choix de gouverner pendant la transition avec le soutien de quelques dissidents du parti, de l’autre Félix Tshisekedi – fils d’Etienne – et les siens qui estiment représenter le RDPS canal historique et jugent que Tshibala s’est auto-exclu du parti…
Dans ses recommandations, publiées avant les événements du 31 décembre, l’International Crisis Group en appelle à une “opposition engagée”, en l’encourageant à prendre part aux négociations avec le pouvoir et entrer plus concrètement dans le jeu politique. Mais comment ne pas se retrouver à nouveau dans le rôle du dindon de la farce ?
“Il y a un risque, mais c’est la vie politique. Il faut accepter ce risque. Il faut s’impliquer, critiquer le gouvernement à partir d’éléments solides. Il faut rester dans l’esprit d’une opposition constructive même si les frustrations sont très fortes”, considère Richard Moncrieff.
“Dans une certaine mesure, le risque de se faire rouler par un président qui veut rester au pouvoir s’est déjà produit. Le président est là. Rester en exil, ça n’apporte pas grand chose non plus. Il faut une implication plus importante et quotidienne à la fois des membres de l’opposition et des acteurs internationaux afin de contrecarrer les manoeuvres du régime sur le terrain”, poursuit-il.
De son côté Pierre Jacquemot se souvient d’un président Kabila plus que sceptique sur la qualité des dirigeants de l’opposition. “Il n’accordait aucun crédit à l’opposition et aux personnalités qui la composaient. Il les jugeait tous comme étant des gens qui avaient profité du système à un moment ou un autre, et qui pour beaucoup s’étaient remplis les poches”.
Outre l’engagement de l’opposition, la relance du processus politique passera par une mobilisation internationale qui fait défaut. Ces derniers mois, ce sont les Etats-Unis qui ont semblé vouloir reprendre le leadership sur le dossier avec la venue fin octobre de Nikki Haley, l’ambassadrice américaine aux Nations Unies. Mais il faudra un engagement dans la durée, alors que les Américains n’ont pas d’ambassadeur à Kinshasa, mais une chargée d’affaires ad interim, et que l’administration Trump a décidé de supprimer les postes d’envoyés spéciaux régionaux, dont celui d’envoyé spécial en charge des Grands Lacs.
Il faut aussi trouver une voix commune entre les acteurs occidentaux et africains, souvent moins ouvertement critiques au sujet du régime de Kabila. Certains voisins ont parfois semblé se satisfaire de repousser à plus tard les incertitudes d’une présidentielle à risque. L’International Crisis Group cite le Congo-Brazzaville, dont la proximité géographique avec Kinshasa incite à la prudence, ou l’Angola et son immense frontière de 2.500 kilomètres avec la RDC.
“Le problème de ce raisonnement à court terme, c’est de laisser perdurer une crise qui va détériorer chaque jour un peu plus l’état de droit, le respect de la constitution et des institutions. C’est une bombe à retardement. Plus on attend, plus il sera difficile d’éviter l’explosion du pays”, met en garde Richard Moncrieff.
Cet expert considère également que le système des sanctions ciblées des Etats-Unis ou de l’Union Européenne contre des responsables congolais est en train d’atteindre ses limites, en l’absence de position concertée avec l’Union Africaine et les pays de la région.
“On est pas contre les sanctions, mais les sanctions devraient faire partie d’une stratégie politique cohérente. On constate que le résultat des sanctions diminue avec le temps, surtout parce que le pouvoir à Kinshasa s’en sert volontiers pour diviser les positions des acteurs africains et occidentaux au sujet de la RDC. Donc, en ce moment, les sanctions ne servent pas à grand chose, la priorité devrait être une meilleure coordination avec les pouvoirs africains”, insiste Richard Moncrieff.
La difficulté est de se mobiliser sur une crise qui dure depuis de longues années, dans un pays où l’instabilité chronique fait le jeu de ceux qui veulent en exploiter les ressources, notamment dans l’Est de la RDC. Ces derniers mois, la communauté internationale s’est aussi concentrée sur d’autres dossiers sensibles du continent: les pays du Sahel, déstabilisés par le terrorisme, ou la Libye.
La tentation de céder au découragement est donc bien réelle dans une Afrique centrale restée complètement à l’écart de la dynamique démocratique en cours en Afrique de l’Ouest. Pour ne pas s’y abandonner, Pierre Jacquemot insiste sur l’existence d’une identité congolaise forte, “même si le pays est grand et qu’on y parle quatre langues”. Malgré les épreuves, “ce pays indépendant depuis presque 60 ans est encore dans ses frontières. C’est déjà assez miraculeux”.
Il souligne aussi le bouillonnement, “la vitalité et la créativité assez exceptionnelles” d’une ville comme Kinshasa, que ce soit sur le plan artistique ou entrepreneurial. Et la qualité de l’élite intellectuelle dans les milieux littéraires ou à l’Université. “Il se passe beaucoup de choses, dès lors qu’il y a un peu de stabilité”, conclut-il.