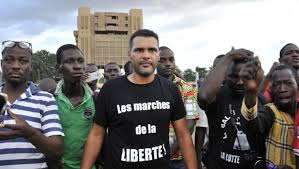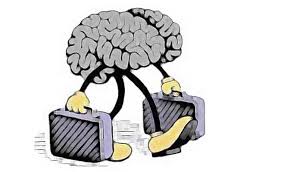La Cédéao et l’Union Africaine, soutenues dans une certaine mesure par la Communauté internationale, ont contraint Jammeh à céder le pouvoir après de longues négociations menées par les présidents guinéen et mauritanien et sous la menace d’une intervention militaire. Si cette manœuvre a permis de se débarrasser d’un pouvoir autocratique qui a plongé ce petit pays dans une crise socio-économique sévère et un isolement international quasi-complet ; il convient toutefois de s’interroger sur le signal qu’elle donne, notamment pour l’instauration d’une démocratie véritable en Afrique, mais aussi quant au fonctionnement des institutions régionales africaines.
Cette crise est la résultante de l’entêtement de Yahya Jammeh à s’accrocher au pouvoir alors qu’il l’aurait perdu dans les urnes. Une défaite, qu’il a concédé dans un premier temps, avant de faire volte-face contestant la légitimité du président élu en évoquant les irrégularités entachant le scrutin et révélées par l’IEC (Independent Electoral Commission).[1] Une volte-face que certains considèrent comme une manœuvre de Jammeh afin d’éviter des poursuites judiciaires pour les exactions commises durant ses 22 années au pouvoir.
Cependant, dans une Afrique en quête de stabilité démocratique, les arguments avancés par les détracteurs de Jammeh seraient-ils pertinents vis-à-vis de ceux du président sortant dénonçant les irrégularités ? D’autant plus que ces irrégularités ont été confirmées par le président de l’IEC lui-même, tout en précisant qu’elles ne sont pas de nature à modifier l’issue du scrutin.
Alors qu’à l’annonce des résultats, Jammeh aurait pu les rejeter en bloc pour diverses raisons, s’accrocher au pouvoir en s’appuyant sur l’armée comme certains de ses pairs, il les a acceptés à la surprise générale. Il a démontré sa volonté de respecter les principes de la démocratie et à ce titre, il aurait fallu user des voies de recours légales pour régler ce différend politique. La médiation de la CEDEAO, conduite par sa présidente Ellen Johnson Sirleaf, ne s’est pas attachée à amener les protagonistes à user de telles voies, même si on estime que le contexte ne s’y prête pas avec une cour suprême dont les membres n’ont pas été nommés. Elle avait une seule ambition : négocier le départ de Jammeh. L’échec d’une telle médiation était donc prévisible et n’a laissé à Jammeh que des options qui ont envenimé la crise de sorte à lui donner l’image d’ennemi de la démocratie pouvant justifier cette intervention militaire.
Jammeh n’est certes pas un agneau et son départ contraint – dans la mesure où le président élu de la Gambie, Adama Barrow, a prêté serment à Dakar (dans un flou juridique total que seul comprend la communauté Internationale) et vu l’imminence d’une intervention militaire que Jammeh ne peut contenir ; l’armée gambienne ne voulant d’ailleurs pas se battre, selon cet article du "Monde" – offre à la Gambie un nouveau souffle. Cependant, cette situation suscite plusieurs interrogations, notamment sur la gestion des crises par les institutions régionales africaines.
Le constat est qu’à situation similaire, les traitements ne sont pas les mêmes. La balance régionale tend à pencher d’un côté de sorte que l’intervention de ces institutions ne sert qu’à appuyer l’une des parties impliquées dans la crise et non à les renforcer, foulant au passage les principes démocratiques. Alors qu’en 2005 et 2015, le Togo était au bord d’une crise après les élections, la CEDEAO n’a fait qu’avaliser l’élection de Faure Gnassingbé au grand désarroi du peuple. Plus récemment, alors que tout indiquait qu’Ali Bongo a forcé sa réélection en tant que président du Gabon, l’Union Africaine a fait mine de laisser les Gabonais régler leur différend politique. Au Congo, les manœuvres de Sassou Nguesso pour se maintenir au pouvoir n’ont pas suscité une quelconque intervention de l’Union Africaine et celles de Kabila en RDC n’amèneront certainement pas cette dernière à décider d’une intervention militaire ou à en appuyer une visant à déloger ce dernier. Si le conflit électoral en Gambie n’est pas une première sur le continent, il n’en est pas de même de la réaction de la communauté internationale. Cette dernière ne s’est en effet jamais autant impliquée pour le respect du choix populaire. Mais à y regarder de près, cette prise de position tient davantage à la personnalité de Jammeh plutôt qu’à une intention véritable de l’institution de renforcer la démocratie dans ce pays et dans la région de façon globale. Très peu apprécié par ses pairs, Jammeh a fait les frais de cette crise post-électorale qui constitue un ultime instrument entre les mains de ses détracteurs pour le forcer à quitter le pouvoir. La gestion des crises par les institutions africaines se ferait donc à la tête du client ? Cela s’y apparente. Aussi détestable que Jammeh puisse être, cette intervention musclée pour le déloger du pouvoir n’était pas forcément nécessaire, surtout qu’il était dans son droit de contester les résultats d’une élection dont la crédibilité a été remise en cause par les organisateurs.
Au final, Jammeh a quitté le pouvoir (chacun pourra l’apprécier selon sa conviction) mais il ne faudrait surtout pas y lire une victoire de la démocratie sur la dictature mais plutôt une persistance de l’application de la loi du plus fort dans la conquête du pouvoir politique en Afrique et reconnaître que les institutions africaines ne sont qu’à leur solde. Dans ce contexte, elles ne pourraient permettre d’atteindre l’intégration tant souhaitée et de construire cette Afrique que nous voulons.
Dans tous les cas, on attendra l’Union Africaine et les autres institutions régionales sur d’autres scènes … tant l’Afrique compte des accros au pouvoir, qui, comme Jammeh, dirigent leur pays d’une main de fer depuis bien longtemps et violent ouvertement les principes démocratiques, sans être inquiétés. Espérons que nous nous trompons et que ces institutions réitéreront ce genre d’actions dans d’autres cas, qui ne manqueront certainement pas de se présenter sur le continent.