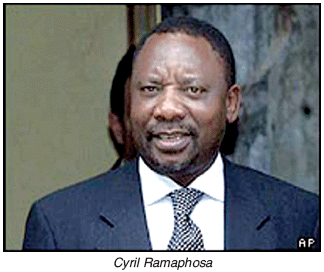Aux âmes nées, sous les tropiques, avec la passion du fouet en bandoulière, la valeur politique, ou du moins électorale, attendrait-elle un nombre très élevé d’années ?
Après le choc, les vieux. Et des vieux « durs » s’il vous plait serait-on tenté de dire.
En 2013, le septuagénaire Ibrahim Boubacar Keita se faisait élire au Mali, avec pour plus haut fait d’arme d’avoir mâté une révolte d’étudiants alors qu’il était Premier ministre dans les années 90. De cet épisode, beaucoup de maliens ont retenu l’image d’un leader fort, capable de se montrer intraitable, intransigeant face à certains empêcheurs de gouverner en rond.
Lorsqu’il se présente devant ses compatriotes, il y a deux ans, afin de recueillir leurs suffrages, le Mali est en situation de guerre. Le pays n’a dû son salut, face à une invasion jihadiste venue du Nord, qu’à l’intervention de la France d’abord puis au déploiement d’une force multinationale. IBK fait de la reconquête de la dignité qu’aurait perdue le pays son cheval de bataille. Dans le choix de son slogan de campagne, il opte pour la simplicité et l’efficacité : « Pour l’honneur du Mali » dit-il. Ses compatriotes adhèrent. Après la gestion jugée calamiteuse de la question du Nord par Amadou Toumani Touré finalement emporté par un putsch, les incantations du nouveau chantre de la dignité assaisonnées d’un curieux mélange d’expressions en latin, pour faire savant, et en bambara, pour le côté « bon sens paysan », font le reste. Il est ainsi élu principalement grâce à une réputation surfaite de dur à cuire qui, pour ses électeurs, devait permettre d’en finir avec cette coalition hétéroclite constituée essentiellement de jihadistes et de séparatistes.
En Tunisie, Béji Caid Essebsi (90 ans) bras armé du régime policier de Bourguiba (directeur de la Sureté nationale, ministre de l’Intérieur, ministre de la Défense) dans les années 60 et 70 a aussi bénéficié de cette image d’homme à poigne pour se faire élire, à la fin de l’année écoulée, malgré son âge canonique. Après la révolution qui a chassé Ben Ali du pouvoir, les tunisiens se sont retrouvés avec les islamistes d’Ennahdha à leur tête avant de vite déchanter. Entre une économie qui peinait à redécoller, des droits constamment remis en cause, des assassinats politiques et une menace terroriste accrue, il n’a pas fallu longtemps pour convenir d’un changement de cap. Dans la campagne qui devait les conduire au sommet, Essebsi et ses partisans ne ratèrent pas une occasion de rappeler que lors des émeutes anti-israéliennes ayant eu lieu à Tunis, en juin 1967, après l’éclatement de la Guerre de six jours, il a refusé, alors ministre de l’Intérieur, de donner l’ordre de tirer sur la foule. Que des associations de défense de droits de l’homme aient porté plainte contre lui, pour actes de torture datant de son passage à la Direction de la Sureté nationale n’y fera rien. Il réussit à se défaire de l’image d’ancien fonctionnaire zélé d’un régime autoritaire qu’ont voulu lui coller ses détracteurs arrivant à se présenter en homme sage, expérimenté mais ayant fait preuve d’assez de rigueur, par le passé, pour donner confiance dans sa capacité à gouverner en ces périodes troubles.
Muhammadou Buhari (72 ans) se présente comme un « converti à la démocratie ». En adoptant cette posture, ce général qui a dirigé le Nigéria, entre 1983 et 1985, à la suite d’un putsch, fait un enfant dans le dos aux théoriciens du Buharisme. Ceux qui pensent que le salut de nos pays ne peut venir que de « despotes éclairés », nationalistes, ne s’embarrassant pas de formes lorsqu’il s’agit de lutter contre la corruption, avec procès expéditifs et longues détentions arbitraires au besoin. Les atteintes aux droits de l’homme ne seraient, dans ce cas précis, que des dégâts collatéraux ou un mal nécessaire à l’instauration d’une gouvernance vertueuse. Le Buhari de 2015, qui vient d’être élu à la tête d’un Nigéria en prise avec les assauts répétés de Boko Haram, n’est plus celui du début des années 80. Il a rangé son fouet, arboré un grand sourire, et s’est coalisé avec quelques politiciens de la race de ceux qu’il avait honni, combattu et jeté en prison, il y a trente ans. Devant l’inertie de Goodluck Jonathan face à la menace sécuritaire et à une corruption galopante, cependant, son passé d’autocrate fut un atout majeur.
Après des chocs traversés par leurs pays respectifs, les électeurs maliens, tunisiens et nigérians, ne sachant plus à quel saint se vouer, se sont tournés vers les « durs » de leur classe politique ou ce qui s’en approche le plus. On met sous pertes et profits leurs méfaits. On a besoin de leur poigne.
C’est l’application en politique, sous nos cieux, de la stratégie du choc théorisée par Noemie Klein selon qui les guerres, les catastrophes naturelles, les crises économiques, les attaques terroristes sont utilisées de manière délibérée pour permettre la mise en œuvre de réformes économiques néolibérales difficiles voire impossibles à adopter en temps normal. Pendant ou après chaque menace terroriste extrémiste conduisant à des catastrophes économiques ou humanitaires, des peuples, en toute liberté, recyclent des autocrates ou de vieux personnages au passé politique sinueux et à la rigueur dévoyée par un excès de zèle rédhibitoire, pour en faire les champions du redressement citoyen, sécuritaire, économique.
Mais à chacun ses priorités, les peuples meurtris ou menacés veulent des hommes forts à leur tête. L’avenir appartiendrait alors à ceux qui, munis d’une matraque ou d’une corde, se lèvent tôt, se couchent, se relèvent, savent être patients, attendent leur tour, et ramassent le pouvoir après qu’un bain de sang, une pluie de larmes et une vague d’indignation l’aient entrainé dans la rue. Souvent, ils ne font pas grand-chose de ce pouvoir acquis par défaut.
IBK a rendu les armes face à ceux qu’il considérait comme des quidams à museler par tous les moyens ; ses incantations n’y ont rien fait, il leur a abandonné Kidal. Après les slogans aux relents de fermeté, le renvoi à un passé glorieux de toute sa brutalité, les déclarations d’intention de rigueur … la réalité de l’impuissance.
Essebsi a choisi un Premier ministre qui a attendu l’attentat du musée du Bardo pour organiser une purge dans la police tunisienne. Il a peut-être l’excuse du nouveau venu. A peine s’est-il installé que les terroristes frappaient. Mais n’avait-il pas promis des solutions clé en main du fait de son expérience dans la répression des fauteurs de troubles et autres citoyens indélicats ?
Le nouvel homme fort d’Abuja arrive auréolé de son passé de tyran. « Les crimes de Buhari » c’est le titre d’une pièce de Wolé Soyinka. Ce charmant monsieur doit être bien malheureux dans un monde où ces crimes qu’il dénonçait à ses risques et périls sont devenus un atout pour le criminel en question. Il se consolera en se disant que face aux abjections de Boko Haram, un enfant de chœur ne saurait faire l’affaire. Il fera confiance à son peuple qui, confronté au choix entre des gens pas très recommandables, selon les critères les plus répandus de nos jours, a choisi le moins pire.
A tous les dictateurs, apprentis dictateurs ou hommes liges de dictateurs, déchus ou en disgrâce, le message est le suivant : rien n’est perdu ; si vous êtes relativement jeunes et si dans 20 ou 30 ans les menaces sécuritaires, la corruption, l’incivisme sont toujours d’actualité dans votre pays, quoi que vous ayez fait de votre passage au pouvoir, vous avez de réelles chances d’être vu comme le messie. Entourez vous de spin doctors et de relais efficaces à tous les étages de la société, ne vous encombrez pas de considérations trop techniques, n’ayez d’autre programme que de rendre au peuple sa dignité, au pays son honneur, de mâter les fauteurs de troubles, de discipliner les esprits égarés et faites de la lutte contre la corruption votre cheval de bataille. Si au moment où vous dites cela, vous êtes riche comme crésus et cela du fait, en grande partie, de votre passage au pouvoir, ça ne changera rien. Le peuple est indulgent, il sait tout pardonner et/ou oublier lorsqu’il est à la recherche d’une icône.
Nous accorderons, tout de même, le bénéfice du doute aux thuriféraires du buharisme conquérant. Sanusi Lamido Sanusi, ancien gouverneur de la banque centrale du Nigéria devenu émir écrivait, en 2001, alors que le général briguait déjà le suffrage de ses concitoyens, ceci : « le Buharisme était un régime despotique mais son despotisme a été historiquement déterminé, rendu nécessaire par la tâche historique de démantèlement des structures de dépendance et l’émergence d’une nation tournée vers un modèle autre que l'accumulation primitive. Sous son meilleur jour, Buhari a peut-être été un Bonaparte ou un Bismarck. Dans ses pires moments, il peut avoir été un Hitler ou un Mussolini. Dans les deux cas, le Buharisme, s’il avait atteint sa conclusion logique, aurait posé les bases d'une nouvelle société. Son renversement a marqué une rechute, un pas en arrière ».
Toutefois, tout buhariste qu’il est, l’émir de Kano ne fait pas partie des hystériques et autres inconditionnels de la cause. Il a tôt fait de mettre un bémol. « Je crois, disait-il, que Buhari a joué un rôle honorable dans une époque historique particulière mais, comme Tolstoï et Marx, je ne crois pas qu'il puisse rejouer ce rôle. Les hommes ne font pas l'histoire exactement comme il leur plait mais, comme l'écrivait Marx dans Le 18 Brumaire, ils la font dans des conditions héritées du passé. Muhammadu Buhari, comme général de l'armée, avait plus de place pour manœuvrer qu'il ne pourra jamais espérer en avoir dans l’espace politique nigérian ». Et de poursuivre : « dans un pays de 120 millions d’habitants, nous pouvons faire mieux que de limiter notre choix à un petit groupe. Je pense que Buhari, Babangida et Obasanjo devraient simplement permettre à d'autres de montrer ce qu’ils valent au lieu de croire qu'ils ont le monopole de la sagesse »… Prés de quinze ans se sont écoulés depuis qu’il a écrit ces mots ; le sage Buhari, aidé du sage Obansanjo, a fini par reconquérir le pouvoir. La nouvelle génération de leaders nigérians valables devra attendre. En son sein, il n’y a personne pour rassurer le peuple ; elle ne regorge pas de dictateurs convertis.
Racine Assane Demba
 Bien avant la théorie aujourd’hui en vogue de la post-vérité ; avant l’invention des faits alternatifs avatars du trumpisme triomphant, il y avait Lambert Mendé.
Bien avant la théorie aujourd’hui en vogue de la post-vérité ; avant l’invention des faits alternatifs avatars du trumpisme triomphant, il y avait Lambert Mendé.





 Le second tour de l’élection présidentielle en République de Guinée-Bissau, tenu le 18 mai dernier, a livré son verdict. Avec 62% des suffrages, José Mario Vaz a remporté face à Nuno Gomes Nabiam (38%) un scrutin qui vient couronner un énième processus de normalisation de la tumultueuse vie politique locale.
Le second tour de l’élection présidentielle en République de Guinée-Bissau, tenu le 18 mai dernier, a livré son verdict. Avec 62% des suffrages, José Mario Vaz a remporté face à Nuno Gomes Nabiam (38%) un scrutin qui vient couronner un énième processus de normalisation de la tumultueuse vie politique locale.
 Mills en 2004, Abdoulaye Wade. La liste n’est pas longue.
Mills en 2004, Abdoulaye Wade. La liste n’est pas longue.

 Des intellectuels africains ont déjà commencé, à leur niveau, à prendre des initiatives recoupant certaines de ces préoccupations. Le projet de l’écrivain Boubacar Boris Diop consistant en la publication d’ouvrages (tels son
Des intellectuels africains ont déjà commencé, à leur niveau, à prendre des initiatives recoupant certaines de ces préoccupations. Le projet de l’écrivain Boubacar Boris Diop consistant en la publication d’ouvrages (tels son  En 2013 l’OUA aurait eu cinquante ans ; cinquante années marquées par des discours forts, des déclarations d’intention, des reniements et peu d’actes permettant d’aller au-delà du slogan. Il y a eu les blocs de Casablanca et Monrovia, l’UA longtemps après, puis encore plus récemment des initiatives telles que la « théorie des jeux » appliquée, par des chercheurs de l’Université de Dakar, à la problématique de l’Union des Etats africains pour aboutir à un objet artificiel dénommé :
En 2013 l’OUA aurait eu cinquante ans ; cinquante années marquées par des discours forts, des déclarations d’intention, des reniements et peu d’actes permettant d’aller au-delà du slogan. Il y a eu les blocs de Casablanca et Monrovia, l’UA longtemps après, puis encore plus récemment des initiatives telles que la « théorie des jeux » appliquée, par des chercheurs de l’Université de Dakar, à la problématique de l’Union des Etats africains pour aboutir à un objet artificiel dénommé :  Laurent Liautaud, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Laurent Liautaud, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?