
Depuis plusieurs mois, un même débat faisait rage, dans de nombreux pays africains. Au Burundi, au Burkina Faso, au Bénin, au Congo, en République démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda pour ne citer qu’eux, la classe politique et les citoyens se déchiraient sur une éventuelle révision de la constitution autorisant le chef de l’État à briguer un nouveau mandat, ce que la loi fondamentale, en l’état, lui interdit.
Les termes de la controverse ont radicalement changé le 30 et le 31 octobre. Au Faso, la contestation grandissante pour sauver la constitution et son article 37 – celui qui empêchait le président Compaoré de rempiler après 27 ans de pouvoir – s’est transformée en révolution. Un tournant politique qui sonne comme un avertissement pour tous les chefs d’État de la région.
Les arguments favorables à une révision constitutionnelle sont connus : stabilité du régime, paix et sécurité, approfondissement de politiques déjà engagées, voire adhésion de la population à la présidence en cours et à un changement de constitution qui pourrait dit-on être confirmé par référendum. Qu’en est-il des opinions inverses ? Voici les principaux arguments défendus par ceux qui s’opposent à tout “tripatouillage électoral”.
1- Parce que tout a changé depuis la Burkina
La révolution burkinabè annonce-t-elle des mouvements de contestation à venir dans les deux Congo, au Burundi, au Rwanda? Difficile à dire bien sûr. Le contexte a en tout cas radicalement changé depuis ces derniers jours d’octobre. Dans les pays concernés, les responsables de l’opposition ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : “la leçon qu’il faut tirer de cela c’est que les différents chefs d’État doivent comprendre que plus rien ne sera comme auparavant. Et ceci doit être une leçon qui doit être retenue pour chez nous aussi, où nous avons choisi la lutte pacifique», a ainsi déclaré Vital Kamerhe, leader de l’Union pour la nation congolaise (UNC) en RDC.
Certes, il y a plus de trois ans et demi déjà, avait lieu les printemps arabes. L’inquiétude était alors palpable dans certaines capitales africaines. Mais le Maghreb restait lointain, et la dégradation des conditions sécuritaires qui s’est installée depuis dans certains pays, devenait même pour certains chefs d’État un argument pour revendiquer leur indispensable rôle dans le maintien de la stabilité du continent.
Le cas burkinabè rebat incontestablement les cartes. D’abord parce qu’il est plus proche et repose exactement sur la même équation : toucher ou non à un article de la constitution devenu le totem qui cristallise les revendications de l’opposition. Ensuite, parce que le régime de Blaise Compaoré ressemblait à s’y méprendre à certains cités plus haut.
Le parallèle le plus parlant étant sans doute celui avec le Congo-Brazzaville. 27 ans de pouvoir pour le « beau Blaise », près de 30 pour Denis Sassou Nguesso, aux commandes depuis 1979 (malgré une interruption entre 1992 et 1997). Et une stratégie commune : se rendre indispensable sur la scène internationale. Un rôle de médiateur au Mali pour Compaoré, une médiation en Centrafrique pour Sassou Nguesso, très impliqué dans la crise en cours à Bangui.
2 – Pour permettre l’alternance
Faut-il empêcher un président qui fait du bon travail de le poursuivre s’il est soutenu par sa population ? Sans être absurde, l’argument reste au moins intrigant pour ceux qui, comme Compaoré ou Denis Sassou Nguesso, ont passé plusieurs dizaines d’années au pouvoir et ont eu tout le loisir de mettre en œuvre les politiques qu’ils estimaient utiles à leurs pays.
Les cinq pays pourront aussi prendre l’exemple du Sénégal avec son alternance pacifique entre Diouf et Wade en 2000, puis l’élection de Macky Sall en 2012, qui ont montré les vertus d’un changement à la tête de l’État pour assurer un renouvellement des élites et des pratiques du pouvoir ; ou celui du du Ghana où après deux mandats, le président Kufuor a cédé la place à son successeur Atta-Mills en 2009.
3 – Pour respecter ses engagements nationaux et internationaux
Les opposants à tout changement constitutionnel invoquent aussi le respect des engagements nationaux et internationaux des gouvernants. Ainsi dans bien des pays, la constitution envisage des possibilités de révision mais exclut précisément tout changement qui concernerait la durée et le nombre de mandats. C’est l’article 185 à Brazzaville ou le 220 à Kinshasa qui précise que “ le nombre et la durée des mandats du Président de la République (…) ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.”
Pour la Conférence épiscopale de RDC, qui ne cesse de réitérer son opposition à une révision constitutionnelle, “cet article pose les bases de la stabilité du pays et l’équilibre des pouvoirs dans les institutions. Le modifier serait faire marche en arrière sur le chemin de la construction de notre démocratie et compromettre gravement l’avenir harmonieux de la Nation”,
Sur le plan international, les cinq États cités ci-dessus ont également tous signé la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007 qui condamne dans son article 23(5) : “Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique, "qui représenterait un “changement anticonstitutionnel de gouvernement et passible de sanctions appropriées de la part de l’Union”.
4 – Pour dépersonnaliser la loi
Rarement des constitutions auront suscité autant de passions dans les capitales du continent, laissant une drôle d’image d’une Afrique où tout débat constitutionnel apparaît inextricablement lié à celui du maintien au pouvoir du chef, comme si chose publique et chose privée étaient inévitablement mêlées. On ne débat plus de la constitution pour de réelles raisons juridiques ou sociales mais bien pour l’adapter à une situation individuelle d’un président : la loi n’encadre pas l’exercice du pouvoir mais est aménagée en fonction de lui.
En 1995, quand l’Assemblée nationale ivoirienne obligeait tout candidat à la magistrature suprême à fournir la preuve que ses deux parents sont effectivement nés en Côte d'Ivoire, l’objectif ultime était de transformer en loi “le concept d’”ivoirité” imaginé par le président Henri Konan Bédié afin de disqualifier son principal rival Alassane Ouattara.
Quant au Congo-Brazzaville, l’article 58 de la constitution de 2002 interdit à tout candidat de plus de 70 ans de se présenter à la présidentielle. Son adoption visait moins à rajeunir la classe politique qu’à empêcher les concurrents de Sassou Nguesso de l’époque, comme Pascal Lissouba, de se présenter. Un verrou générationnel qui se retourne aujourd’hui contre celui qui l’a fixé puisque c’est désormais Sassou lui-même qui a atteint la limite d’âge…
5 – Pour la stabilité institutionnelle
“L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts mais d’institutions fortes”, affirmait Barack Obama en 2009 dans son discours d’Accra, précisant que l’Histoire n’est pas du côté de “ceux qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir”.
Une constitution comme toute construction humaine n’a aucune de raison d’être immuable. Mais les règles du jeu qu’elle instaure méritent au moins d’être éprouvées dans la durée. La plupart des pays cités ont des constitutions récentes : 2006 pour la RDC, 2005 pour le Burundi, 2003 pour le Rwanda, 2002 pour le Congo.
Entretenir l’instabilité institutionnelle, c’est mettre à mal la confiance des citoyens à l’égard de leurs dirigeants. Le Congo-Brazzaville est “le plus vaste cimetière institutionnel de l’Afrique”, dénonçait en 2001 l’universitaire Félix Bankounda. Depuis son indépendance en 1960, le pays a connu treize textes fondamentaux (six constitutions et sept actes fondamentaux), dont huit sous la seule présidence de Sassou Nguesso.
6 – Pour échapper à la caricature
Si la présidence à vie n’est pas l’apanage de l’Afrique, il n’en reste pas moins comme le note le journaliste Tirthankar Shanda que “sur les 19 chefs d’État qui ont accédé au pouvoir au siècle dernier et qui s’accrochent à leur place, 14 sont Africains !”. Après le Burkina, la communauté internationale sera peut être – qui sait ? – plus exigeante. La France avait prévenu à plusieurs reprises le président Compaoré, semble insister l’Élysée depuis quelques jours.
Mais il faudra sans aucun doute des concessions. Peut-on, défendre par exemple un ambigu statut d’immunité qui garantirait une sécurité économique et judiciaire à des chefs d’Etat qui, s’ils lâchent le pouvoir, redoutent la revanche de ceux qui l’ont trop longtemps attendu ? Ou offrir une (prestigieuse) porte de sortie aux présidents en place en leur attribuant de nouvelles missions dans des institutions internationales comme le proposait François Hollande à Compaoré dans un courrier du 7 octobre l’invitant à ne pas toucher à la constitution.
Ou même, si finalement maintien au pouvoir il y a, négocier de réelles contreparties. Car la conclusion du débat dépendra bien sûr de la situation bien particulière de chacun des pays. Un responsable de l’opposition burundaise confiait ainsi il y a quelques semaines qu’il avait “toutes les raisons de croire que Pierre Nkurunziza serait toujours président après 2015”, compte tenu des équilibres politiques de son pays. Mais il réclamait en échange “une vraie négociation pour ouvrir le jeu politique alors qu’il est complètement crispé. Pour cela nous aurons besoin d’un réel appui et de toute la pression de la communauté internationale”. Ce serait le moins.
Adrien de Calan
 L’échec du coup d’Etat en Turquie grâce à la mobilisation d’une large majorité de la population favorable à Recep Tayyip Erdogan doit nous interpeller en Afrique. Car d’abord, le continent détient malheureusement le record du plus grand nombre de putschs militaires, dont certains ont souvent provoqué des drames effroyables. Ensuite, nous devrions nous poser cette question : qui en Afrique affronterait les balles de soldats pour défendre un président menacé ?
L’échec du coup d’Etat en Turquie grâce à la mobilisation d’une large majorité de la population favorable à Recep Tayyip Erdogan doit nous interpeller en Afrique. Car d’abord, le continent détient malheureusement le record du plus grand nombre de putschs militaires, dont certains ont souvent provoqué des drames effroyables. Ensuite, nous devrions nous poser cette question : qui en Afrique affronterait les balles de soldats pour défendre un président menacé ?


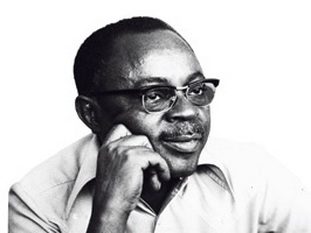

 Le 29 novembre, le peuple du Burkina Faso s’est rendu aux urnes pour élire leur prochain président et leurs députés. Roch Marc Christian Kaboré du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) a été officiellement déclaré
Le 29 novembre, le peuple du Burkina Faso s’est rendu aux urnes pour élire leur prochain président et leurs députés. Roch Marc Christian Kaboré du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) a été officiellement déclaré 









 La question des limitations de mandats présidentiels, plus d’un demi-siècle après les indépendances, reste plus que jamais au cœur des débats africains. Des tripatouillages et des tentatives de tripatouillages constitutionnels, orchestrés par des présidents « véreux » et avides de pouvoir sont régulièrement constatés sur le continent. Blaise Compaoré, après avoir passé plus d’un quart de siècle (27 ans) à la tête du Pays des Hommes Intègres, veut récidiver et tient mordicus à un passage en force pour être éligible aux futures élections présidentielles de 2015.
La question des limitations de mandats présidentiels, plus d’un demi-siècle après les indépendances, reste plus que jamais au cœur des débats africains. Des tripatouillages et des tentatives de tripatouillages constitutionnels, orchestrés par des présidents « véreux » et avides de pouvoir sont régulièrement constatés sur le continent. Blaise Compaoré, après avoir passé plus d’un quart de siècle (27 ans) à la tête du Pays des Hommes Intègres, veut récidiver et tient mordicus à un passage en force pour être éligible aux futures élections présidentielles de 2015.
 Dans
Dans C’est l’estomac noué et la gorge serrée que les citoyens de six pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’apprêtent à entrer dans une période électorale devenue synonyme, dans une trop grande partie du continent, de risque maximal de crise violente. Les premiers qui devraient être convoqués aux urnes sont les électeurs de Guinée Bissau où un scrutin présidentiel et des législatives censés tourner la page d’une période de transition sont prévus le 13 avril prochain. Dans ce pays lusophone, le seul de la région avec les îles du Cap-Vert, le calendrier électoral a été systématiquement perturbé depuis la démocratisation formelle au début des années 1990 par des coups de force militaires, des assassinats politiques et dernièrement par la mort naturelle du président. Mais c’est en 2015 que l’actualité électorale sera extraordinairement chargée.[1] Des élections présidentielles sont prévues au premier trimestre au Nigeria et au Togo, puis au dernier trimestre au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.[2]
C’est l’estomac noué et la gorge serrée que les citoyens de six pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’apprêtent à entrer dans une période électorale devenue synonyme, dans une trop grande partie du continent, de risque maximal de crise violente. Les premiers qui devraient être convoqués aux urnes sont les électeurs de Guinée Bissau où un scrutin présidentiel et des législatives censés tourner la page d’une période de transition sont prévus le 13 avril prochain. Dans ce pays lusophone, le seul de la région avec les îles du Cap-Vert, le calendrier électoral a été systématiquement perturbé depuis la démocratisation formelle au début des années 1990 par des coups de force militaires, des assassinats politiques et dernièrement par la mort naturelle du président. Mais c’est en 2015 que l’actualité électorale sera extraordinairement chargée.[1] Des élections présidentielles sont prévues au premier trimestre au Nigeria et au Togo, puis au dernier trimestre au Burkina Faso, en Guinée et en Côte d’Ivoire.[2]