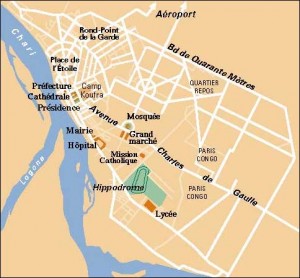Les entreprises qui cherchent à s’implanter en Afrique devraient sérieusement envisager de créer des représentations à Accra, Lusaka et Luanda si l’on en croît l’Indice de croissance des villes africaines publié le 28 janvier 2013 par MasterCard lors du forum Africa Knowledge. L'indice, produit pour le compte de MasterCard par le professeur George Angelopulo de University of South Africa, inclut 19 villes d’Afrique subsaharienne, en les classant en fonction de leur potentiel de croissance économique entre 2012 et 2017. Voici l'intégralité du classement des 19 villes sélectionnées dans l'indice :
Les entreprises qui cherchent à s’implanter en Afrique devraient sérieusement envisager de créer des représentations à Accra, Lusaka et Luanda si l’on en croît l’Indice de croissance des villes africaines publié le 28 janvier 2013 par MasterCard lors du forum Africa Knowledge. L'indice, produit pour le compte de MasterCard par le professeur George Angelopulo de University of South Africa, inclut 19 villes d’Afrique subsaharienne, en les classant en fonction de leur potentiel de croissance économique entre 2012 et 2017. Voici l'intégralité du classement des 19 villes sélectionnées dans l'indice :
01. Accra (Ghana) 02. Lusaka (Zambie) 03. Luanda (Angola) 04. Dar es-Salaam (Tanzanie) 05. Addis-Abeba (Ethiopie) 06. Nairobi (Kenya) 07. Kampala (Ouganda)
08. Johannesburg (Afrique du Sud) 09. Kinshasa (République Démocratique du Congo) 10. Durban (Afrique du Sud) 11. Cape Town (Afrique du Sud) 12. Mombasa (Kenya)
13. Lagos (Nigeria) 14. Abuja (Nigeria) 15. Dakar (Sénégal) 16. Harare (Zimbabwe) 17. Kano (Nigeria) 18. Abidjan (Côte d'Ivoire) 19. Khartoum (Soudan).
Les capitales du Ghana, de la Zambie et de l'Angola ont été identifiées comme les villes d'Afrique subsaharienne qui ont le plus grand potentiel de croissance économique au cours des cinq prochaines années. Khartoum, la capitale du Soudan devrait afficher la plus faible croissance de toutes les villes incluses dans l'étude. Pour compiler l'index, le professeur Angelopulo a examiné diverses données relatives au niveau de la croissance économique des villes. Selon lui, la capitale ghanéenne Accra est en tête de liste en raison de la croissance de son PIB par habitant ces dernières années, de celle de la consommation projetée, de son environnement réglementaire solide, et de la relative facilité d’y faire des affaires par rapport à d'autres villes africaines.
Johannesburg, le centre économique de l’Afrique du Sud est moins bien classé sur la liste en raison de prévisions de croissance atone dues à sa relative maturité par rapport à d'autres villes du continent. Harare (Zimbabwe), Kano (Nigeria), Abidjan (Côte d'Ivoire) et Khartoum (Soudan) ont été considérées comme les pôles ayant le potentiel de croissance le plus faible parmi les 19 villes examinées dans l'étude. Bien que ces villes aient obtenu de bons scores dans certaines catégories, comme l'indice global de la santé ou le niveau des investissements directs étrangers, leur potentiel de croissance a été affecté par de faibles scores dans des domaines tels que les environnements politiques et réglementaires, ralentissement de la croissance économique historique et les difficultés d’y faire des affaires.
Bâtir une stratégie à l'échelle des villes plutôt que des pays
Les Nations Unies estiment que la population urbaine de l'Afrique va tripler d'ici 2050, pour atteindre 1,23 milliards de personnes. Il est prévu que d’ici là, 60% de la population du continent vivra dans des zones urbaines. « L'un des principaux défis économiques et sociaux de l’Afrique est de savoir comment ses villes attireront d'importants investissements étrangers en étant compétitives au niveau mondial, servant de pôles d'attraction pour l'investissement et la croissance, de points chauds de l'innovation et, surtout, en développent des environnements d'affaires intéressants et prospères », a déclaré Georges Angelopulo.
L'année dernière, le cabinet de conseil McKinsey a suggéré dans un rapport que les villes et non les pays, devraient orienter les décisions d'investissement en Afrique, notant que « la plupart des entreprises n'étudient pas les villes quand elles calibrent leurs stratégies ». Le cabinet a constaté que « moins d'un cadre dirigeant sur cinq prennent leurs décisions d'implantation et de recrutement à l’échelle de la ville, plutôt qu’à l’échelle des pays ». Or le rapport indique que les entreprises qui comprennent l’évolution des marchés urbains dans leurs secteurs d’activités et qui bâtissent une présence précoce à une échelle suffisante sont susceptibles de bénéficier d'être les précurseurs jouissant d'un meilleur accès au marché et des marges les plus élevées. « Regarder les villes plutôt que les pays peut être révélateur. Prenez l’exemple des produits pour la lessive. Nous nous attendons à voir plus de croissance des ventes de ces produits à São Paulo qu’en France ou en Malaisie au cours de la prochaine décennie », souligne l’étude.
La croissance de l'urbanisation, combinée au fait que le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers les marchés émergents dynamiques tels que ceux trouvés en Afrique, signifie que les villes du continent joueront un rôle beaucoup plus important dans la croissance économique de leurs pays respectifs.
Séverine Dupont, article initialement paru chez notre partenaire Next-Afrique