Négritude, Egypte Pharaonique Noire etc. Pendant plusieurs décennies, des intellectuels africains ont été très actifs pour relancer une conscience africaine plus optimiste, plus positive et tenter de donner au continent sa dignité, sa respectabilité. Mais sans la prise de conscience de la nécessité des connaissances géostratégiques, ils ont pour la plupart été plus un problème pour l'Afrique qu'une solution, relayant, souvent en bonne foi des théories et des pseudo-solutions préparées par le système dominant pour asservir tout un continent.
L'EXEMPLE DE L'EGYPTOLOGIE
Les Africains qui vivent en Afrique ou en Occident sont pris dans le tourbillon de la pensée unique occidentale et dès lors, ils sont formatés à prier, à aimer, à haïr, à réfléchir, à s'énerver, à protester, à se rebeller selon les critères bien définis par le système dominant et duquel il est difficile de s'échapper. C'est dans ce cadre que l'Egypte s'est naturellement présenté comme échappatoire virtuel, offert par le système pour donner l'illusion aux Africains de compter ou tout simplement d'avoir eux aussi compté 3000 ans auparavant. Ce qui était bien entendu ingénu et naïf de la part de ceux qui sont tombés dans le piège.
 Pourquoi ce sont les intellectuels Africains dits "francophones" qui sont les plus impliqués dans l'égyptologie ? Ce n'est surement pas pour leur proximité géographique avec l'Egypte. Mais tout simplement parce qu'en Europe c'est en France qu'on parle le plus de l'Egypte antique. Notamment dès 1799 grâce à la formalisation de l'ouvrage monumentale en 37 volumes dénommé "Description de l'Egypte", du chef de l'expédition militaire de Napoléon Bonaparte, le général français Jean-Baptiste Kleber, cet ouvrage sera publié en 19 ans, c'est-à-dire entre 1809 et 1828 couvrant 4 thèmes : l'Antiquité égyptienne, l'état moderne, l'histoire naturelle et l'atlas géographique de l'Egypte.
Pourquoi ce sont les intellectuels Africains dits "francophones" qui sont les plus impliqués dans l'égyptologie ? Ce n'est surement pas pour leur proximité géographique avec l'Egypte. Mais tout simplement parce qu'en Europe c'est en France qu'on parle le plus de l'Egypte antique. Notamment dès 1799 grâce à la formalisation de l'ouvrage monumentale en 37 volumes dénommé "Description de l'Egypte", du chef de l'expédition militaire de Napoléon Bonaparte, le général français Jean-Baptiste Kleber, cet ouvrage sera publié en 19 ans, c'est-à-dire entre 1809 et 1828 couvrant 4 thèmes : l'Antiquité égyptienne, l'état moderne, l'histoire naturelle et l'atlas géographique de l'Egypte.
L'histoire démarre le 19 Mai 1798, lorsque pour contester l'Egypte au Royaume Uni, Napoléon Bonaparte lance 400 navires de guerre avec 50.000 personnes à bord pour contrôler le port de Suez, point stratégique de la route des Indes orientales, mais aussi tout le patrimoine laissé par les antiques Egyptiens. Avec les militaires, sont embarqués les scientifiques, les ethnologues, les historiens qui seront à l'origine de l'ouvrage cité plus haut. Les missionnaires chrétiens vont s'en servir pour développer les théories les plus invraisemblables pour justifier l'expédition coloniale sur tout le continent africain, en ramenant le tout à une division biblique des races comme décrit dans le chapitre de la Genèse. La technique de manipulation de certains d'entre eux est celle de magnifier le géni des africains dans l'antiquité égyptienne et constater leur nullité du présent pour en expliquer la décadence et donc l'urgence de les sauver par une nouvelle civilisation. Puisque de toutes les façons les africains ne sont que des maudits soit parce qu'ils descendent du méchant Caïn qui tue son frère Abel, soit parce qu'ils viennent de Canaan l'un des 3 enfants de Noé, maudit par le père pour s'être moqué de lui parce que sourd et dénudé.
L'administration coloniale va y fonder son principal espoir pour diviser les Africains afin de mieux régner entre ceux prétendument venus d'Egypte nécessairement plus intelligents, plus entreprenants, plus beaux et les autres, plus laids, plus fainéants. Alors que les premiers sont des dépravés, des immoraux par nature, les autres sont des pacifiques et des abrutis parce que primitifs et peuvent être plus malléables pour servir les intérêts de l'Europe, voilà pourquoi ils pourront facilement être associés au pouvoir, alors que les premiers en seront exclus.
Ainsi, ce sont les prêtres français pour la plupart qui parleront de l'Egypte pharaonique noire. le prêtre F. Coulbois écrit en 1901 : "Ne serait-ce pas l'indice que ce peuple de l'Ouzighé (au Burundi), voisin d'ailleurs des sources du Nil, a la même origine que les anciens habitants du pays des Pharaons?" L'un des idéateurs de la Négritude (dite Koutchiste), l'Abbé Léonard Dessailly écrit en 1898 dans : Le Paradis terrestre et la race nègre devant la science" : "Les Kouchites sont venus de Susiane, où ils avaient construit la première civilisation avant de se disperser et ils n'en étaient pas moins des Nègres, voire des Négrilles. Ensuite chaque recul de la civilisation égyptienne est liée à la poussée de ces "kouchites" nubiens sur les descendants Miçraïm moins dégradés".
Certains intellectuels africains et d'origine africaine vont relayer les insultes de L. Dessailly en reproposant à leur manière la même Négritude. D'autres vont offrir de nouveau quant à eux l'Egypte pharaonique noire sans au préalable apporter les éléments contredisant les insultes du père Coulbois et les autres. Pire, ils n'ont nullement cherché de couper ce cordon biblique de la prétendue déchéance de la Génèse et la dégradation de la civilisation triomphante de l'Egypte antique vers les "Nègres Abrutis" modernes dont parlent ces prêtres.
L'historien français Jean-Pierre Chrétien (né en 1937) dans son livre très documenté intitulé "L'invention de l'Afrique des Grands Lacs" publié aux éditions Karthala en 2010 nous dévoile ce côté obscur des relations Europe-Afrique en nous expliquant comment les missionnaires français ont réussi à imposer la France même dans les régions d'Afrique où elle n'était pas présente en orientant la pensée des chercheurs et des observateurs en leur faisant partager leur propre regard culturel sur ces pays. Il met le doigt sur la complicité des Africains qui ont développé l'égyptologie vue sous l'angle de la hiérarchisation des valeurs civilisationnelles, sans comprendre qu'en le faisant, ils contribuaient tout simplement à alimenter et valider une partie de l'histoire africaine construite dans le but de déstabiliser les sociétés africaines et non pour les glorifier.
QUELLES LECONS POUR LA JEUNESSE AFRICAINE ?
A chaque époque de la vie d'un village, d'une nation ou d'un continent, correspond la contribution sociétale de ses sages, de ses penseurs, de ses intellectuels. Lorsqu'on se penche sur l'Afrique, et pose une question des plus anodines, à savoir : en quoi les sages africains ont-ils influencé la pensée politique ou le model économique du continent africain depuis la fin de l'occupation européenne de l'Afrique à ce jour? La réponse est connue et malheureusement pas des plus glorieuses, c'est-à-dire, peu ou quasi nulle. La plupart ont renoncé à chercher les solutions aux problèmes d'un présent peu glorieux, pour se refugier dans la contemplation d'un passé victorieux.
On dit que c'est le passé qui nous permettra de comprendre le présent et mieux préparer l'avenir. C'est dans cette logique que des intellectuels africains ont approfondie l'étude de l'Egypte antique avec brio. Mais je crois que cela a été une erreur qui a fait perdre à l'Afrique un temps précieux dans la bataille pour sa liberté mentale. Je suis convaincu au contraire que c'est en maitrisant le présent que nous serons en mesure de comprendre le passé ou tout au moins d'interpréter le passé avec moins de subjectivité servile. Le passé ne nous renseigne pas sur ce que nous voulons savoir. Le passé est une construction subjective des histoires glorieuses des plus aisés, de la minorité des plus riches. L'histoire est biaisée par sa conception.
J'ai parcouru pendant plus de 20 ans les routes des musés d'Europe pour comprendre le passé des Européens. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que je n'avais rien compris du tout, car tous les objets présentés dans ces musés ne retraçaient que le quotidien des riches, tous les témoignages n'étaient en dernier ressort que l'expression écrite de la minorité aristocratique, bourgeoise et cléricale, jamais l'expression du peuple, le plus souvent analphabète. Ces musées racontaient tous une partie de l'histoire du passé européen. Et non l'histoire.
C'est pour cette raison que j'ai toujours eu du mal à m'approprier de l'histoire de l'Egypte antique comme africain, parce qu'aussi glorieuse soit-elle, elle n'est pas mon histoire, elle est une partie de mon histoire, elle est une infime partie de l'histoire africaine, celle des nantis, celle des plus riches, celle des puissants même dans l'Egypte antique. S'il est prouvé que je viens de cette frange de population africaine en provenance d'Egypte pharaonique, à 99%, il est de loin plus probable que mes ancêtres dans cette Egypte antique fassent plutôt partie du peuple, fasse partie de la masse des pauvres, souvent même esclaves et dont j'ignore complètement l'histoire. Et cela n'a donc pas de sens que je me mente à moi même me revigorant en m'identifiant à l'histoire sélective de la vie des dominants du passé, dans l'espoir de m'en servir pour sortir de ma peu envieuse position du dominé d'aujourd'hui. C'est un comportement qui trahit la naïveté intellectuelle de ses auteurs, car se faisant, ils ont indirectement validé le sort d'humiliation que le dominant d'aujourd'hui inflige aux Africains, oubliant systématiquement toutes nos aspirations, nos frustrations, nos revendications, nos angoisses, nos peurs, notre spiritualité, oubliant nous-mêmes, comme être humains.
Cela a-t-il un sens pour la Grèce d'aujourd'hui de passer son temps à revendiquer la paternité de la démocratie si elle croule sous les dettes et ce sont les financiers des marchés boursiers à gérer de fait le pays? De même, quel sens cela a-t-il pour les intellectuels africains de magnifier les pyramides de l'Egypte antique pour ensuite aller mendier la construction d'une minable salle de classe dans le Sahel ?
En validant la thèse des dominants dans l'Egypte antique, et en nous l'appropriant comme notre unique histoire dans cette Egypte certainement complexe, ils ont accepté et validé le statu quo actuel imposé à l'Afrique par le dominant, de la fragmentation du continent africain en micro états à la disparition progressive et inexorables des langues africaines toujours de moins en moins parlées au profit des langues du dominant. Car ils ont fait comme si rien n'était plus important de l'Egypte.
Voilà pourquoi l'histoire ne nous aide pas à comprendre le présent, mais c'est en maitrisant le présent, en domestiquant le présent que nous aurons les moyens financiers et humains pour étudier le passé, pour comprendre notre propre passé. C'est en nous concentrant à comprendre les pièges que le dominant nous a mis dans le présent pour nous empêcher de nous réveiller que nous réussirons à acquérir notre indépendance mentale, sans laquelle notre appréciation du passé ne pourra être que biaisé et déformé sous le lente grossissante du dominant du présent (Occident). Et nous ne pourrons nous réfugier que dans la consolation et la fascination de la gloire du dominant du passé (Egypte Pharaonique). Pour moi, cela n'a aucun sens de tout miser sur l'Egypte antique pour notre renaissance s'il faut attendre que ce soit les archéologues européens à nous fournir les détails de ce qu'ils ont trouvé, s'il faut aller dans les musées européens pour voir les objets africains, parce que les pays africains n'ont pas l'argent pour entretenir des musées.
Lorsque le général Kleber crée la première section africaine de la Franc-maçonnerie à Alexandrie en 1800, dénommée Loge Isis, l'idée est celle de façonner une classe dirigeante servile africaine qui pourra prendre le pouvoir dans ce qu'on a appelé l'Administration Indirecte, c'est-à-dire, des laqués, des prête-noms, des sous-préfets. C'est cette administration indirecte qui prendra ensuite dans les années 1960, le nom de "Indépendance". Aujourd'hui, les intellectuels africains (politiciens, économistes, juristes, médecins) qui y sont affiliés ont-ils compris le sens 212 ans après ?
J'ai passé 14 ans en Chine pour comprendre que les Africains avaient presque tous une seule façon de raisonner, de réfléchir et c'était le format européen. Ils ont été tous façonnés au mode de pensée européenne, à l'approche européenne, à la corruption européenne, à la violence européenne, à la politique européenne, à la division sociale européenne, à l'organisation étatique européenne, à la diplomatie européenne. C'est dans le prisme européen que vivent les africains. Et mêmes les contestations, les rebellions, les guerres civiles sont prévisibles et sont menées dans ce format européen. Les programmes scolaires sont européens, les vacances scolaires tiennent compte des saisons en Europe et non des saisons en Afrique. Les journées de travail, de repos hebdomadaire judéo-chrétiens sont européens. Cela a-t-il un sens pour des intellectuels africains noyés à l'idéologie de la supériorité européenne de revisiter objectivement le passé africain jusqu'à nous servir une référence comme celle égyptienne? Je ne crois pas. C'est pour cela que je pense que la priorité reste à comprendre le présent, à décrypter les pièges du présent et chercher comment en sortir. Le jour où nous aurons la tête hors de l'eau, nous pourrons sereinement réécrire notre histoire avec beaucoup de recul, parce qu'il n'y a pas à mon avis la souveraineté de la pensée sans la souveraineté des moyens pour construire cette pensée. Et l'intellectuel africain est même plutôt dangereux dès lors qu'il n'est pas conscient de la capacité du système à le manipuler.
Par JEAN-PAUL POUGALA, écrivain camerounais, Directeur de l’Institut d’Etudes Géostratégiques et professeur de sociologie à l’Université de la Diplomatie de Genève en Suisse.
Article publié sur le site de notre partenaire Next-Afrique

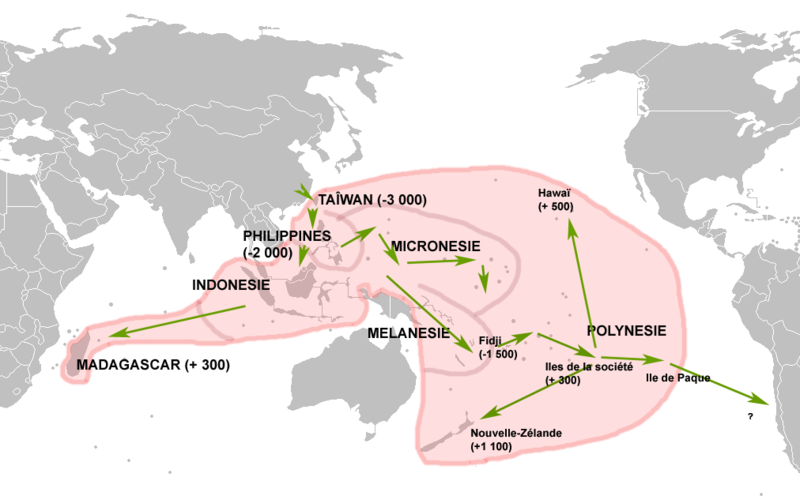
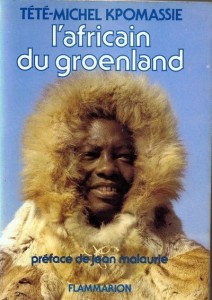



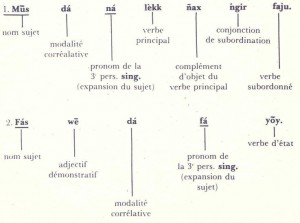







 Depuis leur indépendance, les pays africains n’ont connu que des politiques dirigées par des gouvernements ayant des pouvoirs sans limite. Certains ont affirmé être socialistes, d’autres libéraux, mais la finalité a été la même : l’Etat décide de tout et la population reste captive de ses caprices évoluant au gré de ses « soutiens » internationaux. Toute politique planifiée par essence est vouée à l’échec, qu’elle soit importée ou pas. En effet, le marché s’adapte en permanence, étant, tout simplement, la combinaison de toutes les volontés individuelles ; il est en l’Homme, il est l’essence même de l’humanité : l’échange. Or, la planification va à l’encontre de cette dynamique permanente et peut s’apparenter à la pose d’un garrot sur une jambe : le sang cesse de circuler, les tissus meurent, il faut couper. L’économie fonctionne de même et les garrots de la planification la dégradent à chaque intervention. Dans un tel contexte, on peut comprendre le mal-être de ces intellectuels qui crient à l’invasion de modèles infructueux.
Depuis leur indépendance, les pays africains n’ont connu que des politiques dirigées par des gouvernements ayant des pouvoirs sans limite. Certains ont affirmé être socialistes, d’autres libéraux, mais la finalité a été la même : l’Etat décide de tout et la population reste captive de ses caprices évoluant au gré de ses « soutiens » internationaux. Toute politique planifiée par essence est vouée à l’échec, qu’elle soit importée ou pas. En effet, le marché s’adapte en permanence, étant, tout simplement, la combinaison de toutes les volontés individuelles ; il est en l’Homme, il est l’essence même de l’humanité : l’échange. Or, la planification va à l’encontre de cette dynamique permanente et peut s’apparenter à la pose d’un garrot sur une jambe : le sang cesse de circuler, les tissus meurent, il faut couper. L’économie fonctionne de même et les garrots de la planification la dégradent à chaque intervention. Dans un tel contexte, on peut comprendre le mal-être de ces intellectuels qui crient à l’invasion de modèles infructueux.

