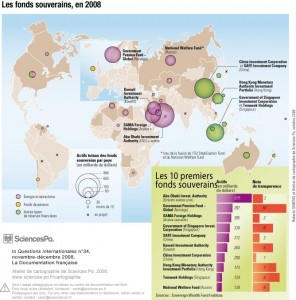Synthèse de nos publications sur le thème du forum green business
 A partir de la définition donnée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’économie verte se caractérise par des activités de production et de consommation impliquant un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Pour adapter cette définition très générale au contexte africain, (Kempf 2014) a réalisé une quinzaine d’entretiens auprès d’entrepreneurs locaux au Congo Brazzaville. Ces entrepreneurs sont actifs dans les domaines de la transformation agro-alimentaire, de la gestion des déchets, de l’eau et de la santé.
A partir de la définition donnée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’économie verte se caractérise par des activités de production et de consommation impliquant un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Pour adapter cette définition très générale au contexte africain, (Kempf 2014) a réalisé une quinzaine d’entretiens auprès d’entrepreneurs locaux au Congo Brazzaville. Ces entrepreneurs sont actifs dans les domaines de la transformation agro-alimentaire, de la gestion des déchets, de l’eau et de la santé.
De ces entretiens, il ressort que les entreprises « vertes » cherchent à mettre en avant des circuits courts de commercialisation (CCC) et des modes de production plus intégrés. Comme le montre l’analyse de (Libog, Lemogo, and Halawa 2013), l’adoption et la vulgarisation des CCC permettrait à coup sûr une réelle revalorisation de la production locale et la rendrait plus compétitive avec l’augmentation des revenus des petits producteurs, une meilleure productivité, l’émergence d’une agriculture respectueuse de l’environnement et le développement des économies régionales et sous-régionales.
Lorsqu’on considère les activités menées par les entrepreneurs « verts », nos analyses montrent qu’il existe de réelles opportunités à saisir dans l’émergence de l’économie verte en Afrique ; en particulier dans l’agriculture biologique et la gestion des déchets.
En effet, selon l’analyse de (Houngbonon 2014), l’Afrique dispose d’énormes atouts dans la production des produits d’agriculture biologique compte tenu de la qualité de ses terres agricoles et de leur disponibilité. Plus spécifiquement, le faible développement de l’agriculture intensive en Afrique implique une faible utilisation des pesticides, ce qui rend les terres agricoles africaines plus appropriées à l’agriculture biologique. De plus, le continent dispose encore d’énormes superficies de terres agricoles non encore exploitées. Par exemple, en 2010, seulement 40% des terres agricoles en Afrique sont cultivées ; cette proportion chute à 25% en Afrique Centrale. Se basant sur ces atouts, il recommande de former les paysans africains à l’agro-écologie et de mettre en place des normes de certification équivalentes aux standards européens et américains.
Dans ces conditions, l’agriculture biologique pourra nourrir l’Afrique à sa faim selon (Morghad 2012). A partir d’une expérience menée en Ethiopie et citée dans une étude de l’Institut du Développement Durable, l’auteure explique comment l’agriculture biologique a permis d’améliorer les rendements agricoles dans une région souffrant de sécheresse et de la désertification. Toutefois, ce rôle clé de l’agriculture biologique risque d’être compromis par les accords de partenariats économiques en cours de signature par la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne comme l’a souligné (Halawa 2014) dans un article sur le sujet. En effet, à partir des résultats de plusieurs études, il relève l’impact négatif que peuvent avoir ces accords sur la diversification des économies africaines et en particulier sur l’agriculture biologique.
Ainsi, la promotion de l’agriculture biologique requiert une réponse globale alliant à la fois l’accès au financement, la formation des agriculteurs, la mise en place des normes de certification et la négociation d’accord commerciaux qui placent l’agriculture biologique au cœur de ses préoccupations.
Quant à la gestion des déchets, (Kempf 2012) se base sur un rapport de la Banque Mondiale qui montre qu’en 2005, l’Afrique ne représentait que 5% de la production mondiale de déchets. Plus de la moitié (57%) de sa production est constituée de déchets organiques, donc valorisables sans trop de difficultés. Bien entendu, la part de l’Afrique dans la production mondiale de déchets est amenée à augmenter avec la croissance économique et démographique ; il en va de même pour la composition des déchets qui deviendra plus complexe. Cette évolution transforme les déchets en formidable opportunité d’affaires pour les entrepreneurs souhaitant s’engager dans l’économie verte. Cependant, à partir d’entretiens réalisés auprès d’entrepreneurs du secteur, (Kempf 2013) rapporte que la faible structuration de la filière des déchets, et en particulier le peu d’opportunités de valorisation, demeurent l’une des principales difficultés pour relever le défi des déchets africains.
De même, (Madou 2014) montre qu’à Abidjan, la gestion des déchets souffre d’un manque d’efficacité dans l’organisation du secteur. Typiquement, la persistance du secteur informel, le manque de matériel adapté et de formation du personnel, la gestion des décharges publiques sont à l’origine de cette absence d’efficacité. Un développement de l’activité de gestion des déchets passera donc par la revalorisation du service auprès des ménages, le recyclage des déchets, la formation du personnel et une plus forte implication de l’Etat dans l’organisation du secteur, en particulier dans la gestion des décharges publiques. Les PME restent cependant des acteurs clés pour le développement du secteur et son efficacité.
L’émergence d’une économie verte ne saurait enfin se faire sans un accès à l’énergie pour tous, en particulier en milieu rural. Cela est d’autant plus crucial lorsqu’on sait que plus 95% de la population rurale n’a pas accès à l’énergie dans plusieurs pays africains, comme le Bénin, Madagascar, le Niger et la Zambie, alors même que le développement d’activités nécessitant de l’énergie telles que l’agriculture biologique auraient un très fort impact en milieu rural. La principale raison identifiée par le Club des agences et structures en charge de l’électrification rurale est la difficulté d’accès au financement. Comme l’a souligné (Sinsin 2014), celle-ci est liée à la faible densité de la population dans les zones rurales qui ne favorise pas la rentabilité d’une extension du réseau électrique dans ces zones. A partir de projets tels que l’Expérience EDF, le GERES au Bénin et UpEnergy en Ouganda, Africa Express recommande une formation professionnelle adaptée et une sensibilisation des populations à l’échelle locale, une promotion des énergies locales décentralisées sur toute la filière à l’échelle régionale et enfin une mise en place de législation appropriée à l’échelle nationale pour inciter le secteur privé à investir dans les énergies renouvelables.
En définitive, l’économie verte peut être considérée comme une application concrète, pratique et viable du volet économique du développement durable. Elle présente d’énormes atouts pour l’Afrique et en particulier pour l’Afrique Centrale, que ce soit dans le domaine de l’agriculture biologique ou de la gestion des déchets. Elle a besoin d’être soutenue par un accès accru aux énergies renouvelables.
Nous en savons actuellement trop peu sur les politiques les plus efficaces à mettre en place pour soutenir l’émergence d’une économie verte en Afrique. Sur ce sujet, L’Afrique des Idées souhaite engager des études plus approfondies pour accompagner les décideurs publics à identifier les réponses les plus appropriées à l’émergence d’une économie verte en Afrique, et en particulier en Afrique Centrale.
Georges-Vivien HOUNGBONON
Références :
Halawa, Djamal. 2014. “Quels sont les enjeux des APE pour l’agriculture et l’industrialisation?” L’Afrique Des Idées.
Houngbonon, Georges Vivien. 2014. “L’Afrique peut-elle bénéficier de L’agriculture biologique ?” L’Afrique Des Idées.
Kempf, Véra. 2012. “Comment l’Afrique gère-t-elle ses déchets?” L’Afrique Des Idées.
———. 2013. “Comment mettre en valeur les déchets au Congo?” L’Afrique Des Idées.
———. 2014. “Economie Verte, de quoi parle-t-on ?” L’Afrique Des Idées.
Libog, Charlotte, Jerry Lemogo, and Djamal Halawa. 2013. “Les Circuits Courts de Commercialisation.” L’Afrique Des Idées.
Madou, Stéphane. 2014. “Comment gère-t-on les déchets domestiques à Abidjan?” L’Afrique Des Idées.
Morghad, Leïla. 2012. “L’agriculture biologique permettra-t-elle de nourrir l’Afrique à sa faim?” L’Afrique Des Idées.
Sinsin, Leonide Michael. 2014. “Quels financements pour l’accès à l’énergie en milieu rural?” L’Afrique Des Idées.