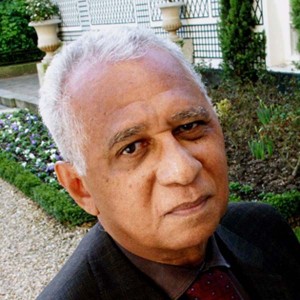L’Afrique des Idées a eu l’honneur de recevoir samedi 7 mars 2015 à Paris, Monsieur Mongi Marzoug[1], expert en télécommunications et Ministre tunisien des Technologies de l’Information et des Communications de décembre 2011 à Janvier 2014. Lors de cet échange passionnant, Monsieur Marzoug a partagé avec nous son expertise et son expérience en matière de Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications et présenté les questions fondamentales qu’elles mettent en jeu sur le continent africain.
L’Afrique des Idées a eu l’honneur de recevoir samedi 7 mars 2015 à Paris, Monsieur Mongi Marzoug[1], expert en télécommunications et Ministre tunisien des Technologies de l’Information et des Communications de décembre 2011 à Janvier 2014. Lors de cet échange passionnant, Monsieur Marzoug a partagé avec nous son expertise et son expérience en matière de Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications et présenté les questions fondamentales qu’elles mettent en jeu sur le continent africain.
La transition numérique, une grande question pour l’Afrique
Cette Rencontr’Afrique très enrichissante a mis en lumière les enjeux colossaux que présentent les Technologies de l’Information et des Communications en Afrique ; en effet, les télécommunications, et notamment l’Internet constituent un monde parallèle, un espace virtuel qui reflète les même réalités et opportunités que l’espace physique dans lequel nous évoluons ; existe ainsi dans ce monde virtuel du commerce électronique, de la politique, voire même des guerres du numérique.
Le problème de la réglementation du numérique
Puisque le monde virtuel est aussi complexe que le monde réel, il est nécessaire qu’existe une réglementation exhaustive encadrant tous ses aspects, qu’ils soient juridiques, économiques, sociétaux ou politiques. Monsieur Marzoug pointe la faiblesse, voire l’inexistence de la réglementation dans ce domaine en Afrique ; or il est nécessaire que des questions relatives à la protection et l’hébergement de données, à l’ouverture et à l’accès au réseau, à la confiance dans le numérique, à la transparence ou encore à la gestion des trafics soient encadrées juridiquement.
En outre, il est impératif que les Etats adoptent des réglementations adaptées à l’économie numérique (services numériques et accès, infrastructures du numérique, protection des données, fiscalité, et autres), et instaurent des règles équitables entre les différents acteurs de l’économie numérique, fondées sur les services offerts et non les technologies utilisées (« same services, same rules ») ; à cet égard, les entreprises du Net (ou Over The Top) posent une véritable question ; les géants de l’internet tels que Google ou Amazon offrent des services et récoltent des bénéfices dans les pays d’Afrique, tout en étant basés à l’étranger, échappant ainsi à toute réglementation ou fiscalité, alors qu’ils devraient être soumis aux mêmes règles que les opérateurs qui fournissent des services en étant basés sur le territoire de l’Etat concerné.
Un secteur privé dynamique et des Etats en retrait
Le fait marquant à l’égard des réseaux mobiles en Afrique est leur ouverture à l’investissement privé d’une part, et étranger d’autre part. Il y a donc des enjeux économiques colossaux, et cette ouverture à l’investissement privé pose la question du service public ou du service universel des télécoms. En effet, les opérateurs qui bénéficient de licences ont tendance à déployer leurs services dans les zones urbaines qui sont les plus rentables, tournant ainsi le dos aux zones reculées et moins peuplées. Il est nécessaire donc que les Etats imposent à ces investisseurs privés de participer financièrement au service public des télécoms pour assurer sa continuité, et ce même dans les zones les plus en retrait.
Par ailleurs, il est de la responsabilité des gouvernements africains garantir la qualité des services de télécommunications offerts à leurs citoyens ; à cet égard, on observe, suite à l’octroi de licences à des opérateurs privés, peu de suivi de l’exécution de ces licences.
Beaucoup d’Etats africains travaillent à implémenter une identification numérique de leurs citoyens, qui permettrait à ces derniers d’accéder en ligne aux services de l’Etat et des entreprises publiques, et faciliterait leurs relations avec les administrations publiques ; dans ce cadre il est nécessaire de garantir la sécurité de des flux et stockage des données.
Un modèle à définir pour le développement du numérique
Pour les Etats africains se pose la question du modèle à adopter pour le développement du numérique : faut-il développer une industrie des télécoms, ou focaliser les efforts sur le développement des services numériques ? Selon Monsieur Marzoug, les ressources humaines et financières en Afrique sont insuffisantes pour développer une industrie complète des télécoms ; il serait préférable d’effectuer des choix sur des segments pour lesquels des ressources et compétences existent.
 A propos de l’utilisation de satellites pour garantir l’accès au réseau, à l’image des fameux « Ballons Google », qui visent à permettre l’accès à internet dans les zones reculées, Monsieur Marzoug note, qu’au-delà des questions d’autorisation et de licence qu’ils soulèvent s’agissant de Google, leur efficacité trouve ses limites dès lors que l’on se trouve en présence d’une importante concentration de population. Ainsi, s’ils peuvent être adaptés pour couvrir des zones vastes et peu peuplées, un réseau de type cellulaire est nécessaire pour garantir l’accès au réseau dans les zones à forte concentration de population.
A propos de l’utilisation de satellites pour garantir l’accès au réseau, à l’image des fameux « Ballons Google », qui visent à permettre l’accès à internet dans les zones reculées, Monsieur Marzoug note, qu’au-delà des questions d’autorisation et de licence qu’ils soulèvent s’agissant de Google, leur efficacité trouve ses limites dès lors que l’on se trouve en présence d’une importante concentration de population. Ainsi, s’ils peuvent être adaptés pour couvrir des zones vastes et peu peuplées, un réseau de type cellulaire est nécessaire pour garantir l’accès au réseau dans les zones à forte concentration de population.
Pour le développement des infrastructures haut débit (mobiles et fixes), la meilleure solution pour les Etats consisterait donc à mettre en place le partage d’infrastructures en particulier dans l’accès avec des processus de planification et de coordination efficaces entre les autorités et les différents opérateurs des services de communication électronique.
Dans la plupart des Etats africains, les infrastructures existantes étaient suffisantes pour le développement de la 2G, mais il faut maintenant les améliorer pour développer le haut débit mobile (3G et 4G) et fixe, notamment grâce à la fibre optique. Des solutions hybrides permettraient d’améliorer la qualité des réseaux en minimisant les coûts; dans ce cadre une coordination entre tous les opérateurs de télécoms pour le partage de l’accès à la fibre optique serait nécessaire.
Rouguyatou Touré
[1] Mongi Marzoug est directeur dans le Groupe Orange en charge de la gouvernance de l'Internet et du développement du Numérique. Il était ministre des Technologies de l'Information et de la Communication de décembre 2011 à janvier 2014 en charge des technologies du numérique et des services postaux. Il a exercé entre 1999 et 2011 dans la direction technique du Groupe Orange. Il a occupé les fonctions de responsable du Département "Architecture & Fonctions", Directeur Adjoint chargé des études, de l'ingénierie et des produits, responsable du Département "Networks Quality & Cost Modeling", et enfin responsable du Département "Roaming, Networks Modeling & Performance". Auparavant, il était pendant dix ans à Orange Labs en charge des projets et équipes de R&D dans les domaines de télédétection, imagerie radar et planification des réseaux mobiles. Il est auteur d'un brevet sur la modélisation des interférences et l'affectation des fréquences dans un réseau mobile. Il est également auteur de plusieurs articles scientifiques dans des revues internationales en particulier IEEE et JAOT et de nombreux rapports techniques et communications dans des conférences et forums internationaux. Il est diplômé de l'“Ecole Polytechnique” et de Télécom ParisTech. Il est titulaire d'un doctorat en physique expérimentale et d'une Habilitation à Diriger des Recherches






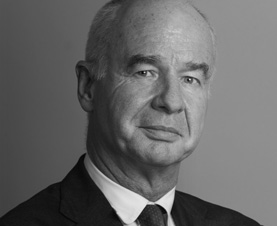

 L’Afrique a enregistré une croissance économique soutenue au cours des dix dernières années. En 2014, 17 pays africains (soit un tiers du continent) devraient enregistrer une croissance du PIB supérieur à 6,5%. De par ses performances économiques et de par sa stabilité politique qui se renforce, l’Afrique devient de plus en plus attractive, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes africains de la diaspora.
L’Afrique a enregistré une croissance économique soutenue au cours des dix dernières années. En 2014, 17 pays africains (soit un tiers du continent) devraient enregistrer une croissance du PIB supérieur à 6,5%. De par ses performances économiques et de par sa stabilité politique qui se renforce, l’Afrique devient de plus en plus attractive, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes africains de la diaspora.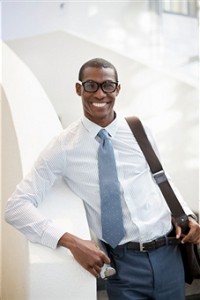 Le 2ème enseignement porte sur les principaux facteurs qui motivent les jeunes africains de la diaspora à retourner travailler en Afrique. 75% des répondants considèrent la volonté de s’impliquer dans l’essor du continent comme leur principale motivation à rentrer travailler sur le continent. L’attache familiale en Afrique est mentionnée par respectivement 43% des répondants. Il est intéressant de noter que les facteurs en lien direct avec la vie professionnelle sont considérés comme principales sources de motivation par moins de 25% des répondants. Il en va ainsi de la possibilité d’un plan de carrière plus rapide en Afrique qu’ailleurs (25%), de l’absence d’opportunités dans le pays où le répondant a fait une partie de ses études (14%), et plus frappant, de l’intérêt pour l’entreprise qui recrute (4%). Autrement dit, que ce soit Total au Gabon, la Société Générale au Sénégal ou Deloitte en Côte d’Ivoire, dans leur démarche de retour en Afrique, les jeunes africains de la diaspora attachent très peu d’importance à l’entreprise qui les recrute.
Le 2ème enseignement porte sur les principaux facteurs qui motivent les jeunes africains de la diaspora à retourner travailler en Afrique. 75% des répondants considèrent la volonté de s’impliquer dans l’essor du continent comme leur principale motivation à rentrer travailler sur le continent. L’attache familiale en Afrique est mentionnée par respectivement 43% des répondants. Il est intéressant de noter que les facteurs en lien direct avec la vie professionnelle sont considérés comme principales sources de motivation par moins de 25% des répondants. Il en va ainsi de la possibilité d’un plan de carrière plus rapide en Afrique qu’ailleurs (25%), de l’absence d’opportunités dans le pays où le répondant a fait une partie de ses études (14%), et plus frappant, de l’intérêt pour l’entreprise qui recrute (4%). Autrement dit, que ce soit Total au Gabon, la Société Générale au Sénégal ou Deloitte en Côte d’Ivoire, dans leur démarche de retour en Afrique, les jeunes africains de la diaspora attachent très peu d’importance à l’entreprise qui les recrute. 3 leviers majeurs pour attirer et conserver des jeunes talents issus de la diaspora
3 leviers majeurs pour attirer et conserver des jeunes talents issus de la diaspora L’Afrique contemporaine est l’objet de nombreux récits : celui des économistes, des sociologues, des démographes, des militants politiques, des historiens, des journalistes, des investisseurs… Ces récits occupent l’espace médiatique et académique, ils façonnent notre vision du continent africain.
L’Afrique contemporaine est l’objet de nombreux récits : celui des économistes, des sociologues, des démographes, des militants politiques, des historiens, des journalistes, des investisseurs… Ces récits occupent l’espace médiatique et académique, ils façonnent notre vision du continent africain.