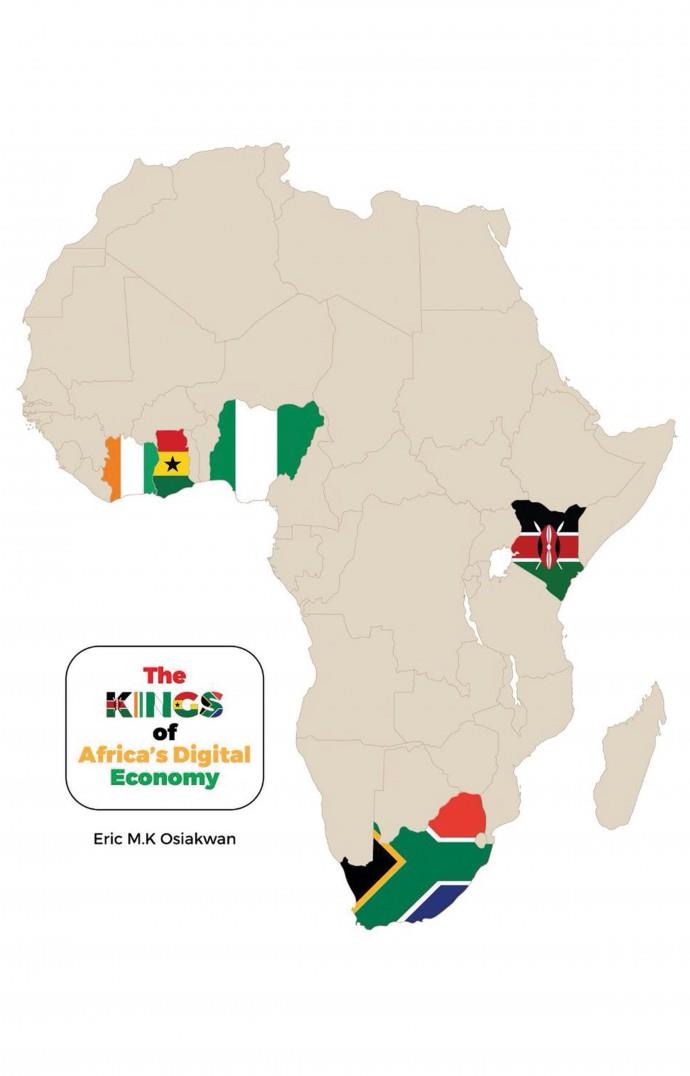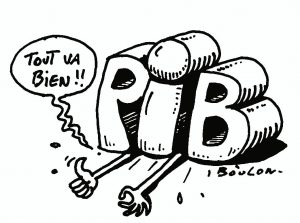 Alors que le débat autour de la redéfinition des indicateurs économiques se cristallise dans les sociétés occidentales, c’est d’Afrique que pourraient provenir des réformes audacieuses.
Alors que le débat autour de la redéfinition des indicateurs économiques se cristallise dans les sociétés occidentales, c’est d’Afrique que pourraient provenir des réformes audacieuses.
Dotés d’une croissance économique dynamique mais confrontés à des défis sociaux et environnementaux majeurs, certains pays du continent bénéficieraient d’ajustements de leurs indicateurs. Une meilleure gestion de ces défis nécessite en effet la création d’indicateurs pertinents et aptes à contrôler les évolutions (positives et négatives) dans ces domaines.
Au-delà d’une simple remise en question du PIB, c’est également l’opportunité d’une rupture idéologique inédite dans l’histoire économique et des relations internationales.
Un débat historique mais en suspens dans les économies occidentales
La limite de la croissance du PIB comme indicateur central dans notre appréhension et notre gestion des défis actuels est la question fondamentale. Historique, comptable et essentiellement quantitatif, il est en effet considéré comme caduc et inapte à mettre en lumière les problèmes sociaux et environnementaux contemporains. Reportant uniquement l’accroissement de la production, il ne révèle rien sur les évolutions sociales et environnementales de nos sociétés.
Depuis 1972, et le rapport « Limits to Growth » du Club de Rome, différentes contributions questionnent la « pertinence de ces données en tant qu’outils de mesure du bien-être sociétal » (Rapport « Stiglitz », 2008). Toutefois, jamais la mise en place d’indicateurs performatifs complémentaires au PIB ne s’est concrétisée.
Ces critiques militent pour l’ajout d’indicateurs propres aux questions sociales et à la préservation de l’environnement. On peut notamment évoquer les inégalités de revenus, la proportion d’individus vivant sous le seuil de pauvreté, l’accès à l’éducation, la pollution atmosphérique, la gestion des ressources en eaux, la dégradation des sols, etc. Il reste néanmoins important de noter que ces indicateurs ne doivent pas être substituables, c’est-à-dire que de bonnes performances dans un domaine ne doivent pas masquer de piètres résultats dans un autre. Ceux-ci permettraient de sortir d’une vision uniquement quantitative et d’orienter nos activités vers l’amélioration des conditions de vie des populations et la durabilité de nos écosystèmes.
Néanmoins, ces volontés d’ajustements se heurtent à de nombreux refus dans les sociétés occidentales. Tous se fondent en partie sur l’atonie actuelle de la croissance : en cette époque de croissance faible, la priorité serait son rétablissement, pas sa remise en question en tant qu’indicateur phare. Il leur semble déplacé de vouloir discréditer cet indicateur au moment précis où il vacille. C’est donc parce que ces sociétés cherchent aujourd’hui à renouer avec la croissance que les aspirations à revoir le modèle d’analyse sont écartées.
Une chance en Afrique subsaharienne ?
Il est donc approprié de se tourner vers des pays jouissant d’une croissance dynamique pour impulser cette initiative, notamment en Afrique de l’ouest francophone.
Le Sénégal ou la Côte d’Ivoire bénéficient, par exemple, de performances économiques saluées par des observateurs reconnus, comme la Banque Mondiale ou le cabinet McKinsey. Ils bénéficient d’une croissance stable, autour de 5% par an[1], depuis plusieurs années et les perspectives sont encourageantes.
Au-delà de leur croissance économique, c’est sa relative qualité qui en fait des candidats opportuns : ces économies sont relativement diversifiées, ne dépendent pas des exportations d’hydrocarbures et ont des marchés intérieurs dynamiques. Difficile donc d’objecter les mêmes critiques qu’en occident. Ces performances offrent également un certain prestige régional qui peut servir de catalyseur et, à terme, entrainer certains pays voisins, comme le Bénin ou le Togo, plus modestes et plus discrets sur la scène régionale.
Une réforme urgente au vu de la situation
Même si la croissance offre ici un avantage indéniable à ces économies, c’est surtout l’ampleur des défis à relever dans la région qui rend cette réforme urgente. Ces pays sont en effet les premiers concernés par les conséquences sociales et environnementales d’une croissance non-inclusive et d’une dégradation rapide de l’environnement.
La situation des littoraux d’Afrique de l’ouest[2] illustre cette urgence. Les industries minières et l’exploitation du sable accélèrent l’érosion du littoral, où vit plus du tiers de la population, et menace les écosystèmes naturels et les sociétés. Les destructions d’emplois issues de ces changements accentuent la précarité et la marginalisation socio-économique, en particulier des jeunes, ce qui amplifie la violence et les trafics. Il semble donc nécessaire de contrebalancer l’hégémonie de la croissance sur les décisions économiques et politiques par l’intégration d’indicateurs qualitatifs.
Outre cet exemple, c’est une prise de conscience plus large du danger inhérent aux facteurs quantitatifs qui est crucial. C’est le cas de la démographie et de l’urbanisation, qui sont encore trop souvent considérés comme des opportunités de fait et proclamés comme les principaux atouts du continent. En réalité, ces dynamiques quantitatives restent fondamentalement des défis à la stabilité de la zone.
L’évocation constante du « dividende démographique » illustre cette confusion entre quantitatif et qualitatif. La population de l’Afrique subsaharienne atteindra en effet plus de 2 milliards d’individus d’ici 2050 (environ 1.2 actuellement)[3] et sa main d’œuvre sera la plus abondante au monde, devant la Chine ou l’Inde. Ce « dividende » sous-entend que l’explosion démographique aurait naturellement un effet positif sur le développement général.
Néanmoins, ce lien est loin d’être évident. Comme le suggère la notion d’explosion, cette dynamique quantitative reste imprégnée du risque inhérent à l’accroissement rapide d’une population. Le dividende ne s’opère que si les services de base (logement, éducation, emploi, santé) sont fournis à l’intégralité des populations et si les jeunes intègrent le marché du travail sereinement. Marché sur lequel doivent se combiner formations adéquates et accessibles avec une offre suffisante d’emplois correspondants. Plus généralement, le dividende démographique est une conséquence d’une croissance inclusive et équitablement répartie à l’ensemble de la population et non un phénomène quantitatif, spontané et naturel.
Dans son dernier rapport[4], le cabinet McKinsey réalise également un raccourci optimiste sur les bénéfices de l’urbanisation rapide du continent. Vantant ses mérites, il passe brièvement sur les besoins qu’elle implique, concluant sur la nécessaire provision de « logements » et de « services ». Il aurait fallu être cynique pour évacuer le besoin de logements pour les nouveaux urbains, mais les auteurs n’ont pas approfondi la notion de « services », euphémisme osé qui englobe les minima requis pour des millions de citadins supplémentaires et sans lesquelles les bidonvilles grossiront.
A l’heure des plans ambitieux (notamment le Plan Sénégal Émergent[5]), ces réflexions sur les indicateurs ne sont donc pas de simples challenges intellectuels mais apportent des ajustements décisifs. Dépasser les paramètres quantitatifs (production, démographie, urbanisation) et superviser les évolutions sociales et environnementales est déterminant pour soutenir des trajectoires prometteuses mais encore fragiles.
Au-delà de la réforme technique : une révolution idéologique
Ce changement de paradigme implique également un recul idéologique vis-à-vis des politiques économiques traditionnelles en faveur d’un modèle endogène de croissance et de développement. Passée la période des plans d’ajustements structurels (caractérisée par le recul de la puissance publique et la rigueur budgétaire), les gouvernements régionaux suivent néanmoins encore les dogmes libéraux traditionnels dans leurs politiques. La suprématie de la croissance du PIB reste donc incontestable et favoriser des indicateurs complémentaires, malvenu. Les performances du PIB sont notamment un sésame précieux pour obtenir le soutien des bailleurs internationaux et elles focalisent donc l’attention de gouvernements.
Cette innovation impliquerait donc de s’émanciper de ces institutions en favorisant l’intégration régionale. L’UEMOA offre un cadre intéressant de discussion mais ne possède pas de capacités financières, contrairement à la Banque Africaine de Développement. Celle-ci dépend néanmoins à plus de 70% de l’étranger et nécessite donc des réformes profondes pour devenir une réelle force de proposition. Quoiqu’il en soit, financer son propre mode de développement semble décisif pour dépasser la simple déclaration de principe et promouvoir un modèle inédit.
Cette innovation incite donc à penser le développement hors des cadres hérités et calqués systématiquement. Elle implique de prendre du recul sur la notion de « rattrapage », de s’émanciper de la référence occidentale comme universelle et indépassable. Elle invite au contraire à tirer les conclusions des crises multiples qui la traversent pour éviter de tomber dans les mêmes écueils. En un mot, il est important de cesser de faire « du passé des autres notre avenir » pour reprendre la formule lapidaire du sociologue et écrivain togolais Sami Tchak (cité par Felwine Sarr dans « Afrotopia »).
Bien entendu, cela laisse planer de nombreuses questions et inconnues, notamment autour du choix de ces nouveaux indicateurs. Néanmoins, il semblerait que ce soit à l’Afrique de prendre ce débat en main, il en va de sa stabilité.
Gilles Lecerf
[1] Banque Africaine de Développement, « African Economic Outlook » 2016
[2] http://foreignpolicy.com/2016/10/21/west-africa-is-being-swallowed-by-the-sea-climate-change-ghana-benin/
[3] Projection des Nations Unies – World Population Prospects 2015
[4] McKinsey&Company – Global Institute – « Lions on the Move II. Realizing the Potential of Africa’Economies » – September 2016
[5] Cadre de référence pour les politiques sénégalaises. Plans quadri-annuels sur les périodes 2014-2035 – http://www.presidence.sn/pse